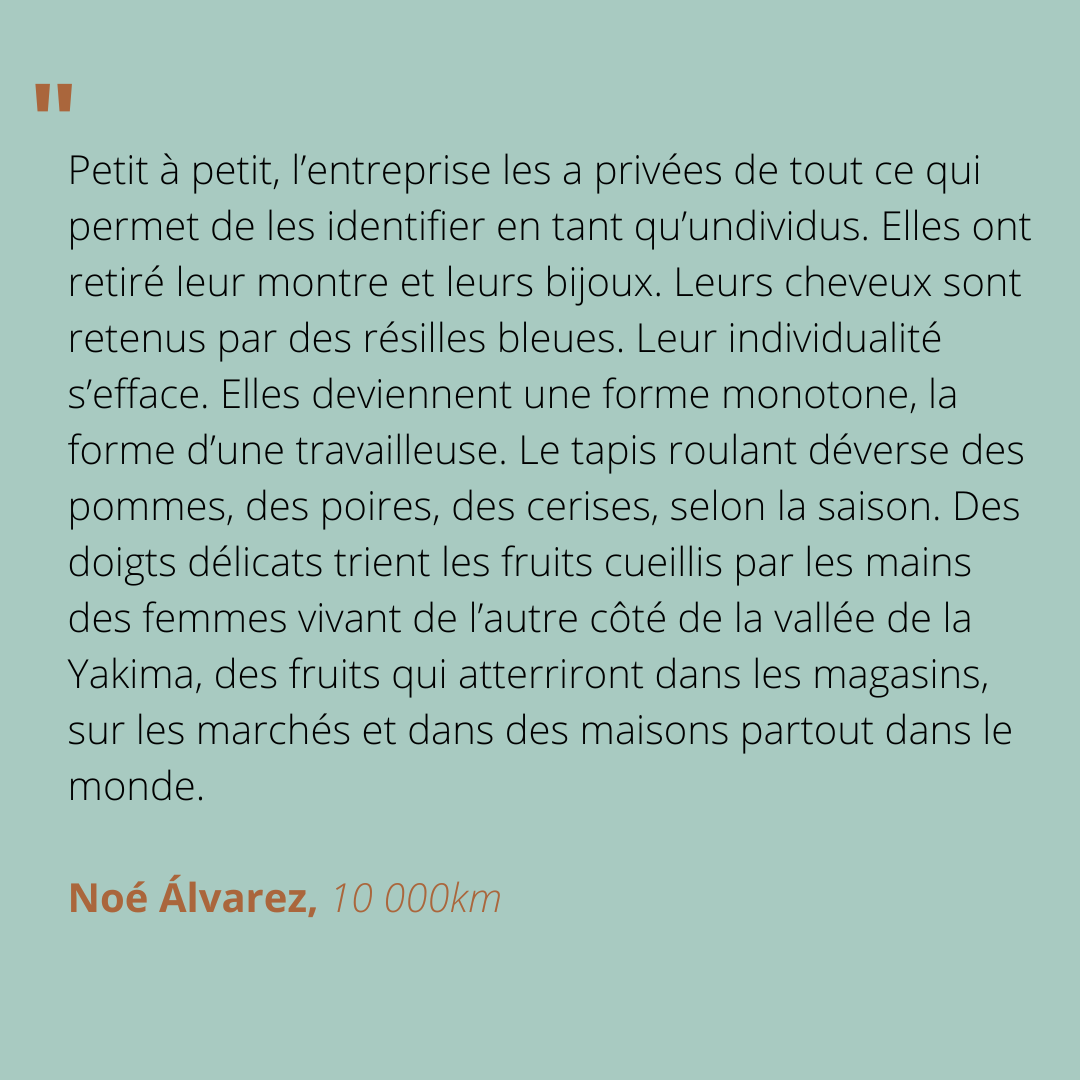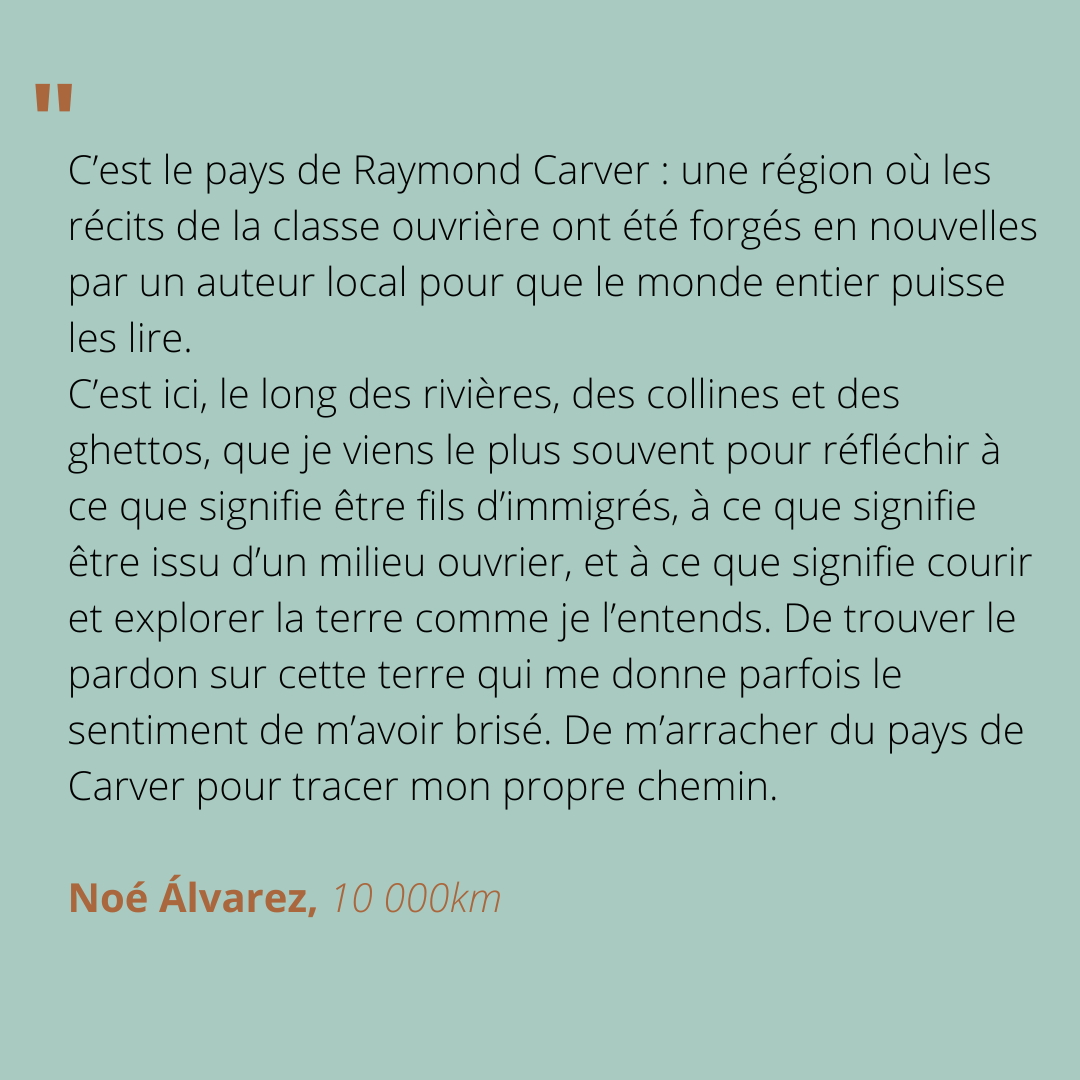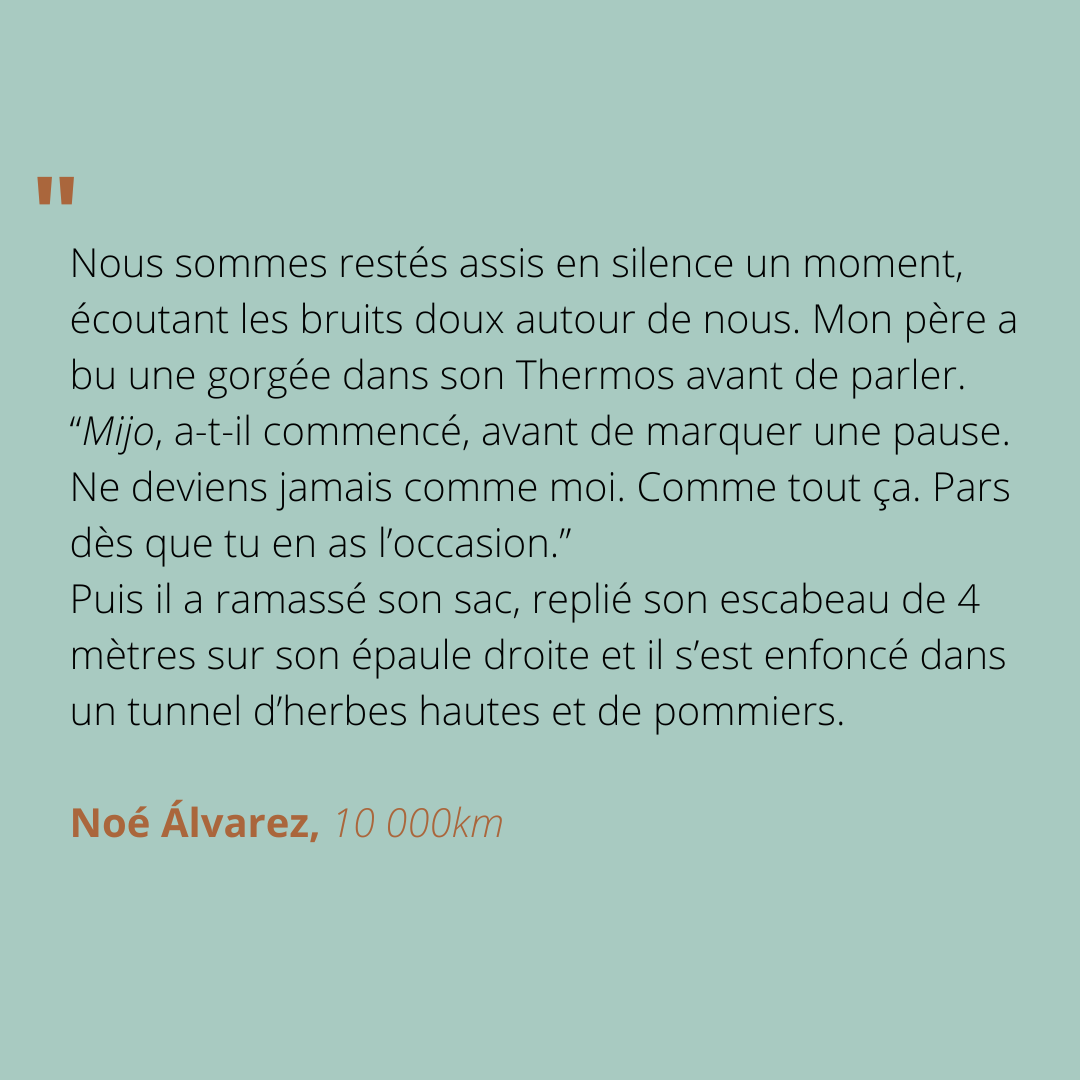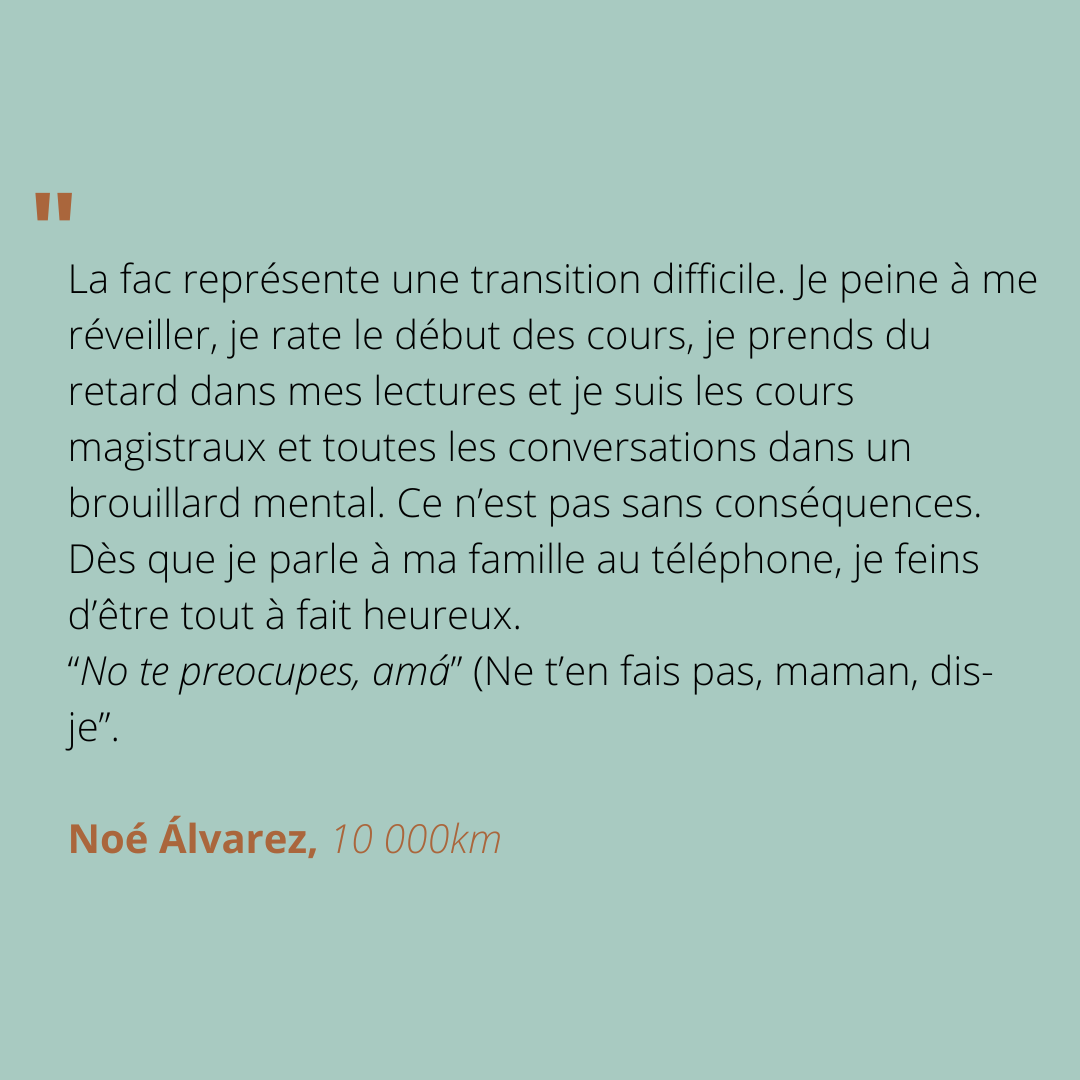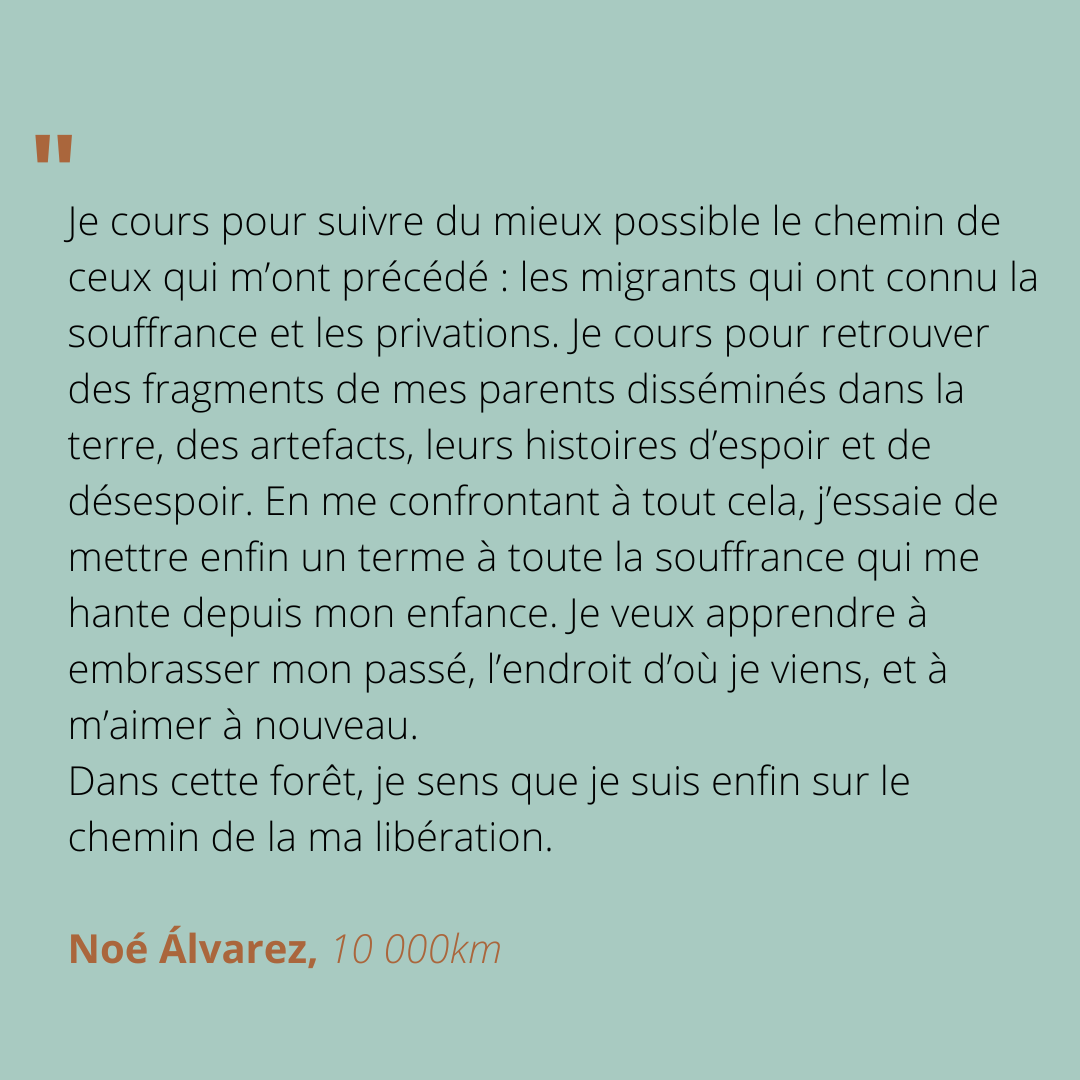Raphaëlle est garde-forestière dans la forêt québecoise du Kamouraska, frontalière avec le voisin états-unien et proche de la Gaspésie. Un coin sauvage, plein d’arbres, d’animaux, de neige, de fleurs, de lichens, d’insectes… Bref, plein de vie principalement pas humaine. Sauf des chasseurs bien sûr. Son travail, entre autre, c’est de veiller au respect des règles de chasse et de trappe et de lutter contre le braconnage, et ça braconne sec. Sa jeune chienne a survécu de justesse aux colliers d’un braconnier, et alors qu’elle décide de la venger et de retrouver le responsable, celui-ci semble prendre les devants : Raphaëlle se rend compte qu’elle est observée. Alors que l’automne se resserre et l’hiver approche, les dangers qui l’entourent prennent une nouvelle forme, plus inquiétante qu’une ourse ou une tempête de neige.
Sauvagines, je l’ai découvert après ma lecture, fait partie d’une trilogie qui reprend les mêmes personnages. Deuxième roman sur les trois, je ne me suis absolument pas sentie perdue de ne pas avoir lu le premier, j’imagine que les trois peuvent se lire tout à fait indépendamment. Je trouve que c’est le cas pour celui-ci, donc si, comme moi, tu n’as pas lu Encabanée, bah c’est pas grave, tu peux lire Sauvagines quand même ^^
Bienvenue dans le Canada sauvage ! Celui que l’on imagine, vu d’ici en Europe, beau, teint des mille couleurs de feu des arbres et avec des ours cachés derrière chaque tronc d’arbres. C’est presque ça, d’ailleurs, mais pas tout à fait. Raphaëlle aussi rêve d’un Kamouraska paisible, dans lequel les animaux et les arbres n’auraient à craindre ni les quotas de chasse ni les coupes à blanc. Mais malheureusement pour elle et son idéalisme, non seulement les animaux sont traqués pour finir en toques ou en manteaux avec une violence brute, les arbres rasés avec un grand plaisir et chaque décision de son ministère ne fait qu’étendre la latitude d’action laissée aux chasseurs : fin de protection de certaines espèces, baisse voire suppression de quotas, et une grande mansuétude face aux infractions de certains. Car ici comme ailleurs, malgré la faible densité de population, on trouve des castes de puissants, des dominants qui se montrent, s’imposent et violentent le vivant dans son ensemble. Et ça, Raphaëlle a de plus en plus de mal à le supporter. Elle qui a quitté une famille étouffante et traditionnelle, pour ne pas dire traditionaliste ; la seule à avoir hérité de quelques traits d’une arrière-grand-mère autochtone dont elle ne sait rien, espérait protéger cette forêt et participer à une véritable vie de communs entre chaque être vivant, humains et non-humain, qui l’habite. Mais non.
La vendetta dans laquelle elle se lance, d’abord seule puis avec le soutien de son mentor, Lionel, garde forestier à la retraite, la plonge dans cette face sombre des réglementation, dans la technocratie et le mépris des gens des bureaux qui décident comment gérer un coin dans lequel ils n’ont jamais mis les pieds, et qu’à Saint-Bruno-de-Kamouraska comme à Montréal, il y a les hommes puissants et les autres. Au fil de son enquête, passant alternativement de chasseuse à chassée, la noirceur et l’impuissance font vagues, et il lui faudra de la flamboyance pour retourner vers le vertige des grands espaces.
Deuxième roman d’une trilogie kamouraskienne, Sauvagines se lit tout seul, porté par cette langue toujours étonnante aux oreilles d’un-e français-e, aussi orale que poétique, qui laisse sur la peau les épines et les ronces, la neige qui vient et la boue qui précède et tire avec elle l’euphorie et l’oppression des étendues canadiennes. Si j’ai trouvé la fin un peu facile, le flot du roman m’a emmenée jusqu’au bout sans difficulté et je ne boude pas mon plaisir. je retournerai au Kamouraska avec beaucoup de plaisir !
Éditions Stock – Éditions Folio