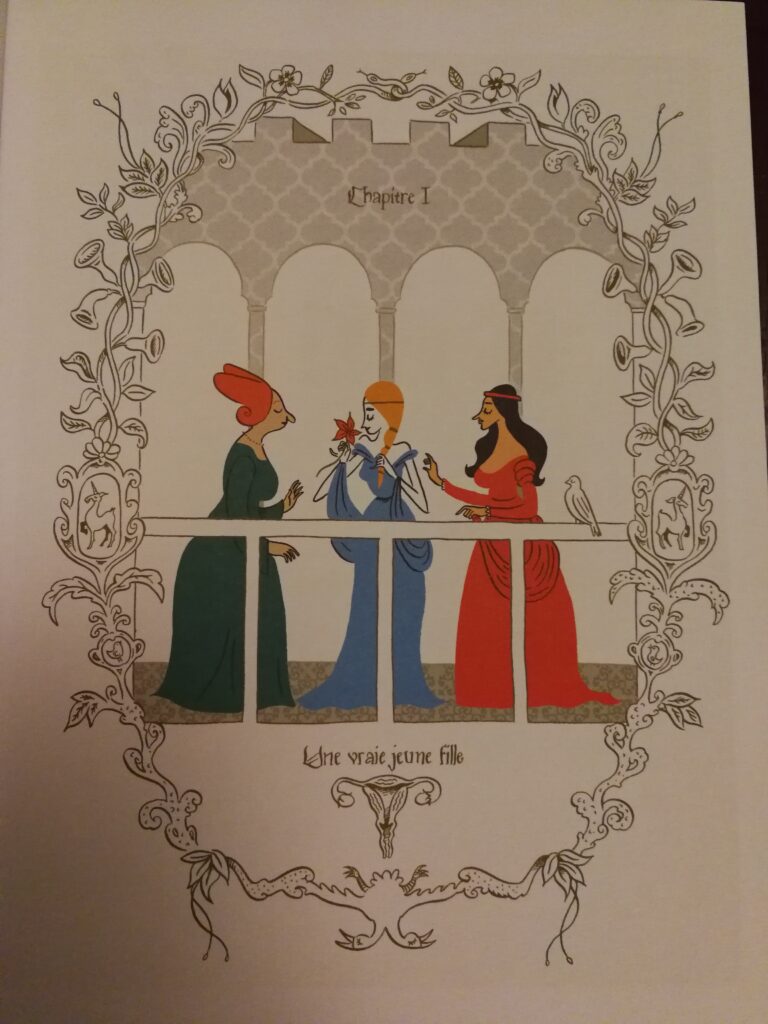Un cargo de commerce, rempli de containers, traverse paisiblement l’Atlantique. Le temps est bon, la mer calme et l’équipage de bonne composition, fiable et travailleur. Pour une raison qui lui échappera, la capitaine autorise ses matelots à arrêter les machines, descendre un canot et profiter d’une baignade au milieu de l’océan. Un écart de règle qui provoquera un écart de réalité.
Il y a les vivants, les morts et les marins.
Ils savent déjà, intimement, à quelle catégorie ils appartiennent, ils n’ont pas vraiment de surprise, pas vraiment de révélation. Ils savent à chaque endroit où ils se trouvent, s’ils sont à leur place ou s’ils n’y sont pas.
Il y a les vivants occupés à construire et les morts calmes au creux des tombes.
Et il y a les marins.
Lectrice, lecteur, mon abysse, jette tes cartes marines, ta boussole et ton sextant, ici même les étoiles ne pourront t’aider à te repérer.
Notre capitaine au long-cours n’en est pas à son premier voyage. Seule femme sur ce bateau, mais reconnue et respectée dans la profession, elle connaît les procédures, les trajets, la mer et ce qu’elle provoque de désorientation, de fascination et de désordre. Elle connaît aussi les hommes, gardés par la discipline et l’autorité, celle-là même qui, lorsqu’elle glisse un peu, peut provoquer un effondrement. Elle connaît enfin les bateaux, ces machines surpuissantes, surconnectées et dont les rouages et les moteurs impulsent le rythme auquel battra finalement le cœur de chaque marin.
Et bien sûr, elle connaît par-dessus tout son équipage. Aussi, lorsque, après cette baignade imprévue, cadeau inexplicable et injustifiable, tous remontent sains et saufs, mais avec autre chose qui flotte, ce 21ème homme sur 20 lors des décomptes, pourtant insaisissable sur les ponts, la capitaine sent que le trouble sera plus grand encore.
Elle sent le bateau qui s’émancipe, qui prend son rythme, et les instruments le lui disent, le bateau n’obéit plus. Elle voit le temps qui ne suit plus les règles, de la brume dans une région qui n’en voit jamais. Elle sent aussi que ses hommes ont le même trouble, et, pire, qu’ils remarquent son désarroi.
L’équipage, lui, après la jubilation des premières brasses dans l’océan, en son plein cœur, là où, on peut l’imaginer, personne ne s’était baigné avant, ont senti le sable du soleil sur leur front et la profondeur de l’océan sous leurs jambes flottantes. Ce vide immédiat, contré simplement par cette capacité apprise à flotter.
Ce moment suspendu, sur lequel plus personne n’a ni prise ni compréhension, qui échappe à tout entendement, va plonger notre équipage en lui-même. Cette attraction pour la mer, ces voyages si longs, cette rupture avec la terre et la vie qui lui appartient. Imposer une attente à celles (encore souvent des femmes) que l’amour a poussé à accepter cette amante envahissante. S’imposer, en tant que femme, dans cet univers si masculin, exister pour son nom et non celui de son père. Et peut-être, au final, comprendre que malgré les moteurs diesel, les containers en métal bleu ou vert, les radars et les géolocalisations satellites, un navire reste l’esprit de tous les navires, une émanation fantasmée du voyage en mer porteur de son écume de dangers et de rêves, porté lui-même par l’océan, de ses profondeurs insondables au ciel au-dessus de ses vagues, qui le caresse de ses vents et créé une carte de ses mouvements. Et ce n’est pas à nous de savoir si cette carte nous guidera à bon port ou nous égarera dans des brumes improbables, vapeurs insensées de notre propre perdition, en attendant les prochains rayons de soleil sur les dentelles minérales de la prochaine côte.
Une petite merveille de poésie que ce roman court, intense, qui se lit en un souffle avant l’apnée et la plongée mystérieuse après la baignade.
Quidam éditeur
146 pages