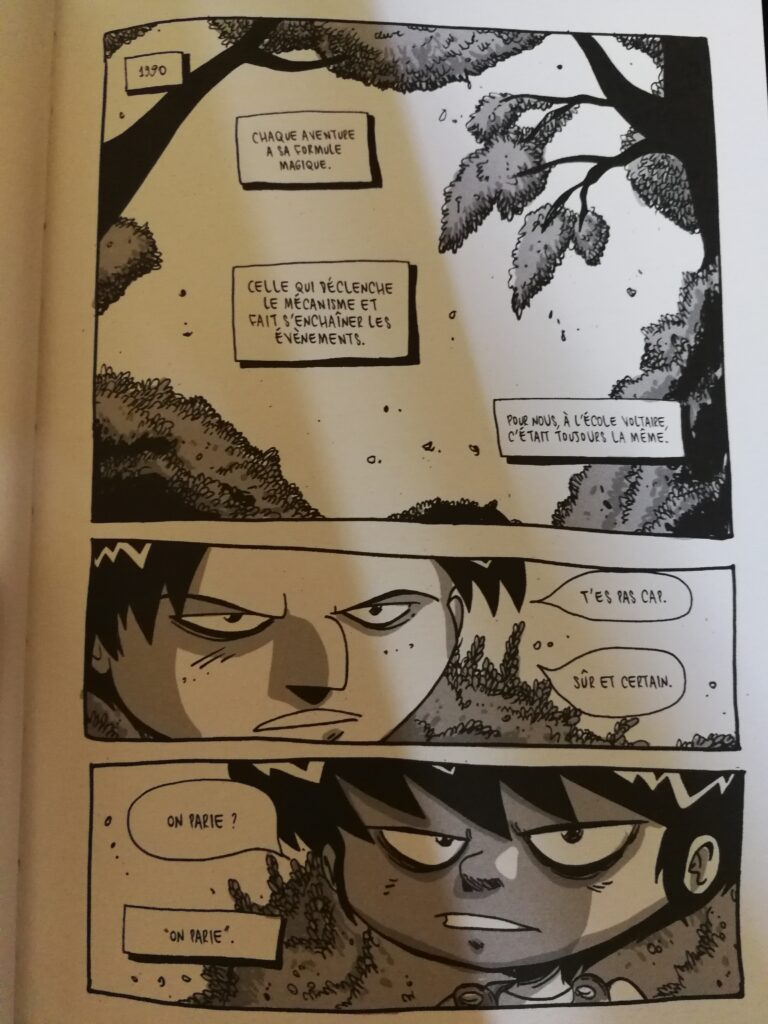Nous sommes en l’an de grâce quatorze cents et des brouettes, et la guerre de Cent ans bat son plein. Le royaume de France ne ressemble pas à grand-chose, Charles VI le Fol vrille toujours plus du ciboulot, et entre deux intrigues de cour, on s’emmerde un brin. Yolande d’Aragon, en tout cas, tourne un peu en rond. L’épouse de Louis d’Anjou, homme pieu s’il en est, n’en peut plus de cette guerre interminable et des querelles entre Armagnacs et Bourguignons. Après avoir casé sa fille Marie avec Charles le Dauphin, elle décide de prendre en main la prophétie qui évoque l’arrivée d’une jeune vierge amenant au couronnement dudit Charles futur VII, parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même.
Notre chère Yolande se fait donc éducatrice de quinze pucelles, rebaptisées Jehanne 1, 2, 3… 15, pour enfin faire advenir la prophétie.
Laisse-moi me présenter comme il se doit :
my name is Yolande,
and I am from Aragon,
née sur les terres du royaume de France quatorze siècles après Jésus-Christ, répandue au sortir du ventre par des hurlements de joie, déjà bien esbardaillée des choses du monde, instruite en diableries, quatre fois reine, deux fois comtesse, dame de Guise, duchesse et maîtresse incontestée de mes sujets hérités de mienne épopée angevine, mariée à Louis, dit Loulou, belle-mère et liée par le sang au Grand Bastard de France, je me montre si douce avec lui qu’il me nomme tantine. Alors que j’étais enfin en âge de pouvoir sécher les vêpres, une grande guerre civile s’est déclenchée. Sache que c’est pur hasard si je me tiens du côté des Armagnacs plutôt que celui des Bourguignons. J’eusse pu être en inverse et le vivre aussi bien. Nonobstant, il faut reconnaître que tout avait mal commencé pour les gens de la classe mil trois cents quatre-vingts. Car, bien avant la scission fatale dont je te parle, le royaume était plongé et jusqu’à l’aine en grande bataille. Contre les traîtres d’ascendance englishoise. Eux aussi héritiers du trône de France, par directe lignée d’Isabelle la Louve, en survivance des roys maudits, et voulant comme tout le monde leur place au banquet : ce qui donna lieu à quatre-vingts-dix ans de négociations outre-Manchettes à coups de flèches et d’épées.
Nous voilà donc avec une duchesse pas piquée des hannetons, quinze Jehanne en gestation et des conflits et intrigues en veux-tu en voilà. Et si tu savais, lectrice, lecteur, ma dulcinée, ce qui t’attend, tu n’en croirais pas tes mirettes. Alors accroche-toi à tes chausses et reprends du café.
Je ne veux pas t’en dire trop sur l’intrigue générale de ce roman décoiffant (#cliché1) parce que je ne suis pas comme ça, je veux que tu vives toi aussi cette incapacité à poser ce livre devant la folie de cette histoire. Pas de raison que je sois la seule avec des cernes, bordel.
C’est un sacré tableau que nous dresse l’auteur, de ce début de XIVème siècle que l’on voit souvent très austère et morne (et masculin, hein). Yolande d’Aragon se joue des conventions pour mener à bien ses plans, Jehanne future d’Arc se pâme devant les poitrines corsetées (ou pas, d’ailleurs), des soldats tombent en amour entre eux et les hommes de pouvoir n’ont guère dans le cerveau que de la confiture, probablement empoisonnée, d’ailleurs, par notre chère Yolande.
Guillaume Lebrun nous embarque donc dans une relecture complètement barrée (#cliché2) de l’histoire de Jeanne d’Arc, personnage figé et complexe s’il en est, d’une manière absolument formidable. Tu le constates toi-même avec cet incipit, il commence par nous proposer une langue fort peu commune, mélangeant anglicisme, ancien français et argot contemporain. Aussi originale que musicale, cette langue tisse le rythme du récit et nous entraîne dans la sarabande endiablée de l’épopée jehannesque de Yolande et sa troupe de prophétesses en devenir. Pas radin sur les clins d’œil, il parsème le tout de références culturelles improbables, et réussit le tour de force de ne pas nous perdre ni nous lasser et d’intégrer parfaitement le tout à la trame globale de son histoire.
Roman foutraque (#cliché3), féministe, queer, amoureux des genres et profondément historique, Fantaisies guérillères donne à notre Jeanne nationale un visage autre que borgne et rend à Yolande d’Aragon sa place dans l’histoire de France. Alors ne boude pas ton plaisir, lectrice, lecteur, ma très chère, et plonge dans la guerre de Cent ans la bave aux lèvres, la poitrine nue et la lame acérée !
Christian Bourgois
320 pages