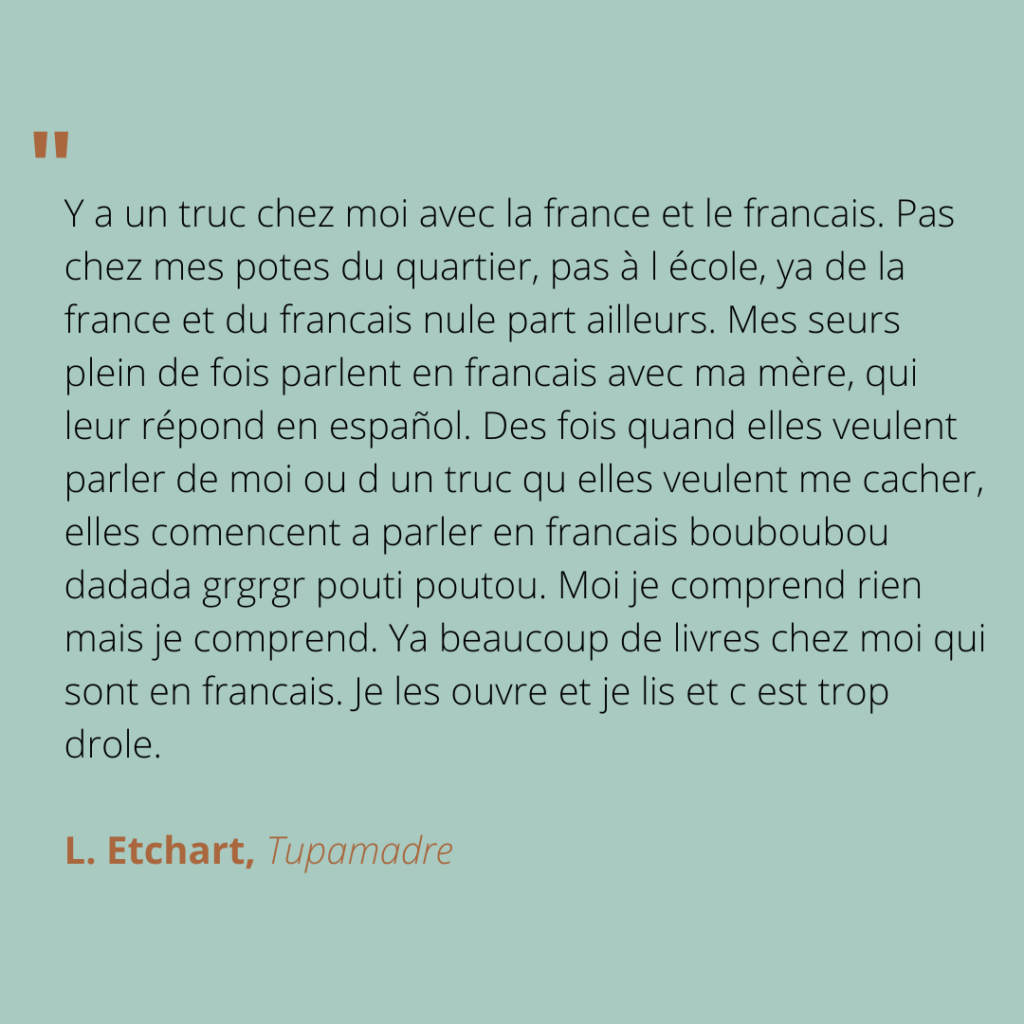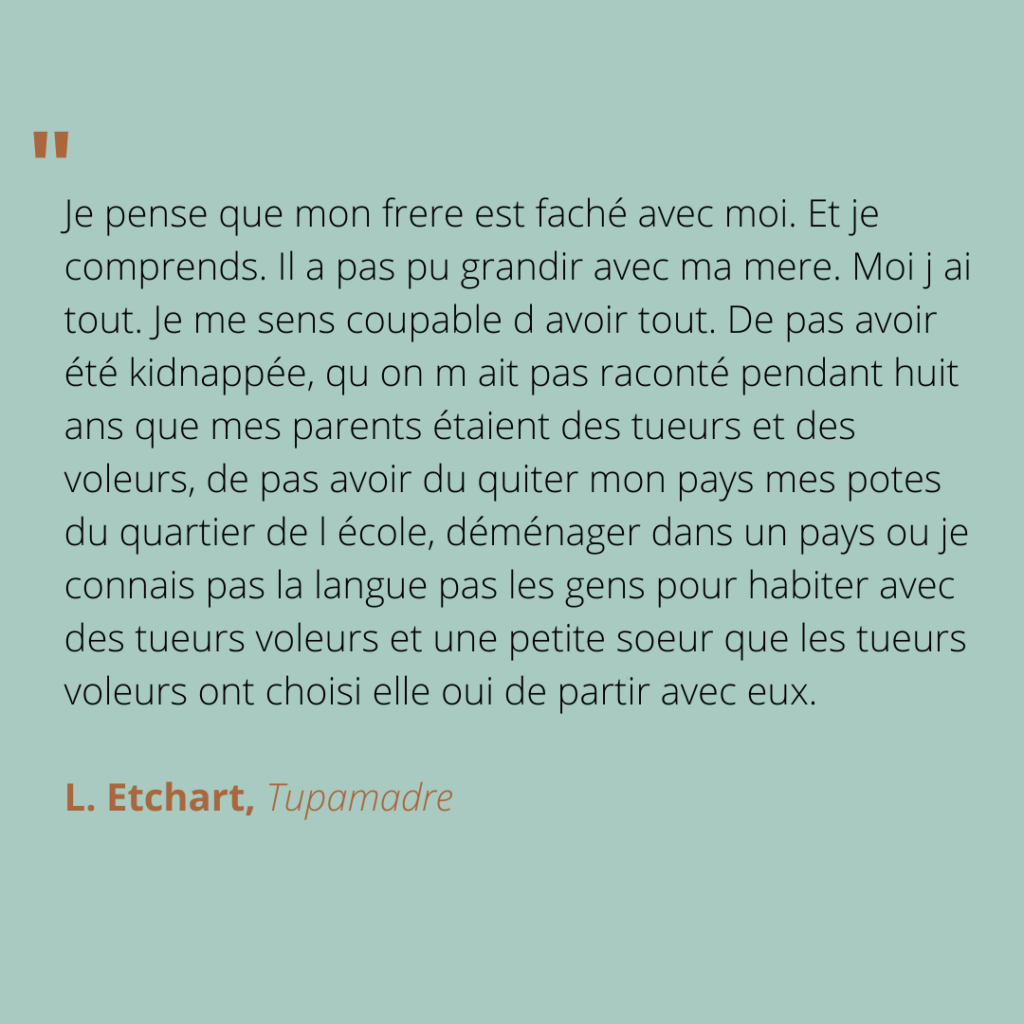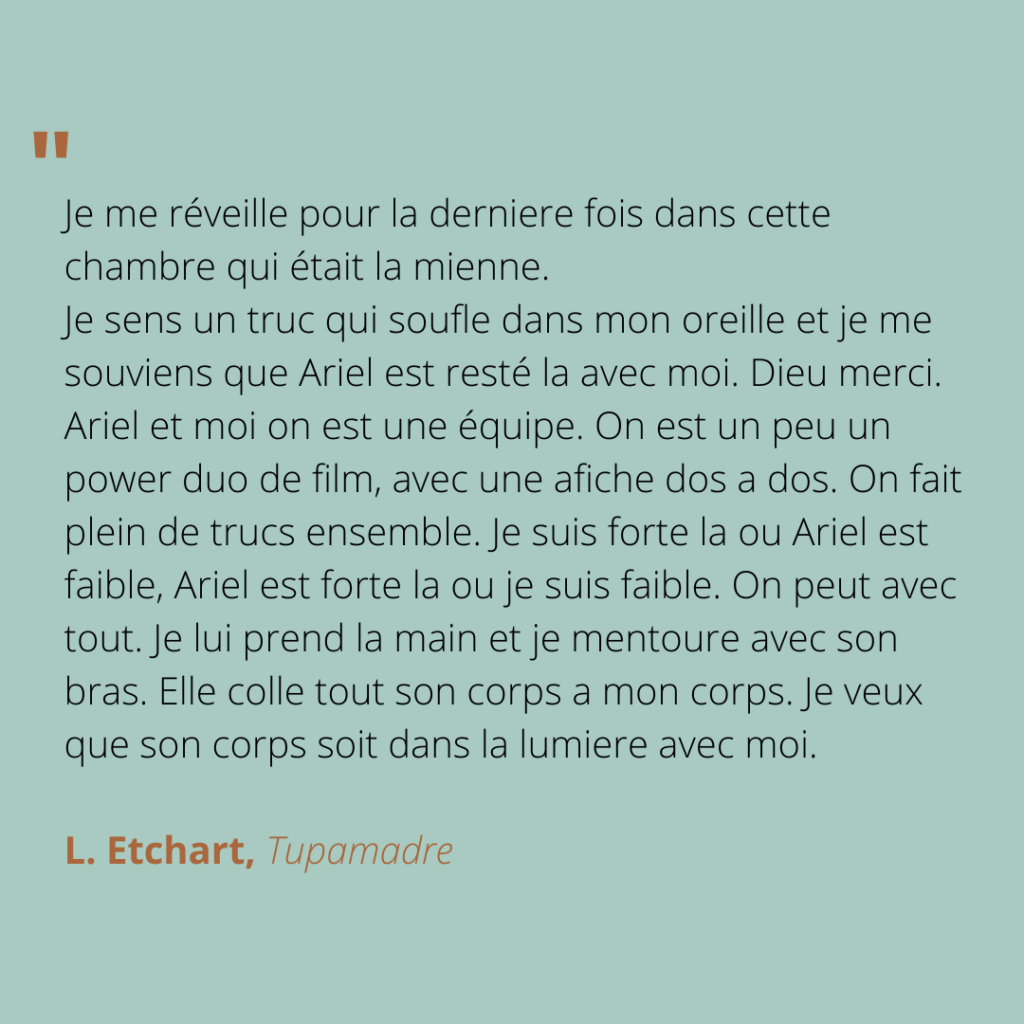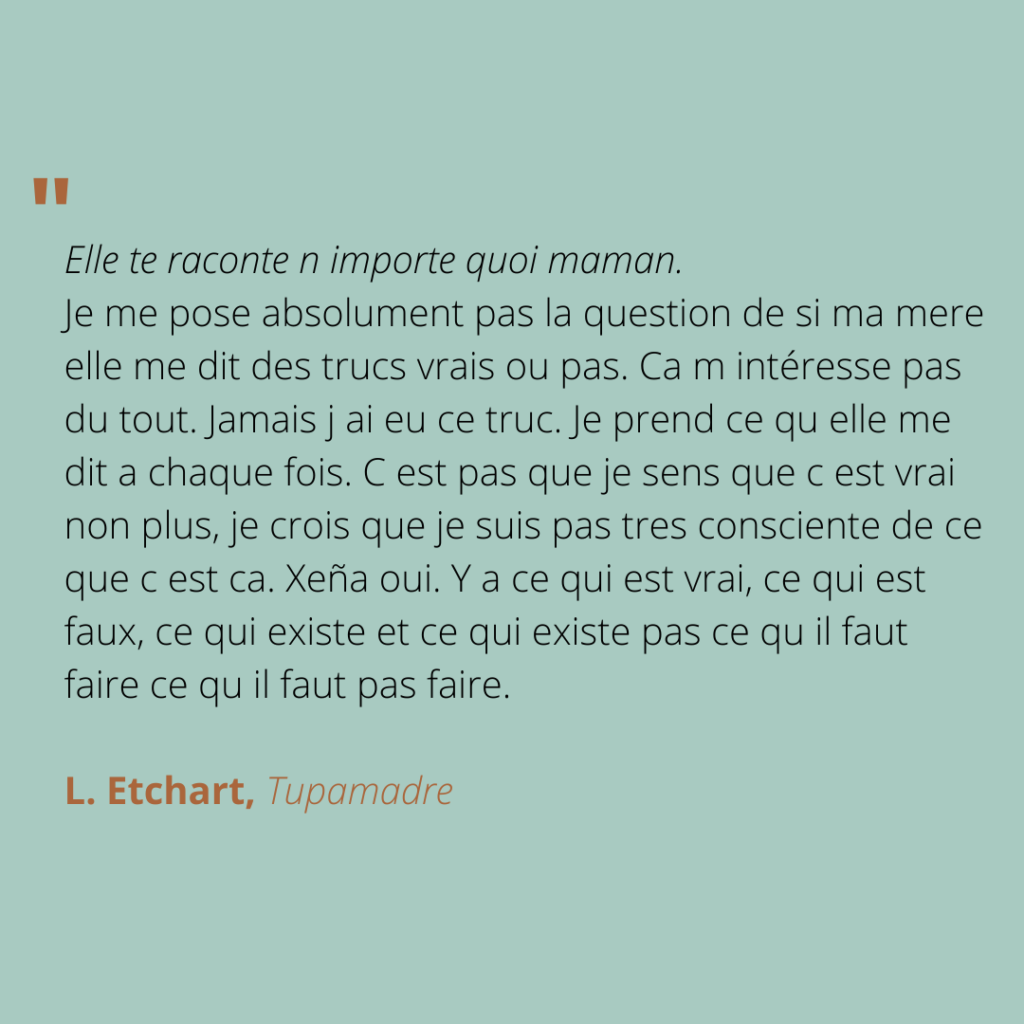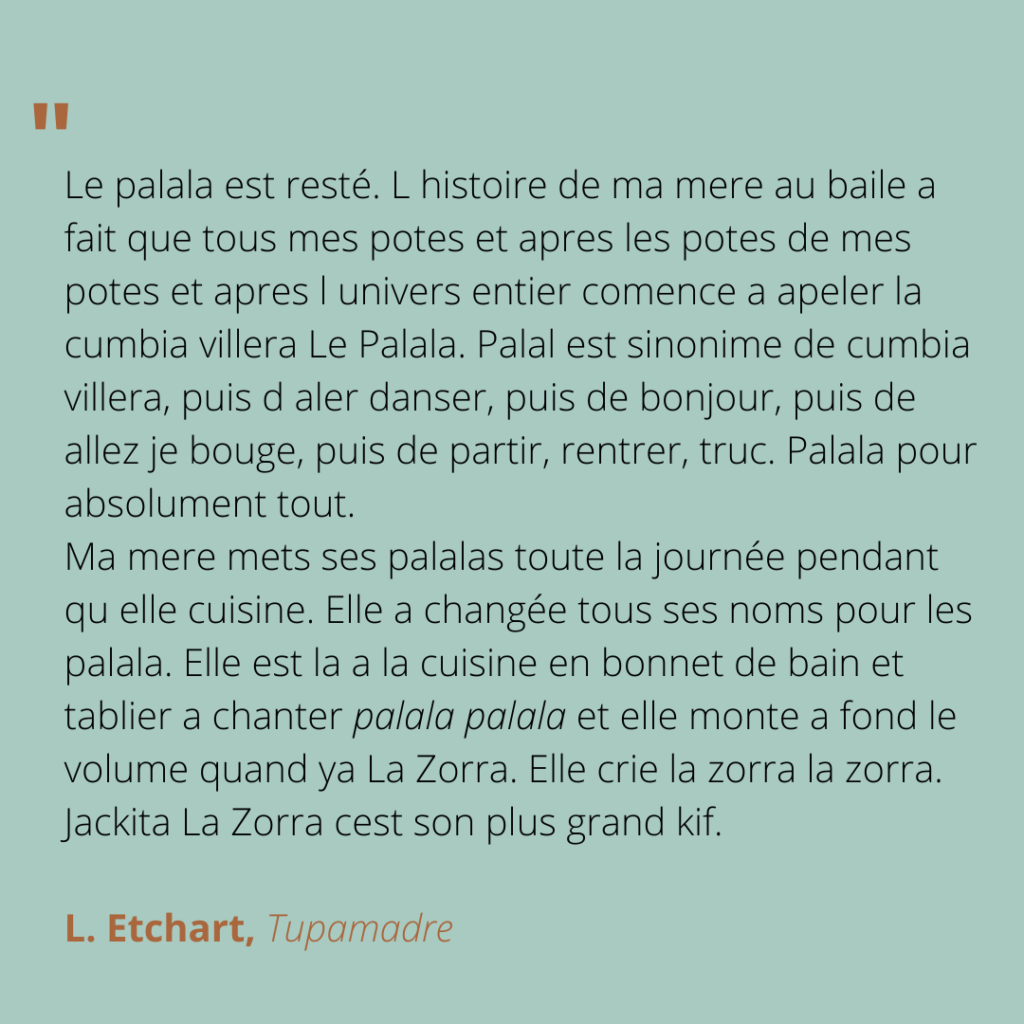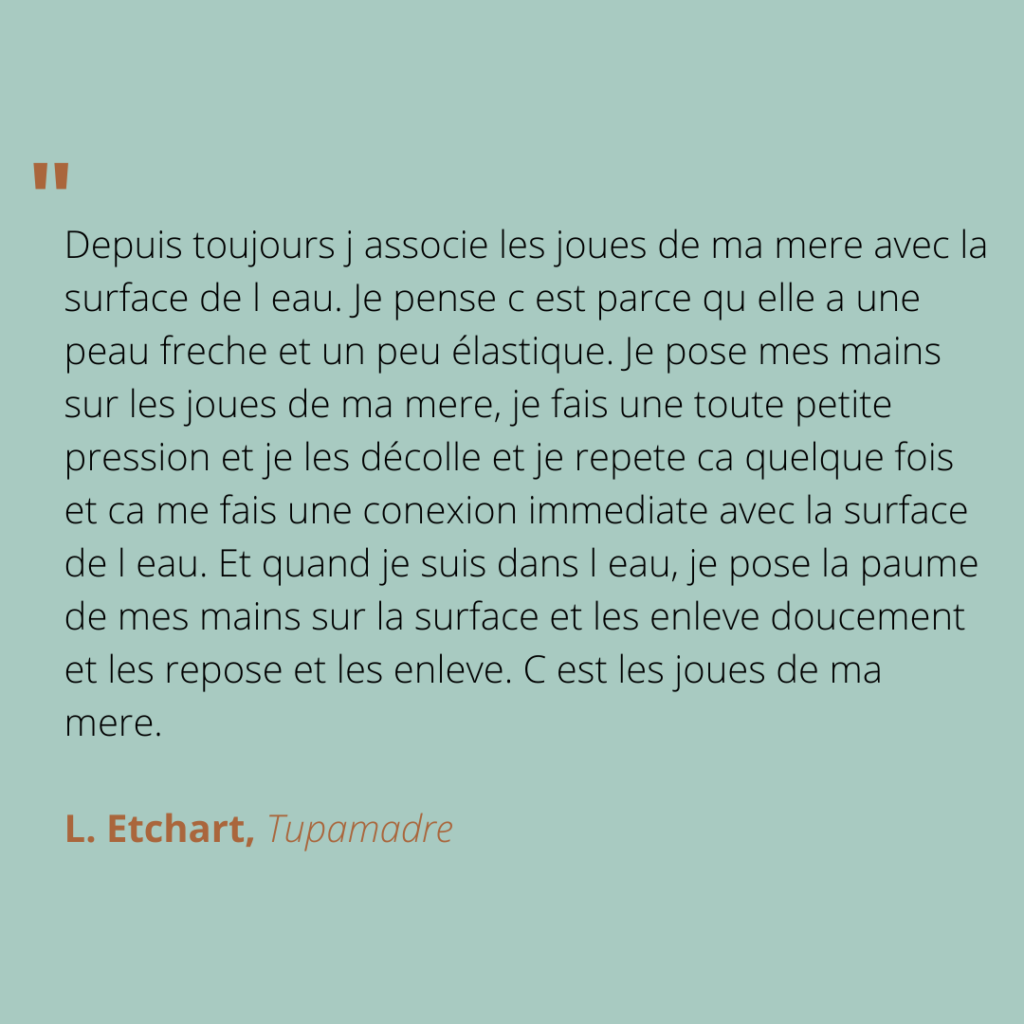Lucía est la petite dernière d’une famille multiplement décomposée et recomposée. Deux sœurs et un frère avec qui elle partage des parents, un chat, une ville (Montevideo), deux langues. La sienne, l’espagnol, et la leur en partie, le français. Ses parents ont été membres des MLN – Tupamaros dans les années 60-70 (à vérifier), et ont vécu en exil en France pendant plusieurs années. Lucía, arrivée plus tard, ne connaît que l’Uruguay, les rues de Montevideo, et ces femmes qui semblent reconnaître sa mère dans la rue.
Mon pere il a touché a rien. Il touche pas. Il s approche pas. Il dort de son coté. Tes lunettes sont la. Ton livre marqué a la page 69. Trop drole. Tes médicaments. L ampoule de morfine ouverte, remplie. Je caresse tes lunetes. Je colle mon nez a ton oreiller. j ouvre ton tiroir. Tes collections. Tes petites boites avec dedans des boites plus petites avec dedans toutes sortes de petites merdes. Une dent, une chaussete bébé, tous les petits mots que je tai fais pour tes aniversaires, des cailloux, des tickets de bus, des feuilles seches, des bouts d ongles ?
Des chouchous des bouts de tissu. Cest infini.
Et la
Derriere tout
Au fin fond du tiroir
Un tout petit carnet.
Le français, c’est la langue dans laquelle elle nous raconte ces vies. Un français bien à elle, imprégné de sonorités personnelles, badigeonné de castillan et gratiné de parler, un français qui ferait hurler l’Académie (pour notre plus grand plaisir) et qui nous précipite dans ses pensées. Peut-être est-ce une petite revanche personnelle, elle qui entendait sa mère et ses sœurs parler dans cette langue étrangère quand elle était enfant et que le reste de la famille ne voulait pas qu’elle comprenne. Peut-être est-ce par défi, elle fille de révolutionnaires, queer, cherchant un autre modèle, un bien à elle. Peut-être est-ce parce que parfois il faut pouvoir inventer sa propre langue, sa propre orthographe et sa gram-mère pour que le récit soit au plus près du vécu et que le vécu colle à l’histoire.
L’histoire, justement. C’est la sienne et celle de sa famille, celle de sa mère surtout. Cette femme forte et étrange, un peu étrangère sur les bords à sa propre fille. Cette femme que d’autres appellent par un autre nom, qui tait son passé, n’en laisse échapper que des morceaux qui risquent de s’effriter si Lucía pose une question ou respire au mauvais moment de la narration. Une mère qui tombe malade et qui s’apprête à disparaître avec toute l’histoire. Verónica/Susana/María.
L’histoire à elle, à Lucia, qui dès petite se sait différente, une gouine comme une autre mais pas une petite fille comme les autres, qui essaie de cacher sa queerness avant de la vivre pleinement. Une fille pour qui les putes sont des « meufs wow » et la cumbia prend ses airs de « palala ». Dont le frère aîné, absent, se nomme Liber Túpac et dont l’absence et le nom contiennent déjà une part de l’histoire familial. Et dont la mère est apostrophée, parfois dans la rue, par des femmes très émues.
C’est le cancer qui tombe en dernier sur sa mère, un mauvais, qui ronge le corps et attaque ce temps déjà insaisissable. Les corps changent, se meuvent, s’affaissent. Les identités maternelles multiples permettent de mettre à l’écart un temps la maladie, mais l’organisme est insensible aux alias.
Au fil de cette langue hybride, intime et puissante, Lucía replonge dans ses souvenirs, convoquant la mère seule, la famille, les ami-es qui convoquent eux-mêmes le passé, la France, la prison, les non-dits. On découvre une personne, une autre, puis une autre, qui émergent dans les remémorations, les rêves, les listes et les télénovelas, points d’accroche pour plonger dans les non-dits d’une lutte passée qui a laissé des traces cachées tant dans le pays, dans la famille que dans les combattants.
Avec sa langue propre, L. Etchart propose une autre manière d’aborder cette recherche intime et politique en prenant le contre-pied de tout pour trouver peut-être sa propre compréhension de tout cela.
Éditions Terrasses
209 pages
.