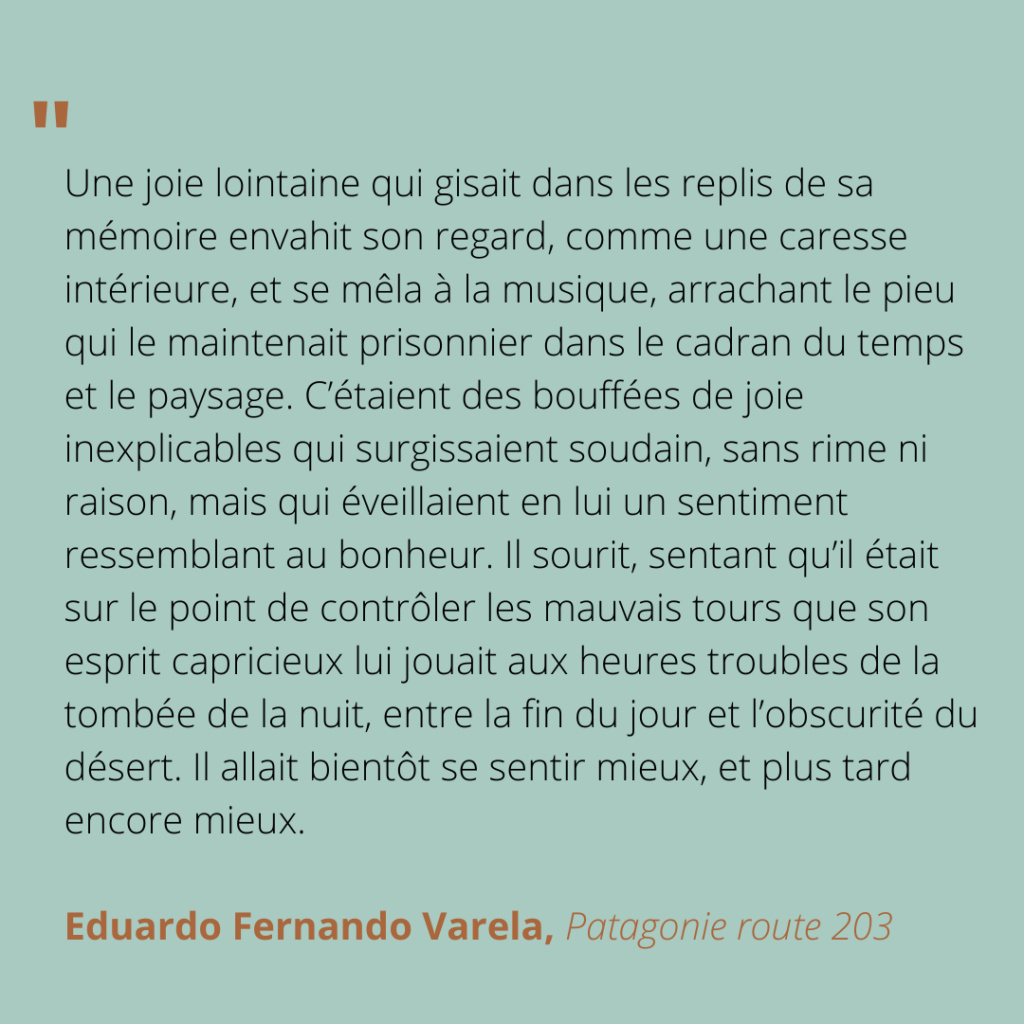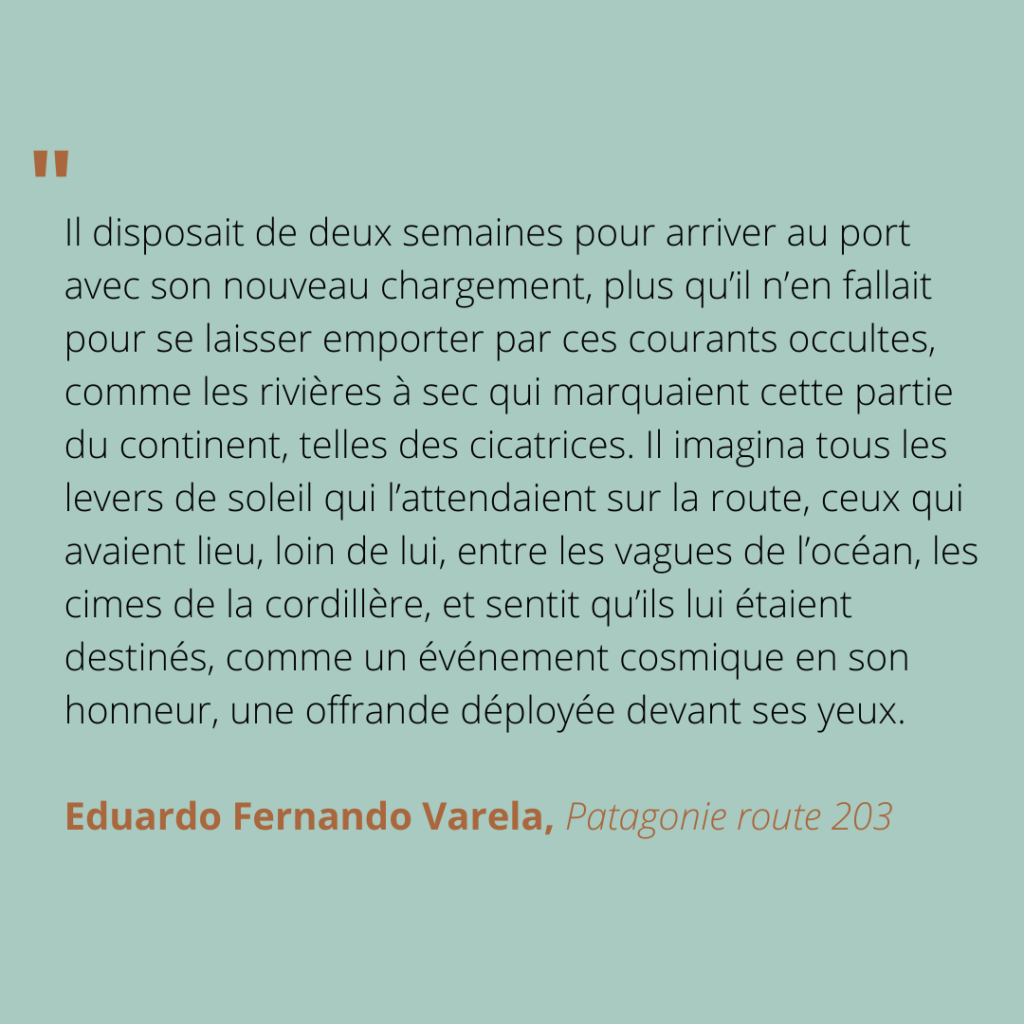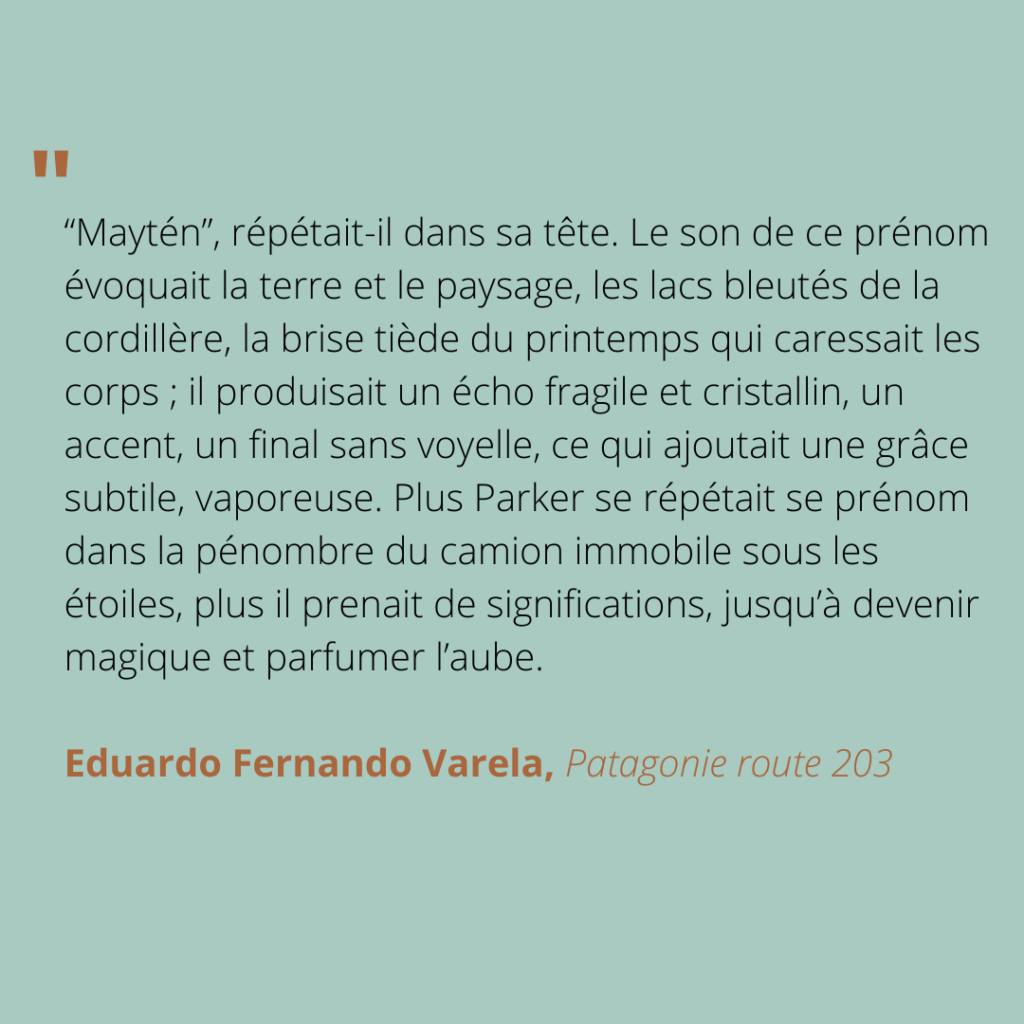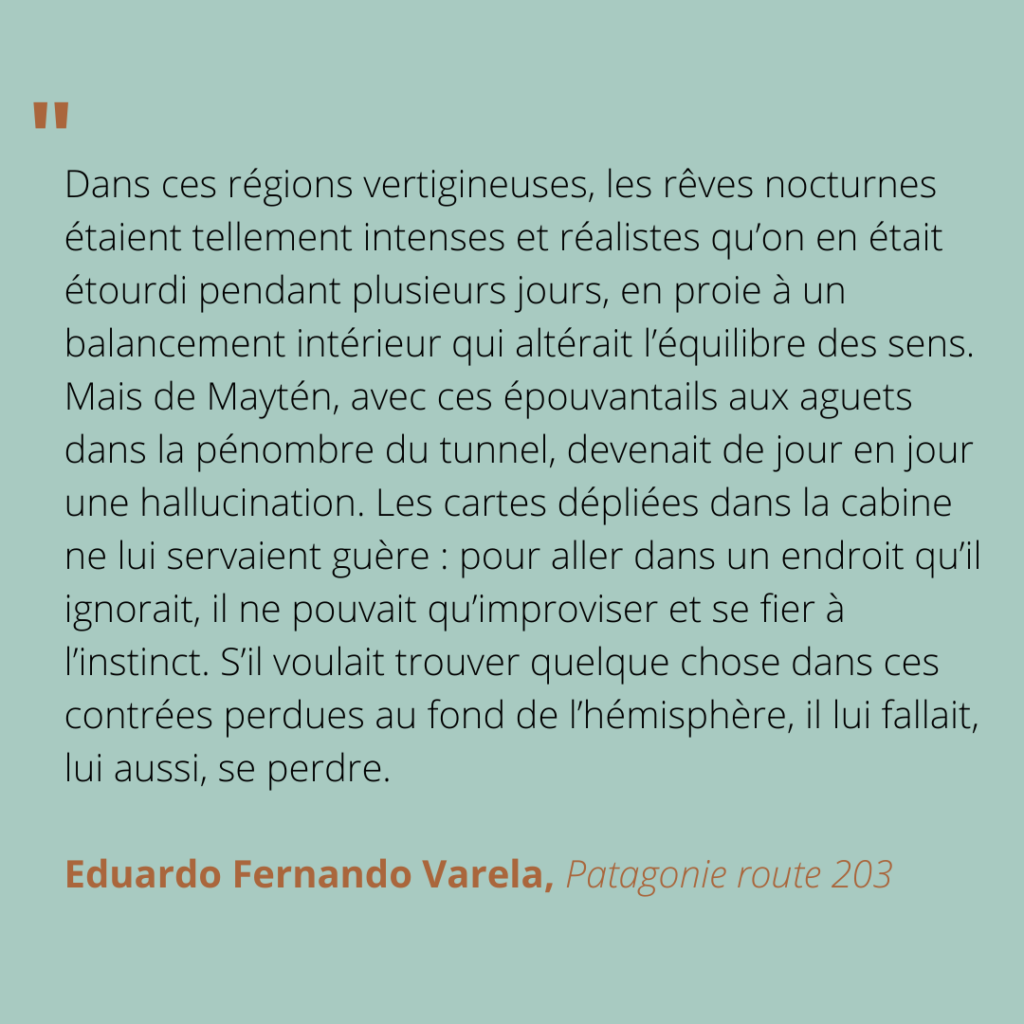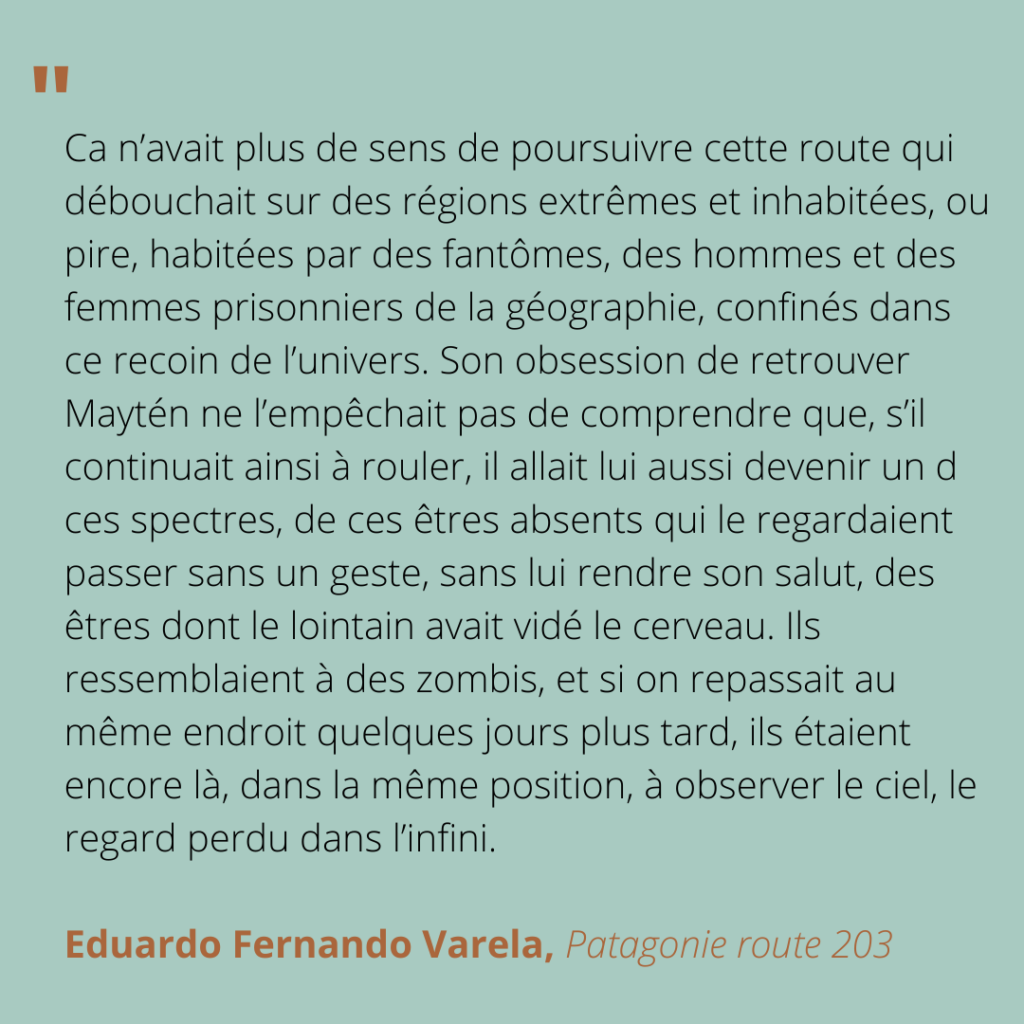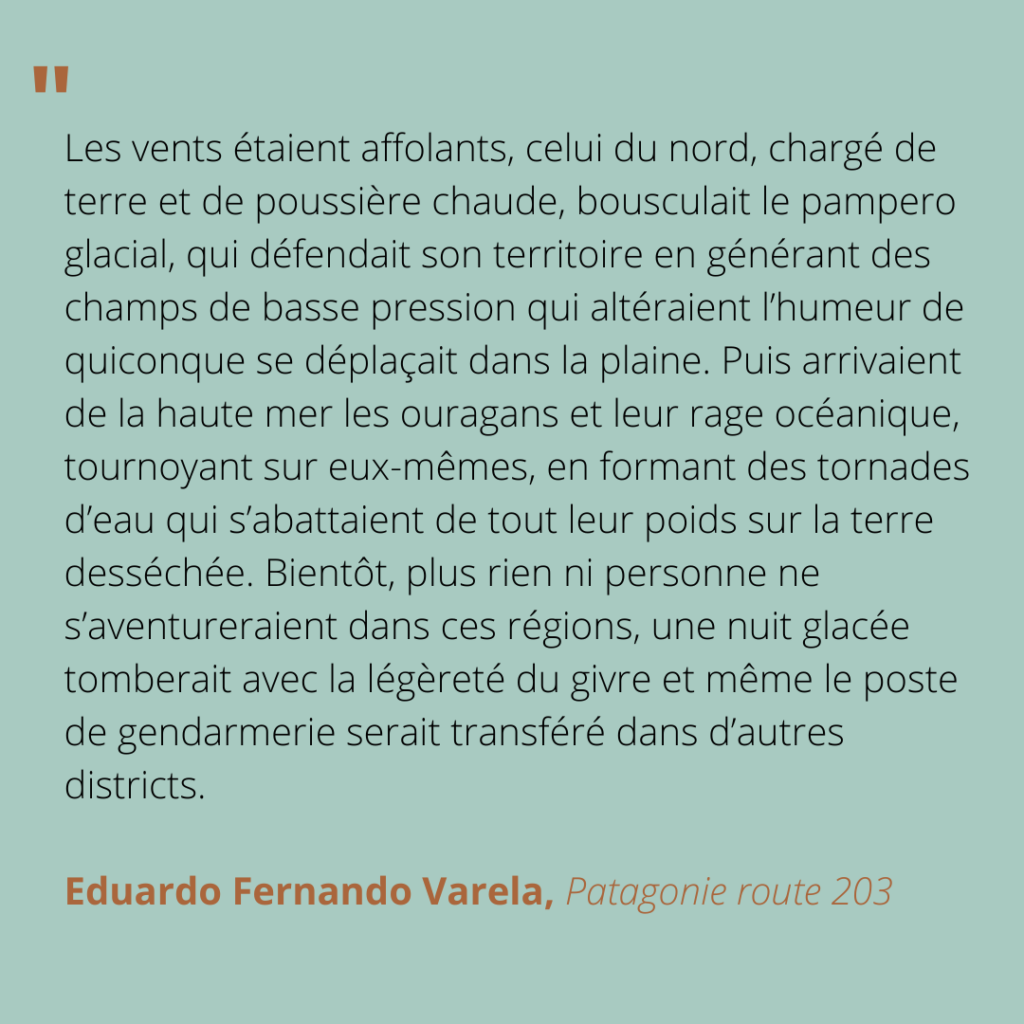En novembre 1986, Selva Almada a 13 ans et vit avec sa famille à Villa Elisa, petite ville de la province d’Entre Ríos proche de la frontière avec l’Uruguay. C’est un dimanche plutôt tranquille qui commence, malgré l’orage de la nuit. L’asado dominical prend doucement, la chatte a fait ses petits. A la radio, Selva, aux côtés de son père, entend une nouvelle qui va la bouleverser. A quelques kilomètres de là, à San José, Andrea Danne a été assassinée pendant son sommeil, poignardée en plein cœur.
Le 16 novembre 1986 au matin, le ciel était limpide, il n’y avait pas un nuage à Villa Elisa, le village où j’ai grandi, dans le centre-est de la province d’Entre Ríos.
On était dimanche et mon père préparait l’asado au fond du jardin. Nous n’avions pas encore de barbecue, mais il se débrouillait assez bien avec un morceau de tôle à même le sol qu’il recouvrait de quelques braises au-dessus desquelles il installait une grille. Même par temps de plus, mon père ne renonçait jamais à l’asado du dimanche : si besoin, il protégeait la viande et les braises à l’aide d’un autre morceau de tôle.
Tout près de l’asado, entre les branches d’un mûrier, il y avait une petite radio à piles, toujours branchée sur la même fréquence, LT26 Radio Nuevo Mundo. Ils passaient des chansons folkloriques et toutes les heures un bulletin d’infos assez succinct. La période des incendies à El Palmar n’avait pas encore commencé -à quelque cinquante kilomètres de là, le parc national prenait feu chaque été, faisant retentir les sirènes des casernes de pompiers tout alentour. En dehors de quelques accidents de la route -toujours un jeune qui venait de quitter un bal- le week-end il ne se passait pas grand-chose. Il n’y avait pas de match de foot de prévu cet après-midi là : en raison de la chaleur, on était déjà passé au championnat nocturne.
Andrea Danne, 19 ans (San José, Entre Ríos).
María Luisa Quevedo, 15 ans (Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco).
Sarita Mundín, 20 ans (Villa Nueva, Córdoba).
Toutes trois assassinées dans les années 80, trois meurtres non résolus. Marquée par l’annonce de ce fameux dimanche de novembre 86, Selva Almada décide de remonter le fil de ces trois drames et de raconter leur histoire. Issues des provinces argentines, vivant dans un milieu populaire voire pauvre, elles étaient encore à l’école, jeune travailleuse ou prostituée. Leur mort a défrayé la chronique dans ces lieux éloignés du bruit de la capitale, qui vivent au rythme des usines, des champs, des championnats de foot et des bals de fin d’année. Sans avoir l’ambition de résoudre des enquêtes au long cours, elle défriche ce qui pourrait s’apparenter à de sordides faits divers pour remettre en lumière des crimes insupportables qui reflètent la place et la considération données à l’assassinat des filles et femmes dans le pays. A l’époque, le pays est tourmenté par ses autres démons, on découvre les histoires des bébés et enfants volés pendant la dictature.
Trente ans plus tard, donc, Selva Almada revient sur ces trois histoires, exemples trop banals d’une violence toujours présente et au bruit encore trop faible. C’est l’histoire d’une violence systémique, qui naît dans la pâleur du quotidien. Les histoires de femmes racontées autour d’un maté : la voisine battue, celle qui s’est pendue sans que l’on sache si ce n’était pas un meurtre camouflé ; celle qui donne tout son salaire à son mari ; celle qui n’a pas le droit de se maquiller. Celui qui insulte sa copine en pleine rue. Celle qui n’a pas le droit de porter de talons. Toutes ces histoires racontées à voix basse, par honte. La même honte que celle ressentie sous les regards concupiscents des hommes. Certaines, comme la mère de Selva, n’avaient pas peur de les dire à voix haute, pour que la honte se retournât vers ceux qui la méritaient.
Alors que Selva Almada termine son livre en janvier 2014, au moins dix femmes sont déjà mortes depuis le début de l’année.
Avec une écriture simple et dépouillée nimbée de mélancolie, Selva Almada raconte autant l’histoire de ces jeunes filles et femmes que celle d’une société rongée par une violence qu’elle ne sait pas contenir et qu’elle érige en voyeurisme médiatique. Il faudra l’électrochoc du mouvement Ni una menos en 2015, qui deviendra international, pour prendre en compte, peut-être, l’ampleur des crimes commis contre les femmes. Les jeunes mortes est un récit important pour comprendre de l’intérieur les rouages infernaux de ces morts intolérables.
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Laura Alcoba
Éditions Métailié
140 pages