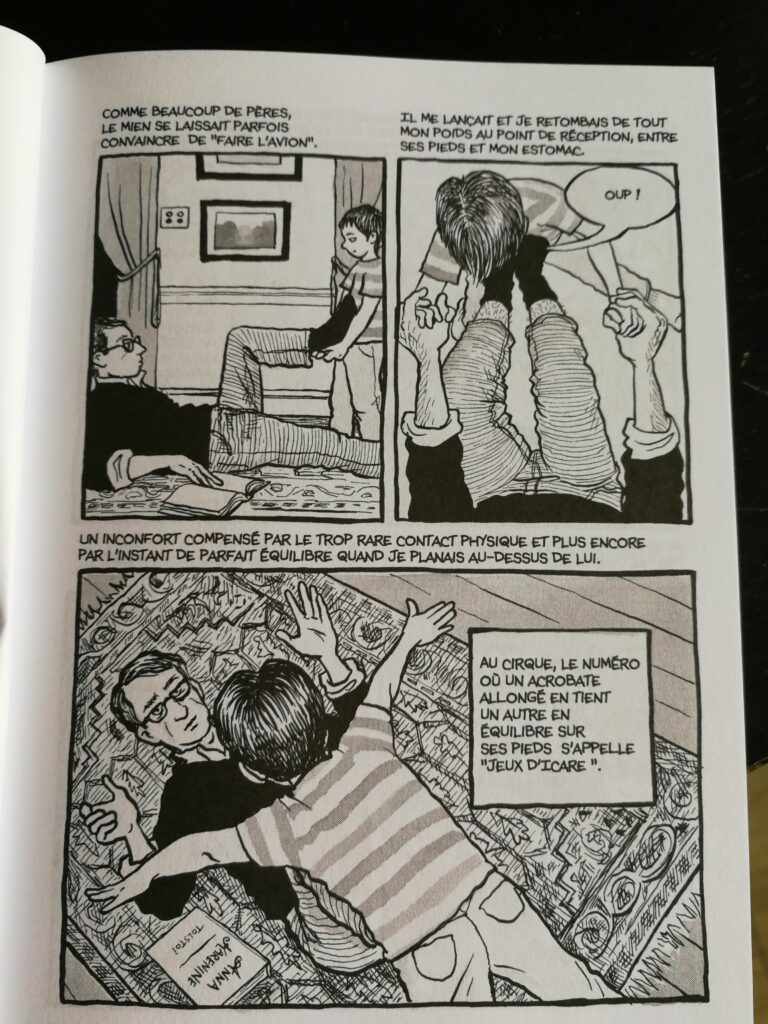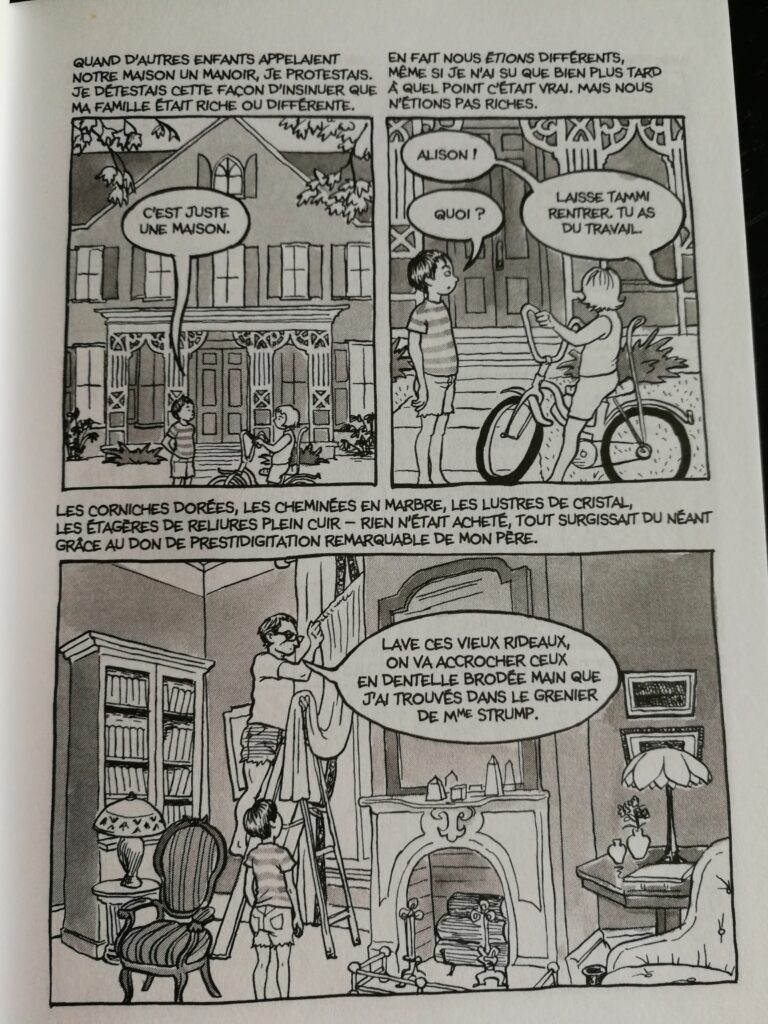L’adelphe Chih, de l’abbaye des Collines-Chantantes, est en route pour la capitale de l’empire. Elle y assistera à l’éclipse du mois, ainsi qu’à la première cérémonie du Dragon de l’impératrice. En chemin, elle fait halte au bord du lac Écarlate où il rencontre Sun, alias Lapin, ancienne servante de l’impératrice In-yo. Accompagné de son neixin, la piquante huppe Presque-Brillante, il va séjourner quelques temps auprès de la vieille dame, et découvrir son histoire.
« Quelque chose veut te manger, lança Presque-Brillante, perchée sur un arbre voisin. Je ne lui en voudrais pas s’il y parvient. »
Un tintement. Chih se remit debout et examina soigneusement le cordon de clochettes qui entourait le bivouac. Un instant, elle se crut de retour à l’abbaye des Collines-Chantantes, en retard pur une nouvelle tournée de prières, de corvées et de laçons, mais les Collines-Chantantes n’étaient ordinairement pas baignées d’une odeur de fantômes et de pin humide. On n’y sentait pas se dresser les poils de ses bras en signe d’alarme ni bondir son cœur dans sa poitrine sous l’effet de la panique.
Les clochettes étaient de nouveau immobiles.
« J’ignore ce que c’était, mais le danger est passé. Tu peux redescendre. »
La huppe poussa un gazouillis, qui parvint à exprimer en deux notes tant le doute que l’exaspération. Néanmoins, elle se posa sur la tête de Chih, où elle se balança, mal à l’aise.
« Les protections doivent toujours être en place. Nous sommes très près du lac Écarlate à présent.
-Nous ne serions jamais arrivés si loin si on ne les avait pas neutralisées. »
Chih y réfléchit un instant, puis enfila ses sandales et se glissa sous le cordon de clochettes.
Effarouchée, Presque-Brillante s’envola dans un tourbillon de plumes avant de redescendre sur l’épaule de l’être humain.
« Adelphe Chih, regagne tout de suite le campement ! Tu vas te faire tuer et je serai obligée de rendre compte à notre Céleste de ton irresponsabilité.
-Je compte sur la précision de ton rapport, rétorque Chih d’un air absent. Maintenant, chut ! Je crois distinguer ce qui a fait ce raffut. »
La huppe exprima son mécontentement d’un battement d’ailes mais enfonça plus fermement ses griffes dans l’habit de Chih. En débit de sa bravade, celle-ci se sentit réconfortée par la présence de la neixin sur son épaule et elle leva la main pour lui caresser doucement la crête avant de s’avancer entre les pins.
Vendue pendant sa plus tendre enfance au palais impérial, Lapin passe plusieurs années à laver et récurer les couloirs puis les chambres du palais. Lorsque l’empereur prend pour femme In-yo, fille d’un seigneur du Nord vaincu, Lapin se sent fascinée par cette jeune femme forte et méprisée par le reste de la cour, qui la prend pour une barbare déchue venue de contrées sauvages. Elle l’accompagnera plusieurs années, pendant son séjour au palais puis lors de son exil au bord du lac Écarlate.
Chih, dont la mission est, entre autres, de recueillir les histoires pour tramer la grande histoire, découvrira la destinée improbable de cette femme du peuple qui aura vécu aux côtés d’une impératrice puissante dont les actes transformeront le pays. Au détour de leurs conversations provoquées par la découverte d’objets disparates disséminés dans la maison, elle apprendra le grand intérêt de l’impératrice pour les voyants et autres devins, la surveillance constante dont elle faisait l’objet de la part du pouvoir impérial, la sororité qui grandira entre Lapin et elle, mais aussi avec les dames de compagnie qui ne feront que passer à Fortune-Prospère, afin d’éviter justement, de trop grands liens.
Cette novela, premier tome des Archives des Collines-Chantantes, nous entraîne dans un monde qui mêle traditions, folklore et géo-politique aux résonances chinoises et sud asiatique, peut-être lao ou vietnamiennes. Derrière cette forme courte qui se lit avec facilité, sous ses allures de livres de souvenirs décousus, Nghi Vo nous raconte surtout la résistance d’une femme face à la domination de son peuple et sa lutte pour survivre malgré le danger qu’elle représente. Elle nous montre aussi comment la grande histoire, celle qui pourrait être la plus importante, celle de l’impératrice, prend un sens complètement autre quand elle se reflète dans celle de Lapin. Elle parle enfin, à travers l’adelphe Chih et son oiseau, de la transmission et de l’importance égale des récits pour avoir une vue la plus grande et la plus complète possible des vies, dans leur complexité et leurs variétés.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mikael Cabon
Éditions L’atalante
120 pages