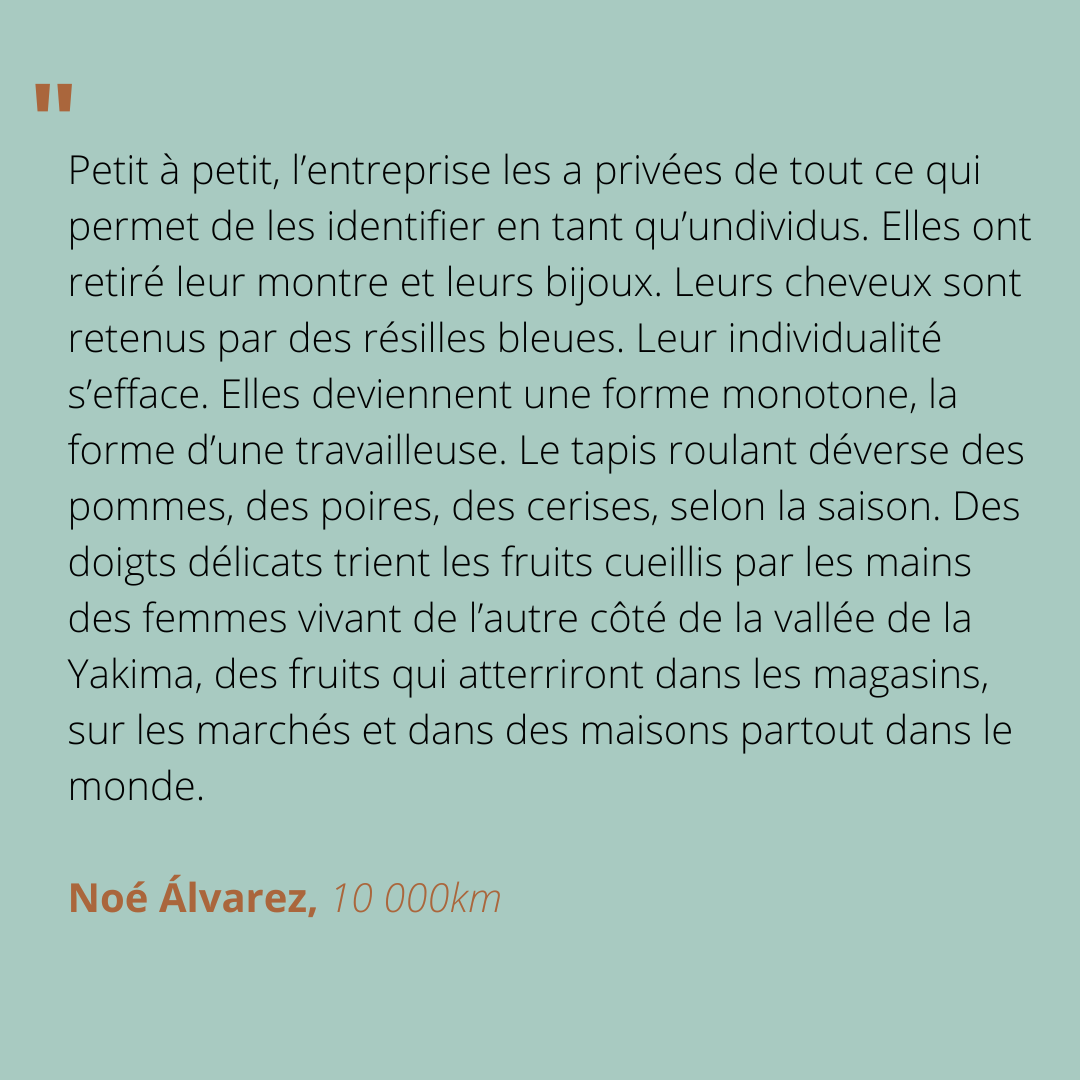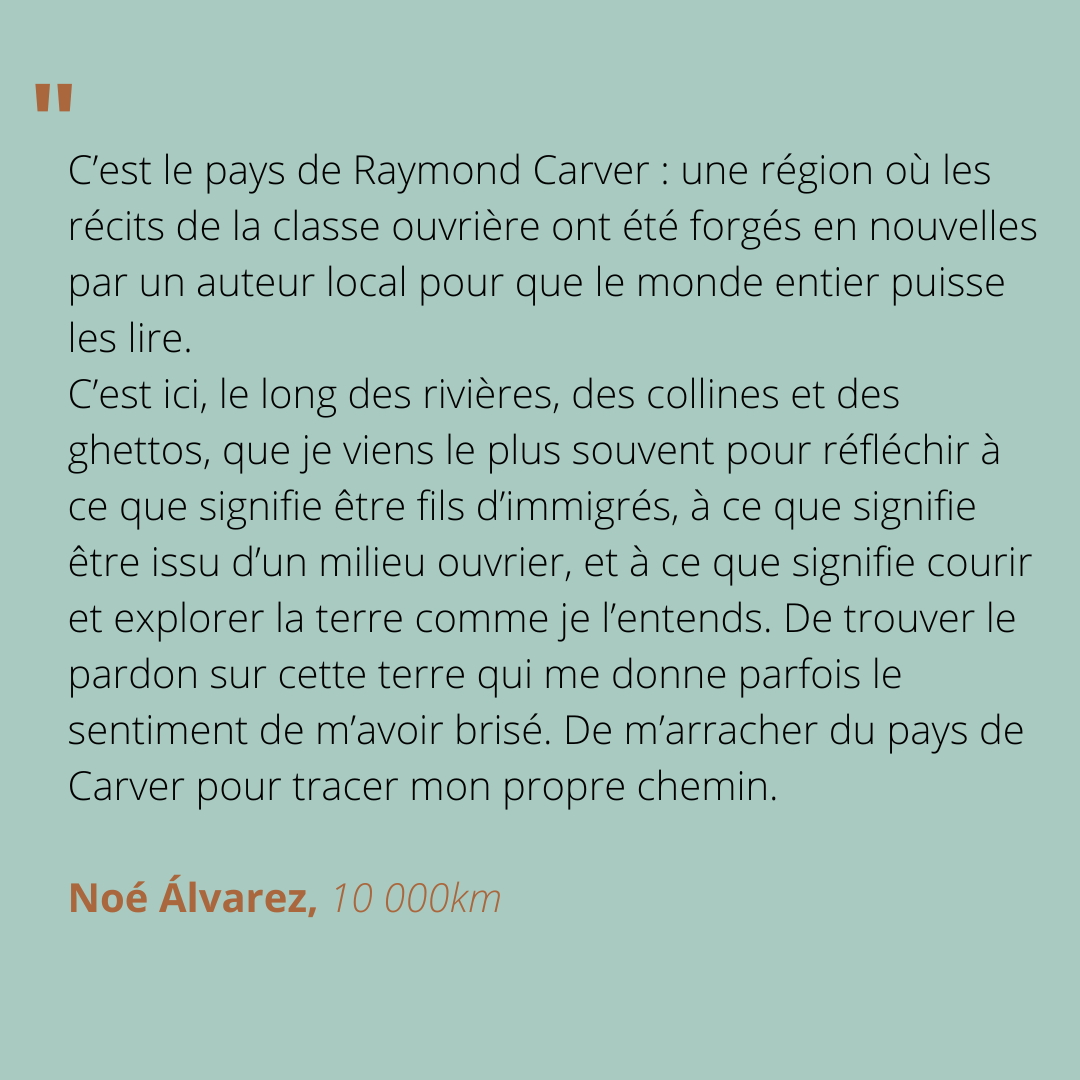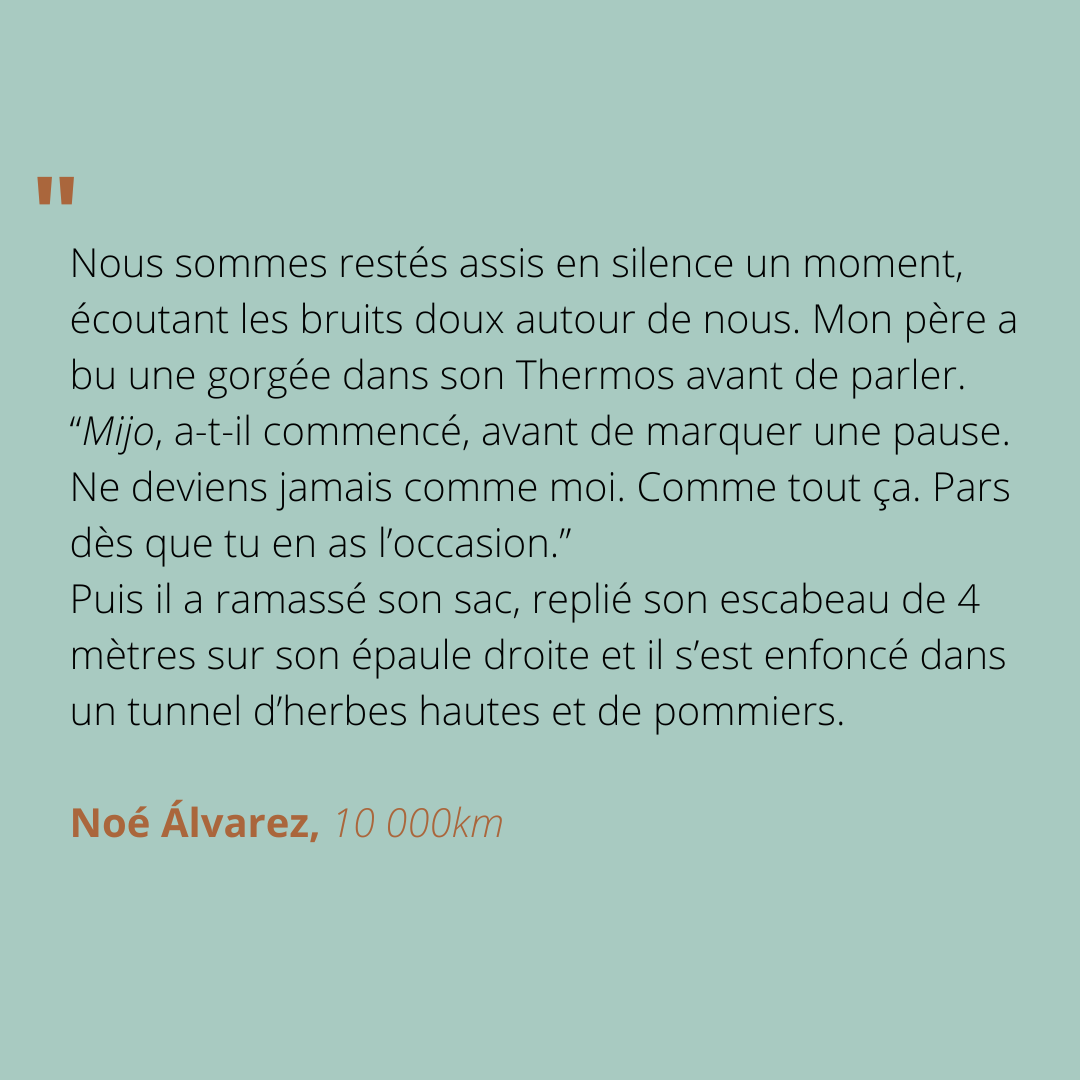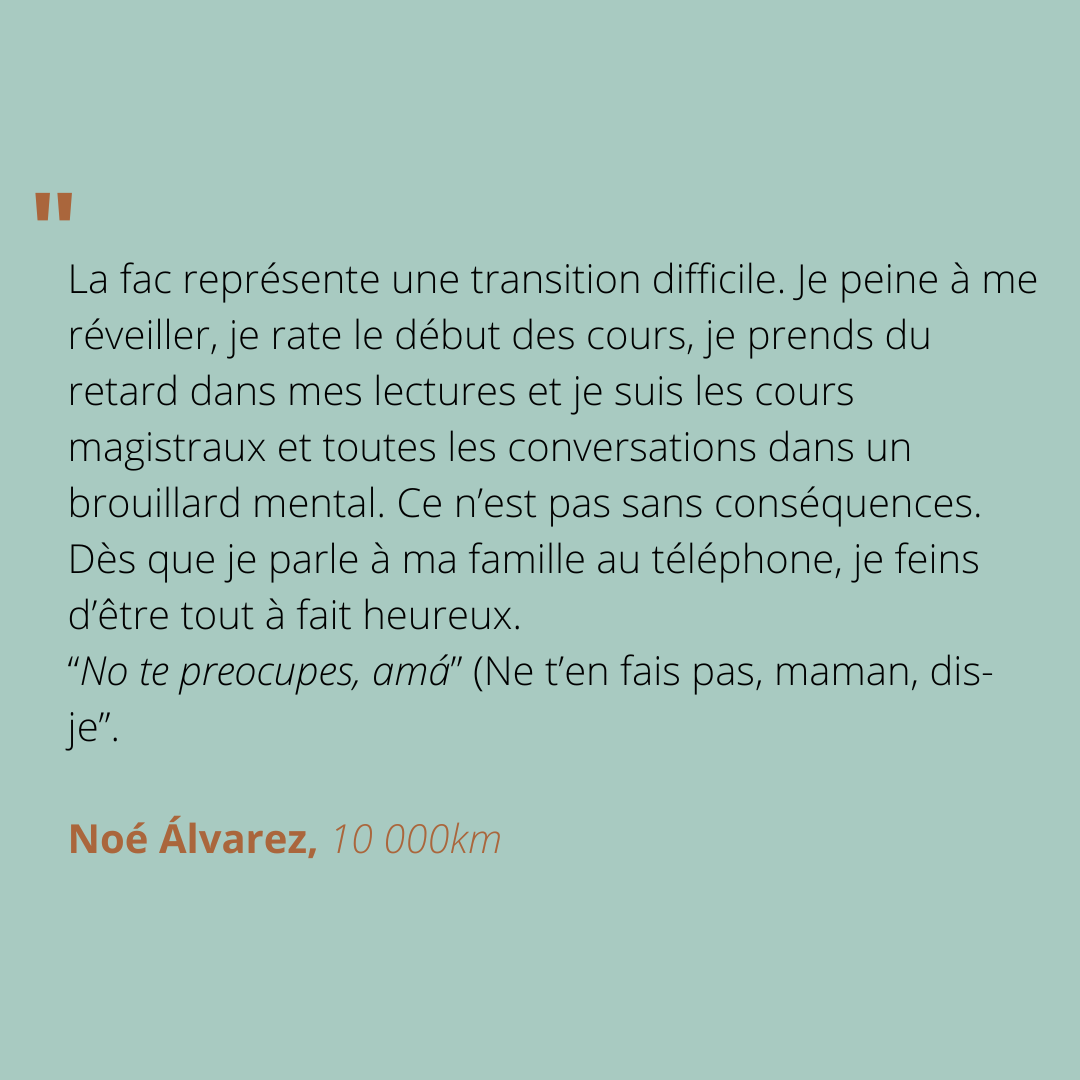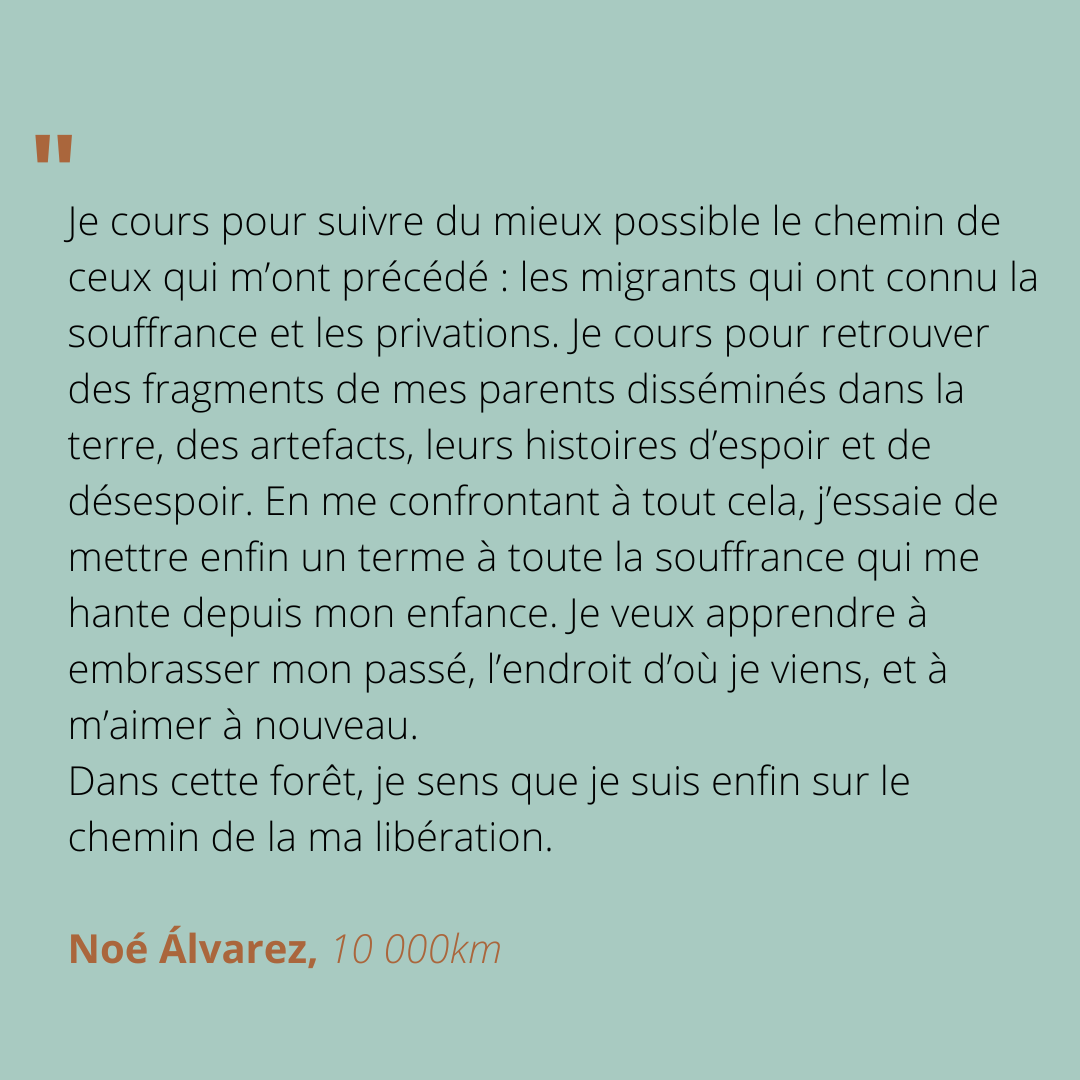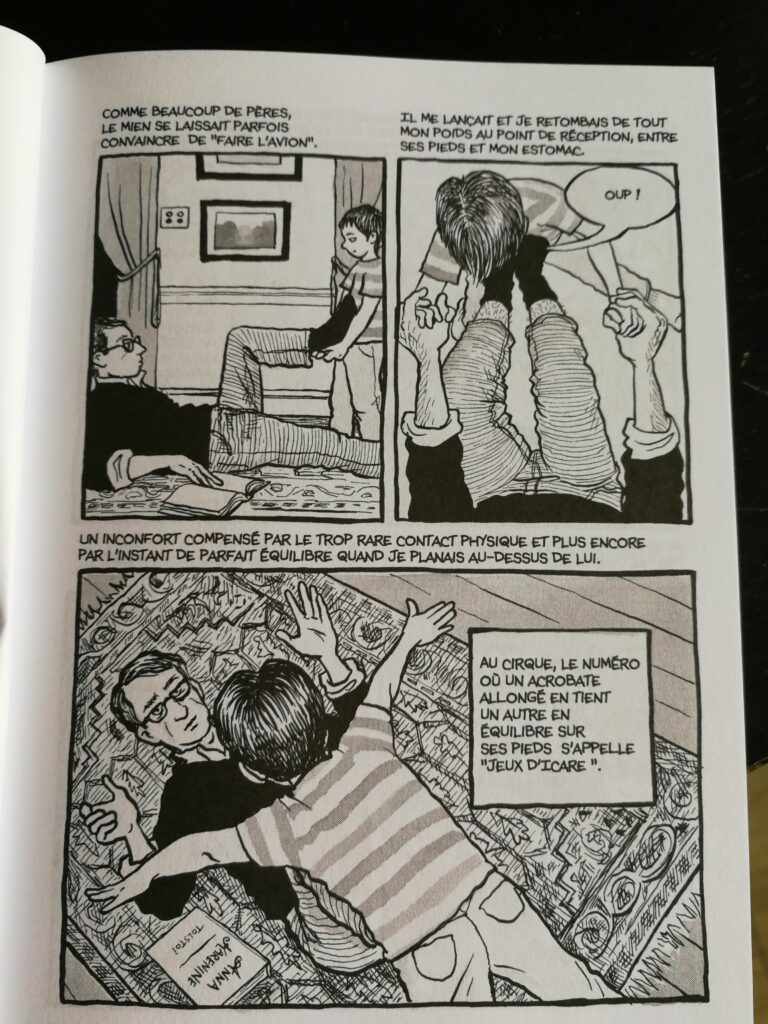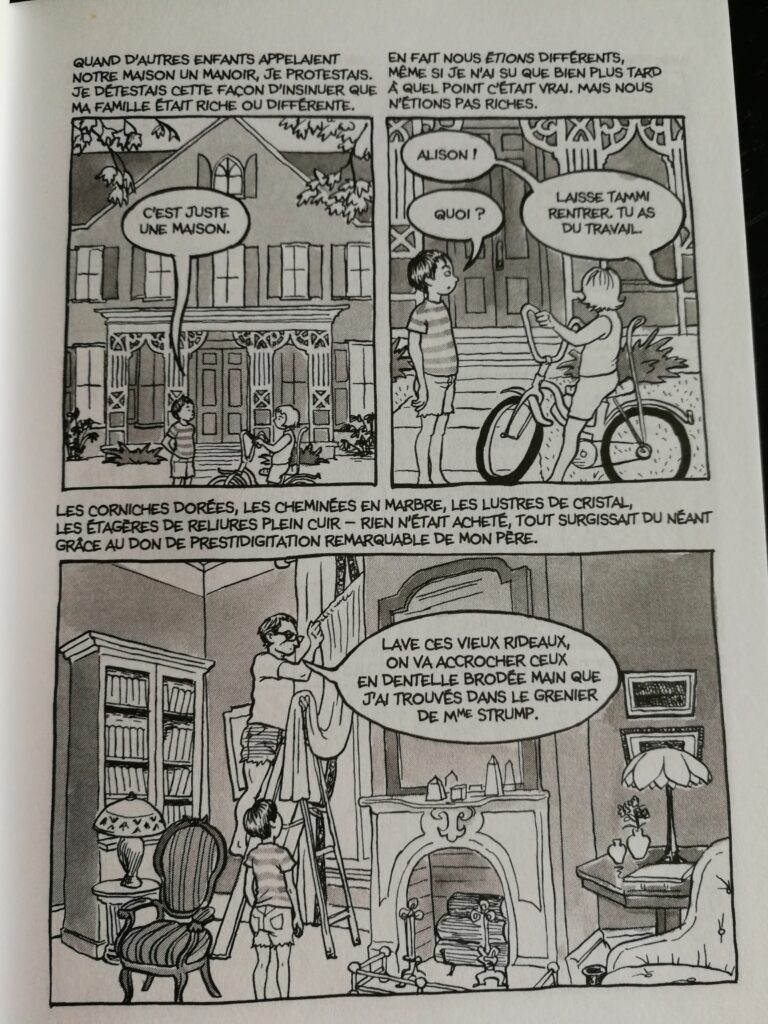Dar Duchesne était d’abord une Corneille on ne peut plus normal, vivant avec ses parents et sa fratrie, retrouvant les siens au dortoir en hiver et nichant, chassant en été. Jusqu’à ce qu’il aperçoive, s’étant aventuré plus loin que d’habitude, des animaux particuliers, nouveaux, debout sur leurs antérieurs, sans poils et munis de bâtons. Dar Duchesne vient de découvrir les Humains. La curiosité le pousse à s’en approcher, à observer, à vouloir comprendre qui ils sont et comment ils vivent. Il deviendra l’ami de Toque de Renard, une jeune fille promise à un grand destin dans sa tribu. Et Dar Duchesne, suite à cette première rencontre, va entrer lui aussi dans la légende des Corneilles, mais aussi des Humains, au fil de ses nombreuses vies.
Une grande montagne s’élève au bout du monde. Cette montagne n’est pas haute mais elle est longue et large – et grande pour la bonne raison qu’elle s’offre toute seule à la vue sur une plaine sans aucune autre à la ronde. Autour d’elle se déploient des routes droites et des terrains meubles – les cailloux y sont même rares, et la montagne n’est pas constituée de roches.
Elle continue de grandir, et elle grandira encore longtemps avant de stabiliser. À l’approche de l’aube, un bulldozer jaune en parcourt la pente, qui en tremble sous le poids, car le matériau de la montagne est encore mou et branlant. Aux premières lueurs du jour, de gros camions la gravissent à la queue leu leu sur des sentiers transversaux tracés pour leur usage, et, à des emplacements choisis, vident leur chargement par l’arrière en des tas fumants. Que le bulldozer disperse puis étale peu à peu.
Ils brûlent en partie.
Corneille ethnographe, Dar Duchesne, avant que d’avoir un nom et de devenir un mythe, était déjà une Corneille particulière. Peu avait sa curiosité, ses réflexions, son trouble devant l’étrange. Peu dispos à se conformer à la vie routinière de ses semblables, il est prêt à sacrifier ce que vers quoi le poussent son instinct et ses sentiments pour comprendre ce qui le brasse sous les plumes. Dans l’épaisseur des forêts, sous le couvert d’arbres déjà centenaires, il se rapprochera d’Humains aussi étonnant que lui, avec lesquels il partira défier les conventions, se battre contre des démons, s’échapper de l’enfer. Il apprend la langue des Humains, qui apprennent aussi la sienne, devient guide, fantôme, conscience ou menace. De sa branche haut perché, il tente de comprendre ce qui motive ces animaux étranges qui croient en un être supérieur qui régit leur destinée ou souhaitent s’abolir des frontières de la vie, quand bien même ils semblent croire leurs défunts toujours avec eux.
Naïf dans ses quêtes, non par bêtise mais par mécompréhension des mécanismes complexes de la psyché de ses compagnons à deux pattes, il devient le démon de mystique, chamane, conteur, et peuple leurs histoires et leur légende de sa présence inquiétante, Corneille immortelle ou symbole rémanent d’une altérité idéale. Au fil des siècles, il voit et vit les évolutions des sociétés humaines, le mal qu’ils se font, leur éloignement d’avec la forêt, la nature et leurs propres mythes. Allant plus loin qu’aucune autre Corneille avant lui, il rencontrera de nombreux Animaux et fera sa propre expérience de la diversité du monde, des variétés de coutumes qui séparent et unissent les espèces et de la rudesse des éléments. Il endure aussi la mort de celles et ceux qu’ils aiment et côtoient, et doit se confronter avec ce statut de mortel dont il s’est échappé.
Peut-on encore appartenir à son peuple et son espèce lorsque l’on est devenu un mythe ? Ses actes restent, dont on perd les origines pour ne garder qu’une trace fine, une rayure dans le ciel, « une Corneille, un jour, a su « . Dar Duchesne, le premier à avoir proposé aux Corneilles de choisir un nom unique, d’exister par soi en sus de par le groupe, s’isole du fait de sa multiplicité. Vie après vie, il se construit en autre que lui-même, devient une trame, un réseau d’histoires dans lequel il se répercute, se cherche et se retrouve, plume par plume, disséminé dans l’histoire de l’humanité et des corvidés, maille vive des récits fondateurs et pierre angulaire d’une mythologie du Vivant.
L’Humain qui nous conte cette histoire, chez lequel Dar Duchesne s’est réfugié, nous parle aussi de son temps, de son territoire dévasté, pollué. L’histoire de la Corneille résonne dans son quotidien, d’autant plus devant les destructions faites par les Humains dans les dernières décennies.
Si Dar Duchesne s’écarte du Vivant par son incapacité à mourir, qu’en est-il des Humains, mortels mais égoïstes et mortifères ?
Sur le chemin de l’Ymr, John Crowley traverse les mythologies, d’Orphée au Coyote des peuples premiers d’Amérique via le folklore irlandais. Il nous fait naviguer sur le fleuve qui sépare les vivants des morts, osciller entre les deux mondes, poreux et exclusif, en attendant le passage du Passeur.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrick Couton
Éditions L’Atalante