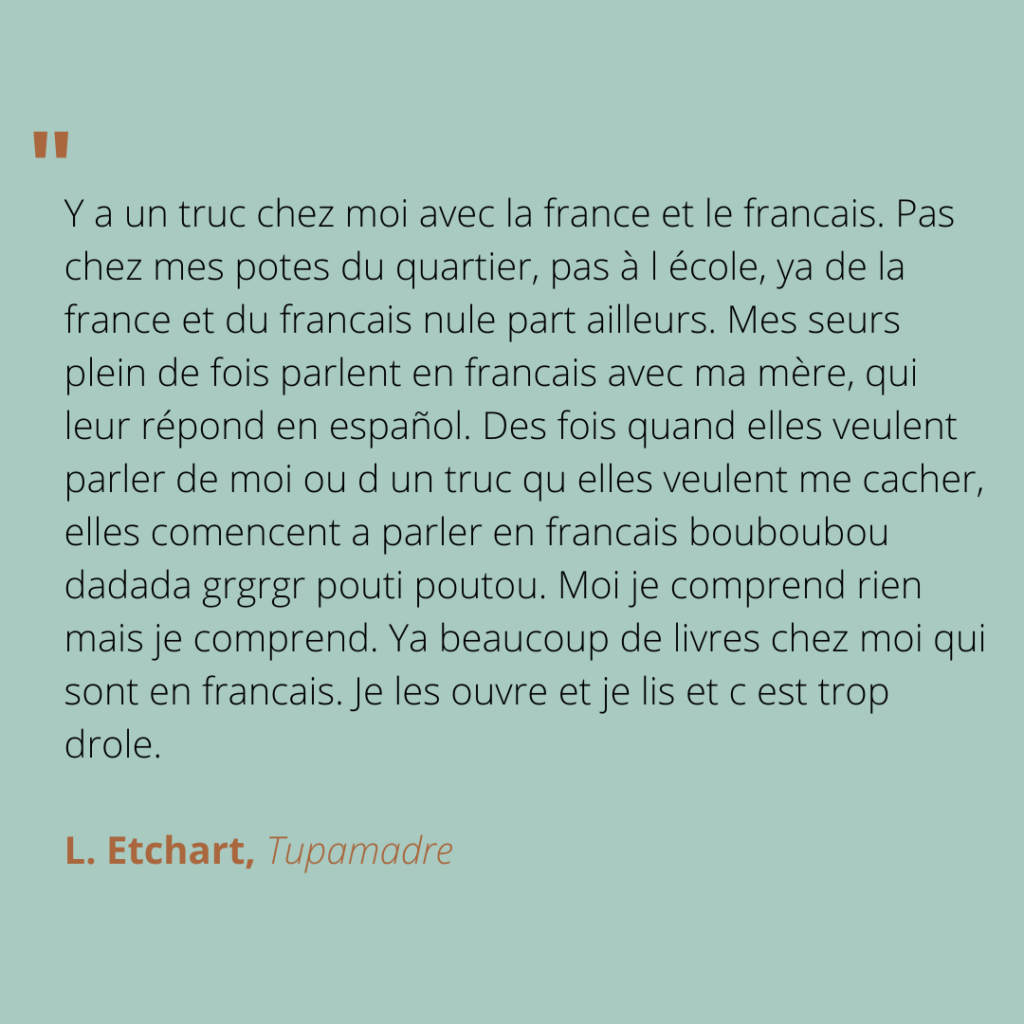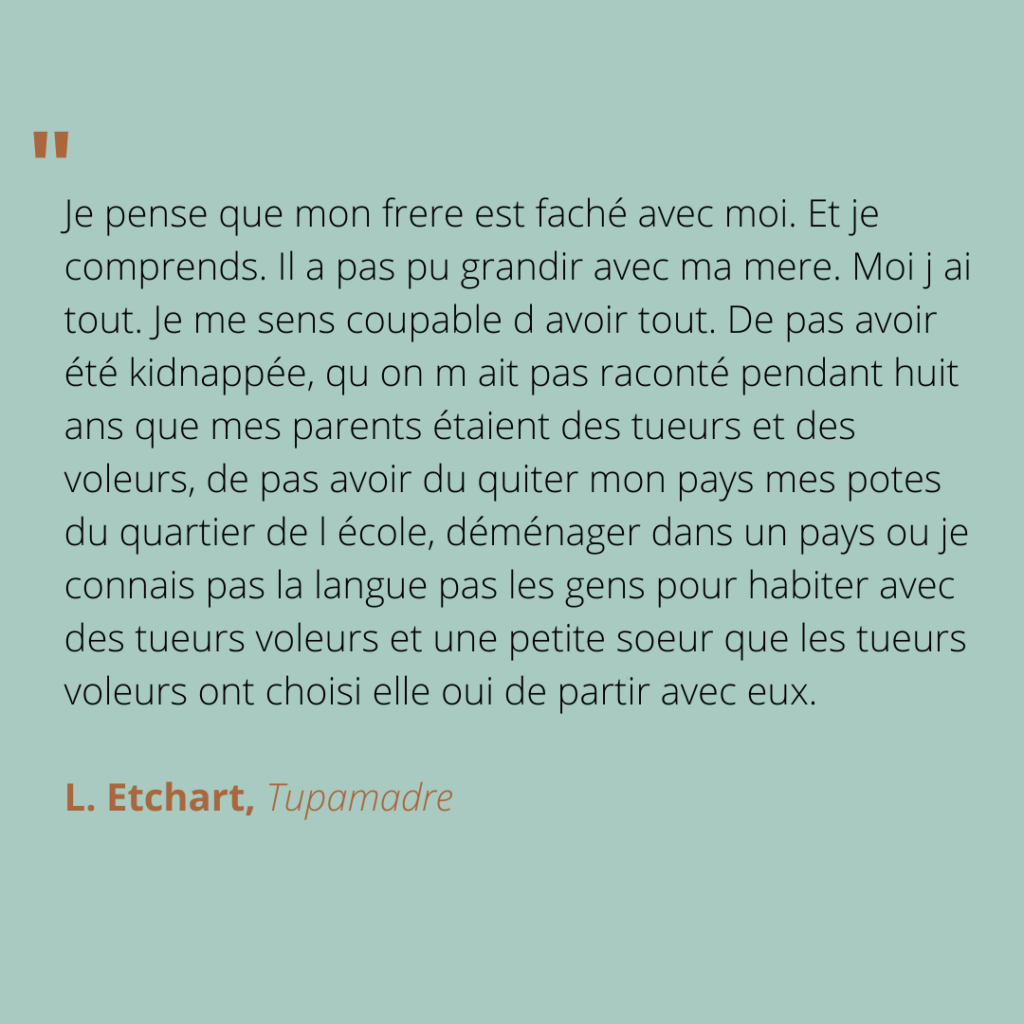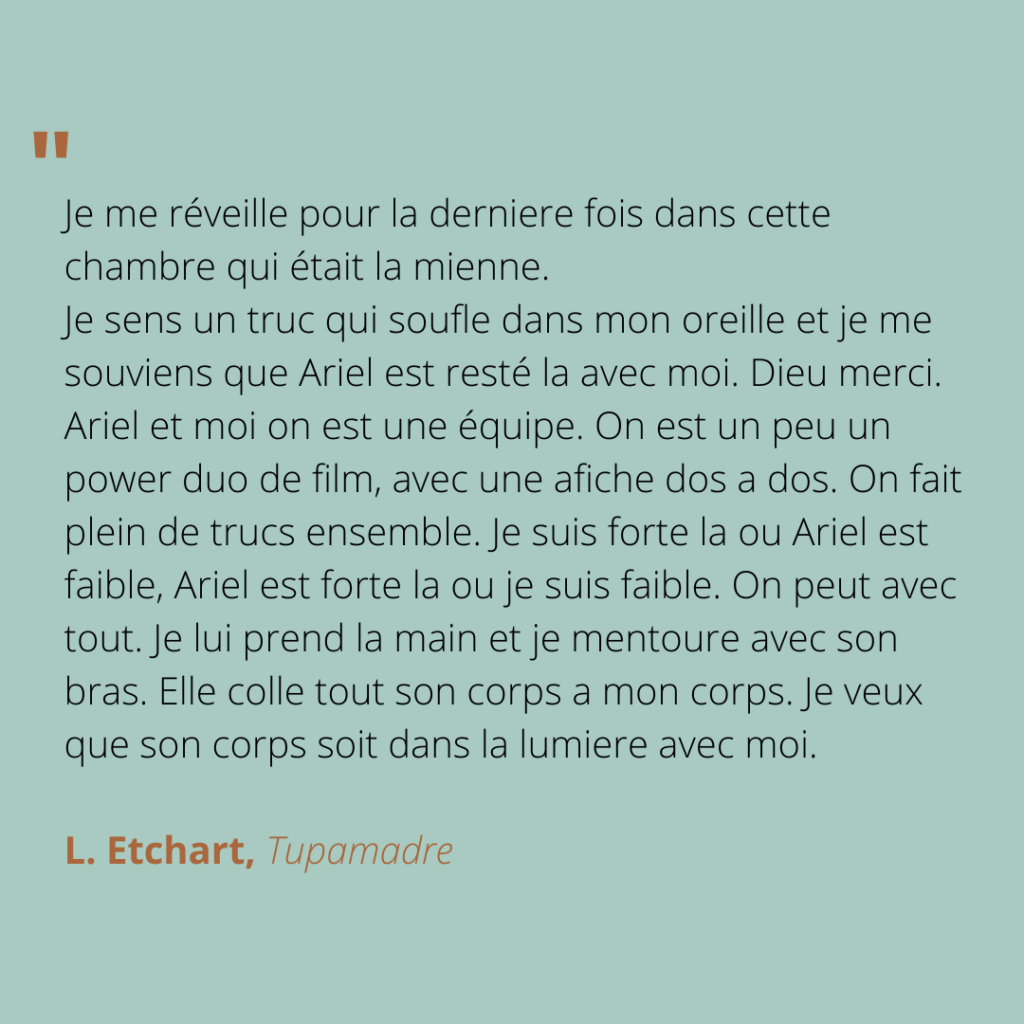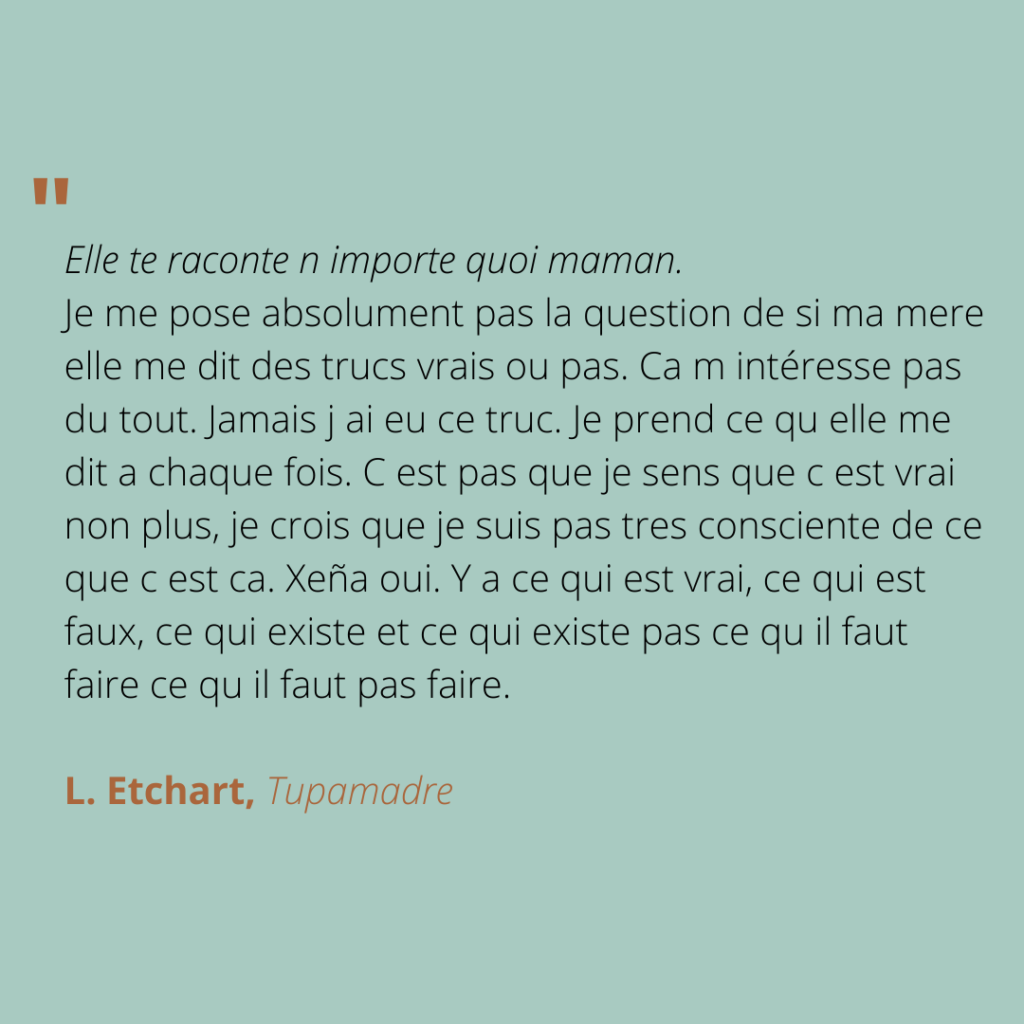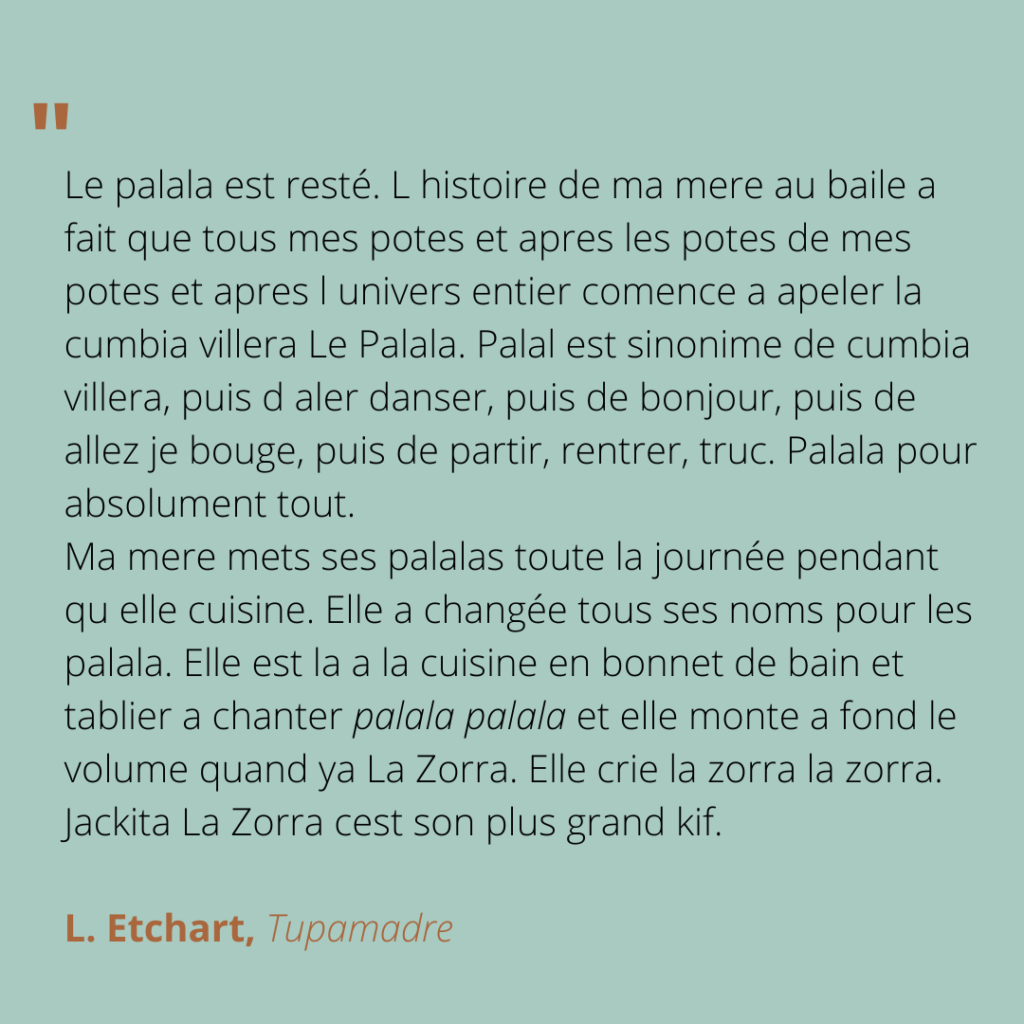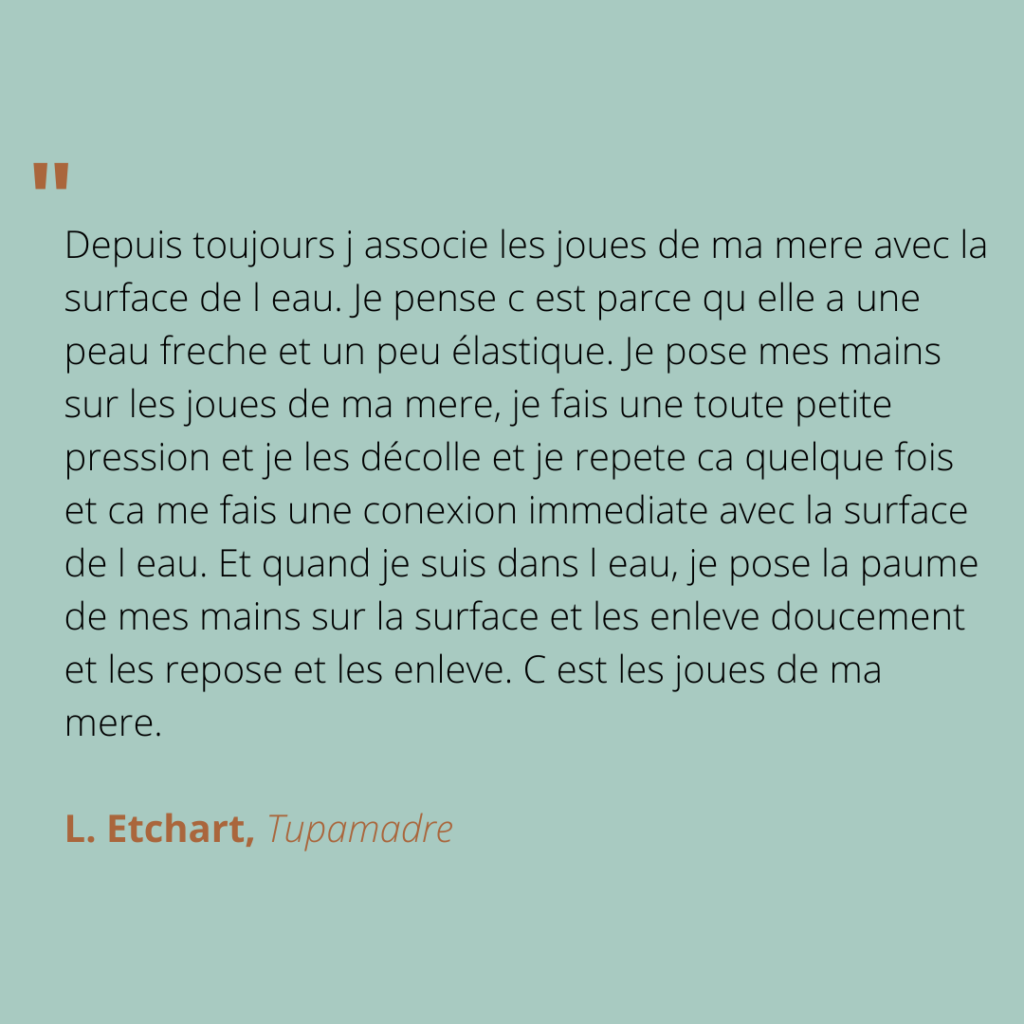Bellatine et Isaac Yaga ne se sont pas vus depuis longtemps, depuis que le grand frère a quitté le domicile familial, et sa petite sœur, pour aller vivre la vie de hobo sur les routes et chemins de fer des États-Unis. Lui écume le pays en bonimenteur de foire, elle s’est établie tout juste comme menuisière dans le Vermont. Un beau jour, un courrier bien étonnant les rassemble sur le port de New York. Une arrière-arrière-grand-mère ukrainienne, la dernière génération avant la migration aux États-Unis, leur a légué quelque chose à tous deux, ses plus jeunes héritiers. C’est avec, au choix, horreur, stupeur et amusement, que les deux Yaga découvrent sur les docks new-yorkais une caisse immense et, dedans une maison de type forestière, dressée sur deux puissantes pattes de poulet.
Voyez : c’est Kali tragus, le soude-bouc, ou chardon de Russie. Une plante qui tient de la masse échevelée, des fleurs vertes qui se font aussitôt feuilles de la même couleur. Tige striée de rouge et de violet comme un poignet couvert d’ecchymoses. Les feuilles, donc, sont bordées d’épines aussi acérées que des aiguilles à coudre. Ne les maniez qu’avec des gants -ou ne les touchez pas, c’est préférable. Si les épines vous déchirent la peau, faites celui ou celle qui n’a rien senti. L’époque n’aime pas les geignards. Il y a de pires blessures que celle que vous inflige le chardon. Vraiment pires, bien pries.
Le chardon de Russie se gorge de vie dans les climats les plus arides. Il prospère en terre inquiète -s’épanouit dans des lieux d’anormale violence. Dans les blés incendiés. Les champs assoiffés. Les terres fertiles ravagées par la maladie. Rien de cela ne l’empêche de survivre. De croître et de se multiplier. Croître, oui, de dix centimètres à près d’un mètre. Après sa mort, il se brise à ras du sol et voyage par le monde, semant ses graines en tout lieux. Le chardon se déplace comme une bête vivante, virevolte et valse dans le vent d’été, lèche la poussière et danse le shimmy dans les espaces désarticulés.
Isaac et Bellatine sont des descendants de Juifs ukrainiens qui ont fui les pogroms et gagné, comme des milliers d’autres, une terre promise (parce qu’il paraît qu’en Amérique, il n’y a pas de chats). Mais de cette histoire, si ce n’est un nom de famille peu anglophone, un judaïsme pas très prégnant et un théâtre de marionnettes familial aux histoires teintées de folklore slave, ils ne savent pas grand-chose. L’arrivée impromptue de cette maison centenaire dans leur vie moderne les plongera brusquement dans ce passé, car la maisonnette est traquée par un danger qui semble venir de loin.
Lectrice, lecteur, chardon qui échappe à ma peau, si tu as la flemme de lire plus avant, arrête-toi là et va chercher ce livre, parce que vraiment c’est un plaisir sans fin. L’histoire est passionnante, l’écriture superbe et le tout très intelligent et touchant. Voilà. Tu peux aller dans ta librairie/bibliothèque la plus proche.
Sinon, pour creuser un peu plus, quand même, c’est ci-après.
Il se nommerait Ombrelongue, celui qui recherche la maison. Homme au charme un peu suranné et à l’accent russe aussi désuet que plaisant, il aborde avec amabilité les inconnus avant de les envoûter, faisant ressortir leurs peurs les plus grandes et les rages enfouies. Violence, aveuglement et pulsion sont ses étendards à travers les années et les continents. Mais pourquoi court-il donc après cette maison qui court ? Est-ce une traque ou des retrouvailles ? Bellatine et Isaac, rejoints par Rummy, Sparrow et Shona, membres d’un groupe de folk underground, puis par Winifred, vont devoir apprendre à se faire confiance, découvrir l’histoire de leur famille et des histoires qui peut-être les entouraient dans le silence depuis longtemps.
La référence à Baba Yaga est évidente, de l’isba jugée sur ses deux pattes de poulet au nom de famille de nos héros. Mais plus qu’une référence à une légende en particulier, c’est à tout ce qu’elle pourrait synthétiser et représenter que s’attache, me semble-t-il, GennaRose Nethercott. C’est à un folklore slave ici intégré et partagé par les communautés juives d’Europe centrale et de l’Est, et qui s’imprègne à son tour de l’histoire de ces shtetls qui ont vu les flammes des pogroms ravager leurs vies, avant que le tambours ne changent de rythme et d’origine mais pour le même destin poussé par la même haine.
L’histoire de nos héritiers alterne avec l’histoire de l’isba, contée par elle-même et se jouant un peu de nous. Saurons-nous identifier le vrai du faux, le folklore de l’histoire, l’horreur imaginée de l’horreur réelle ? Qu’est-ce qui aura le plus de poids et au final le plus d’importance ? L’histoire de Baba Yaga est multiple (on en parle d’ailleurs pour et dans ce livre-ci) et ses symboliques variées, selon qui conte et ce qu’il veut dire. Il faut aussi parfois passer par des souvenirs, des histoires, des racontars, pour retrouver la trame d’un récit perdu dont l’ombre flotte seulement au milieu de bout de contes, de bouts de mémoires qui s’étiolent car plus personne ne les garde. La petite isba, dernier souvenir d’un shtetl détruit est désormais la seule gardienne de son histoire et de celle de ses habitants, mais aussi de ce que les hommes se font entre eux, de cette rage aveugle, cette violence brute qui, par un tour de passe-passe aussi incompréhensible qu’insupportable, est capable d’être oublié et de se répéter, ad lib.
Le shtetl de Gedenkrovka porte en son nom le souvenir dont il a besoin pour continuer à vivre, il appelle à lui les témoins, les héritiers qui pourront se rappeler et dire que la violence la plus sourde, celle qui finit dans un océan de flammes, commence bien avant les premiers cris et les premières armes.
C’est un hommage aux contes, au folklore, aux histoires qui disent tout pour que l’on oublie rien et qui sont souvent les premières qui doivent être tues lorsque le bruit des bottes et les claquements de talons deviennent trop forts. Avec beaucoup d’humour et de larmes, GennaRose Nethercott et sa poésie nous offre ici un roman absolument superbe, qui se dévore d’un coup et reste longtemps dans l’estomac, la peau et le cœur. On remercie et on rend grâce (on ne le fait jamais assez) au merveilleux travail de traduction d’Anne-Sylvie Homassel, parce que des livres comme ça on ne voudrait pas passer à côté, et nous avons la chance d’avoir des traducteurices qui nous les rendent à leur mesure. Merci.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel
Éditions Albin Michel Imaginaire
523 pages