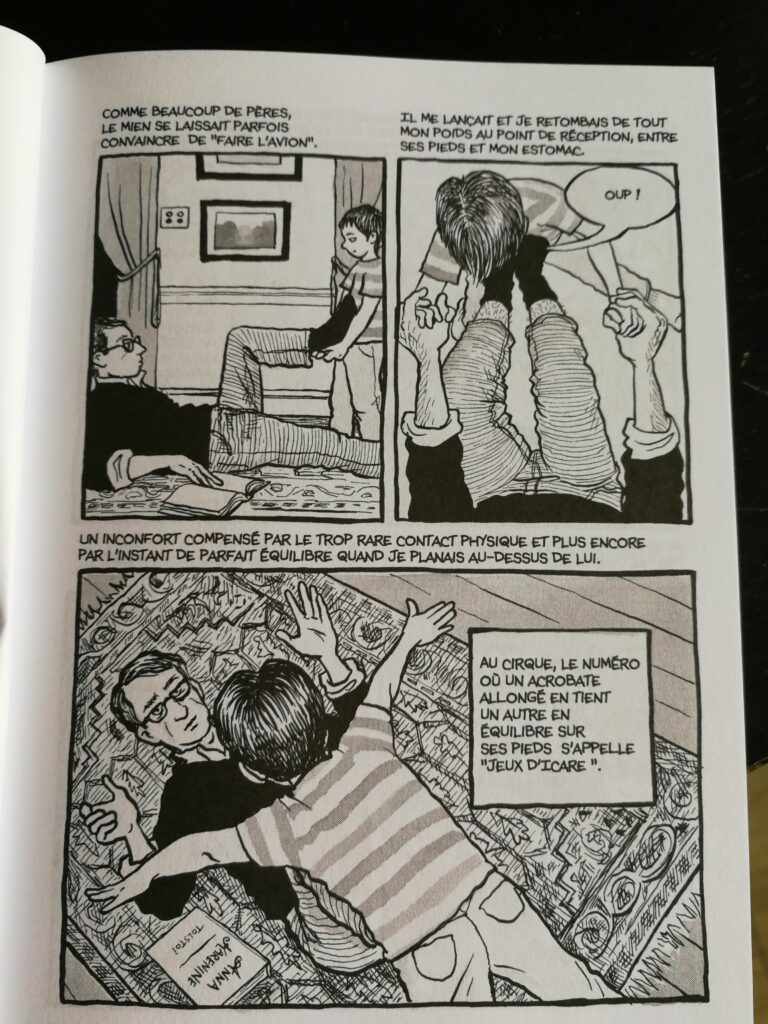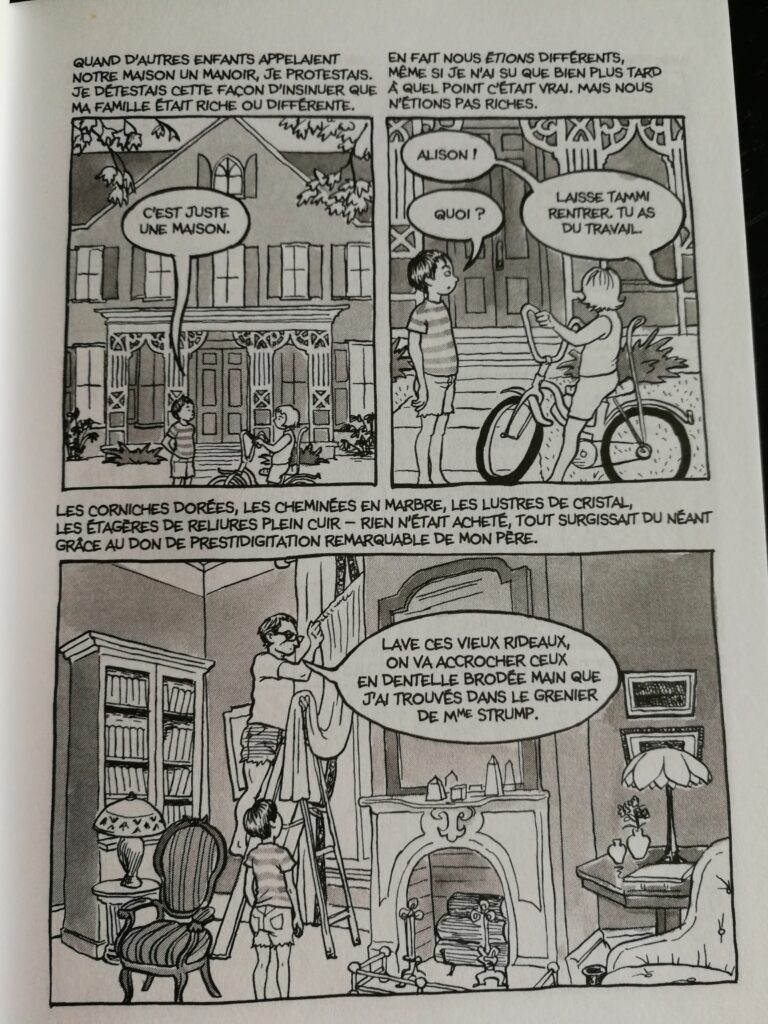Marie de France, bâtarde au sang royal, est venue en Angleterre après la mort de sa mère. Elle vit à la cour d’Aliénor pendant quelque temps, avant que celle-ci ne l’envoie devenir prieure d’un couvent au fin fond de la campagne anglaise. Vue et vécue comme une punition, cette mise à l’écart va se transformer, pour Marie, en une épiphanie qui lui permettra d’exprimer toute sa puissance et ses idéaux.
Elle sort de sa forêt seule sur son cheval. Âgée de dix-sept ans, dans la froide bruine de mars, Marie, qui vient de France.
An de grâce 1158, le monde attend avec lassitude la fin du carême. Bientôt ce sera Pâques, qui vient tôt cette année. Dans les champs, les graines se déploient dans le sol noir et glacial, prêtes à jaillir à l’air libre. Pour la première fois, Marie voit l’abbaye, pâle et hautaine au sommet d’une butte dans cette vallée humide où les nuées venues de l’océan se tordent contre les collines et déversent leurs averses incessantes. La plupart du temps, l’endroit est émeraude et saphir, il éclate sous la pluie, rempli de pinsons, moutons, moucherons, champignons délicats émergeant du riche humus, mais en cette fin d’hiver, tout est grisaille et ombres.
Sa vieille jument de guerre avance d’un pas mélancolique et laborieux, et un faucon merlin frissonne dans sa cage en rotin posée sur la malle, derrière Marie.
Le vent se tait. Les arbres cessent de s’agiter.
Marie a l’impression que la campagne tout entière observe son avancée.
La vie de Marie de France est assez trouble. Je ne te ferai pas l’affront, lectrice, lecteur, ma douce amie, de tenter d’en dresser les faits connus, parce que je suis nulle en histoire de France et en royauté. Ici, Lauren Groff s’appuie sur les faits connus et nous conte sa version de la vie oubliée mais importante de cette femme de poigne. Grande, laide, bâtarde, si l’on écoute les ragot de la cour, Marie n’a pas grand-chose pour elle, si ce n’est d’être malgré tout fille de roi. Lorsqu’elle arrive dans cette abbaye, elle y trouve des nonnes affamées, un cheptel moribond et des caisses vides. Au cours des décennies qu’elle y passera comme prieure puis abbesse, l’abbaye va prospérer et devenir un lieu de culture, de libération, ce qui ne se fera pas sans jalousie.
L’utopie créée par Marie dans son abbaye prend plusieurs niveaux. Quelque peu frondeuse sur les bords, elle s’affranchira sans peur de certaines règles édictées par l’Église : enluminures, gros travaux, confessions… Elle veut donner à chaque femme accueillie dans ce lieu protégée la possibilité de s’épanouir dans ses tâches et de s’émanciper, tout en aidant les villageois, les vilains et donc remplir au mieux leur mission chrétienne. Elle veut aussi montrer à Aliénor ce dont elle est capable, l’éblouir, la charmer, elle, son grand amour. Car Marie est également lesbienne devant l’éternel. Sous sa gouvernance, l’abbaye aura plutôt tendance à encourager les amours saphiques et nos chères nonnes s’en donneront à corps et à cœur joie !
Lauren Groff nous raconte donc la vie résolument rebelle d’une femme incroyable qui aura transformé son exil en bataille pour l’émancipation des femmes et leur protection, la poésie et l’amour. Utopie sororale forte, poétique et d’une grande fluidité, Matrix se lit d’une traite et amène un peu de douceur et d’onirisme dans une époque que l’on imagine violente et écrasante. Marie, femme hors-norme rattachée à la mythique famille Plantagenêt porte en elle la conviction des Croisées de sa famille, la même intelligence politique et stratégique qu’Aliénor avec qui elle gardera un lien fort toute sa vie et l’aura des mystiques, guidée par les visions qui l’habitent. Entourée d’une communauté de femmes pleines de ressources qu’elle tentera de porter à leur meilleur, Marie fera l’expérience des autres et d’elle-même dans la construction et la vie de cette micro-société qui déborde sur le monde qui l’entoure.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Carine Chichereau
Éditions de l’Olivier
301 pages