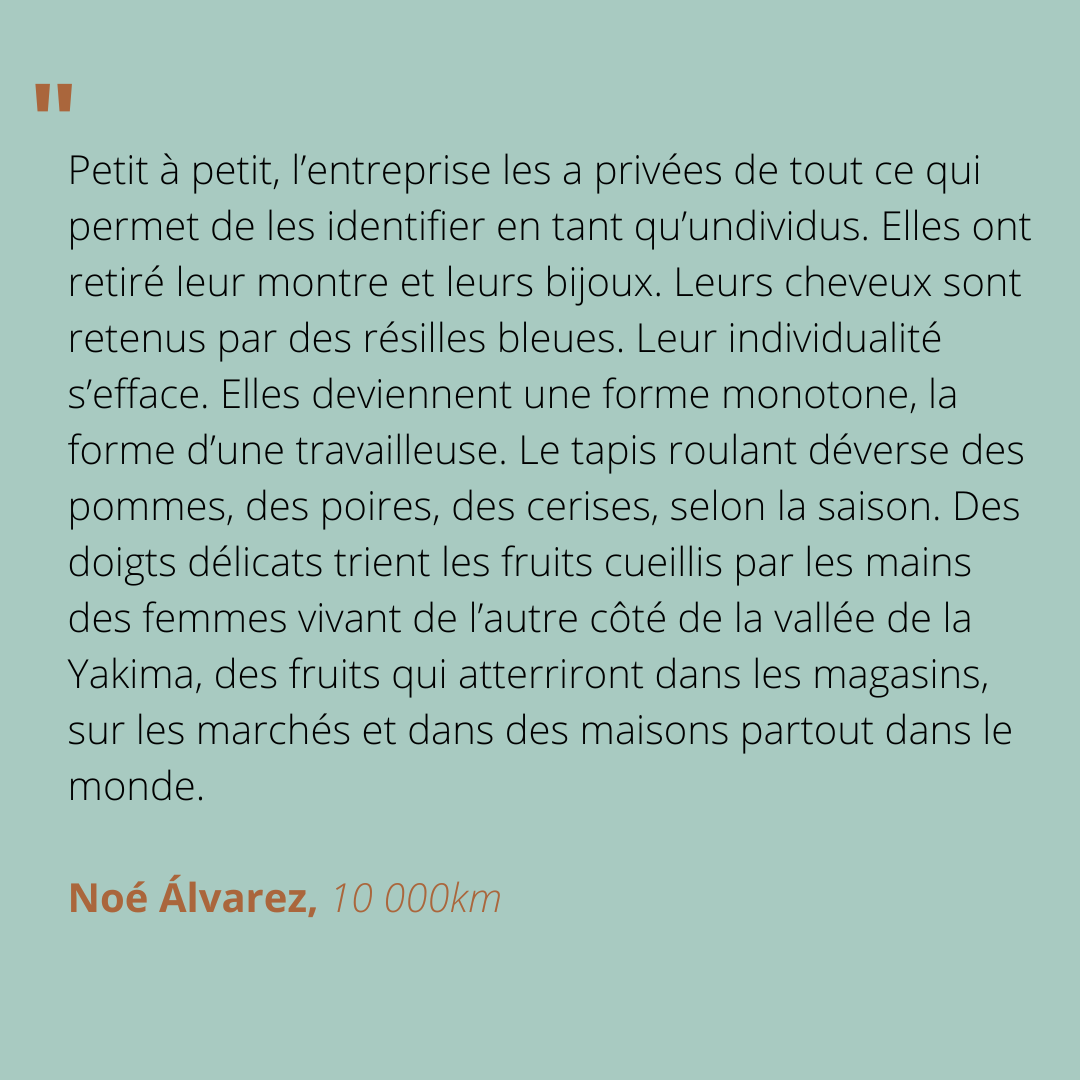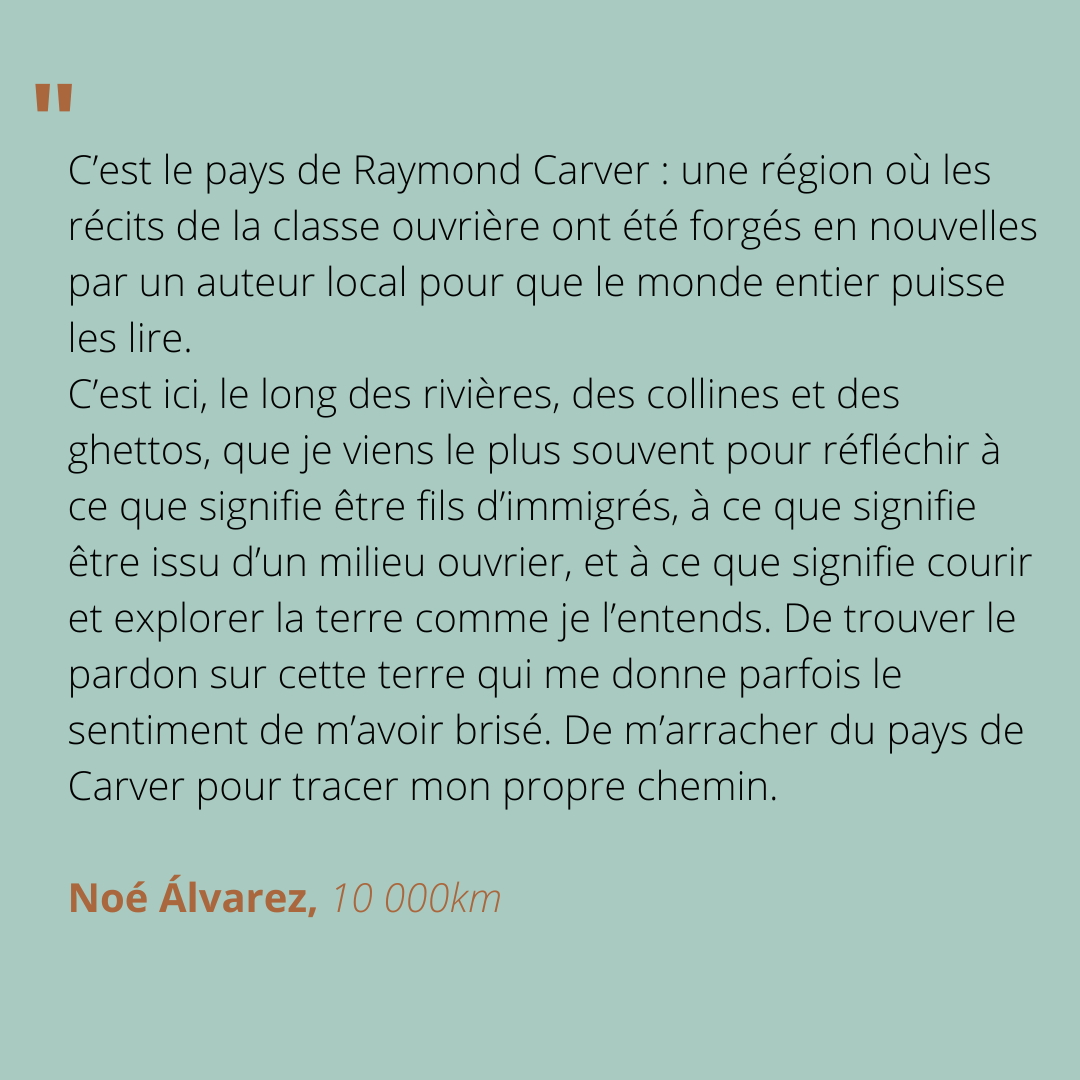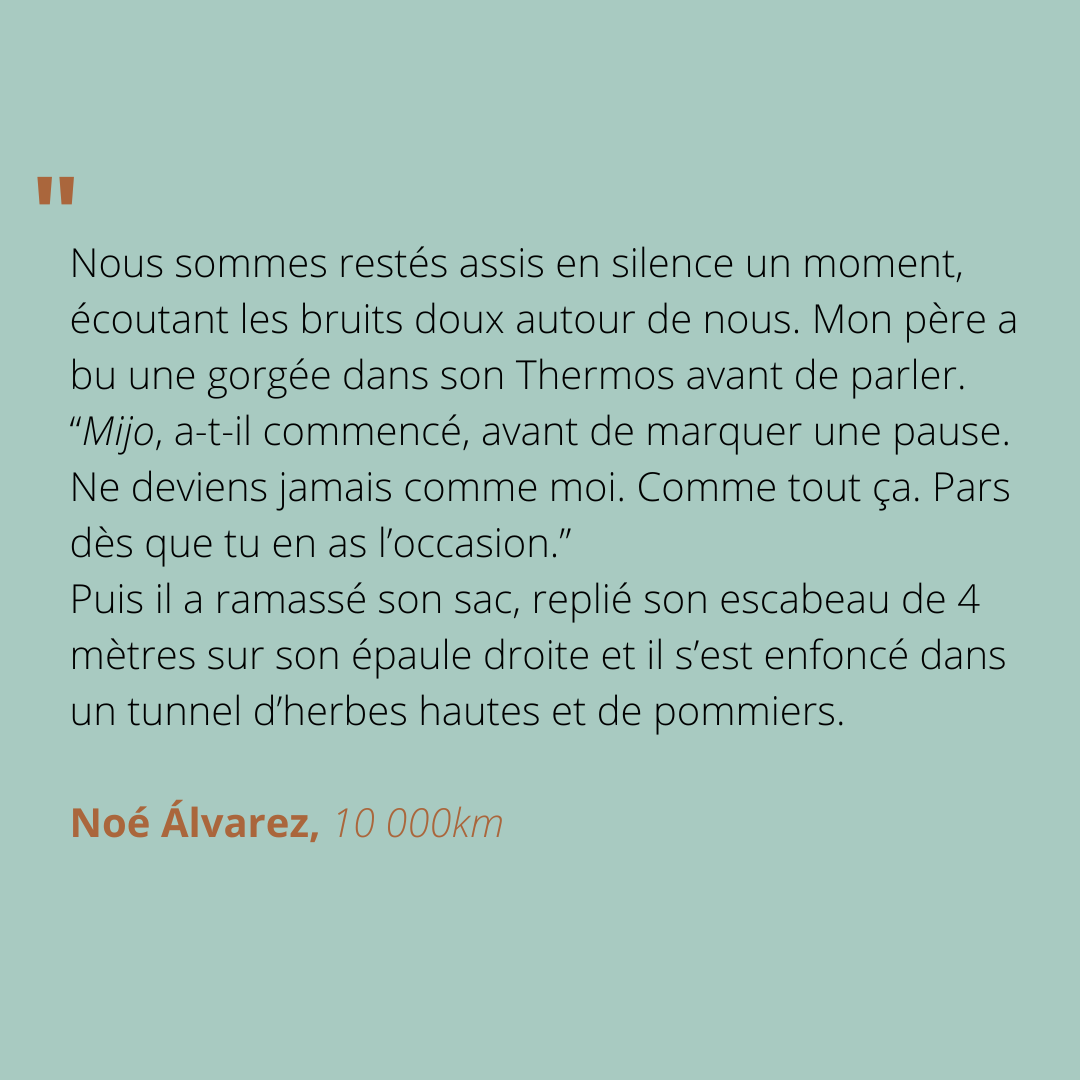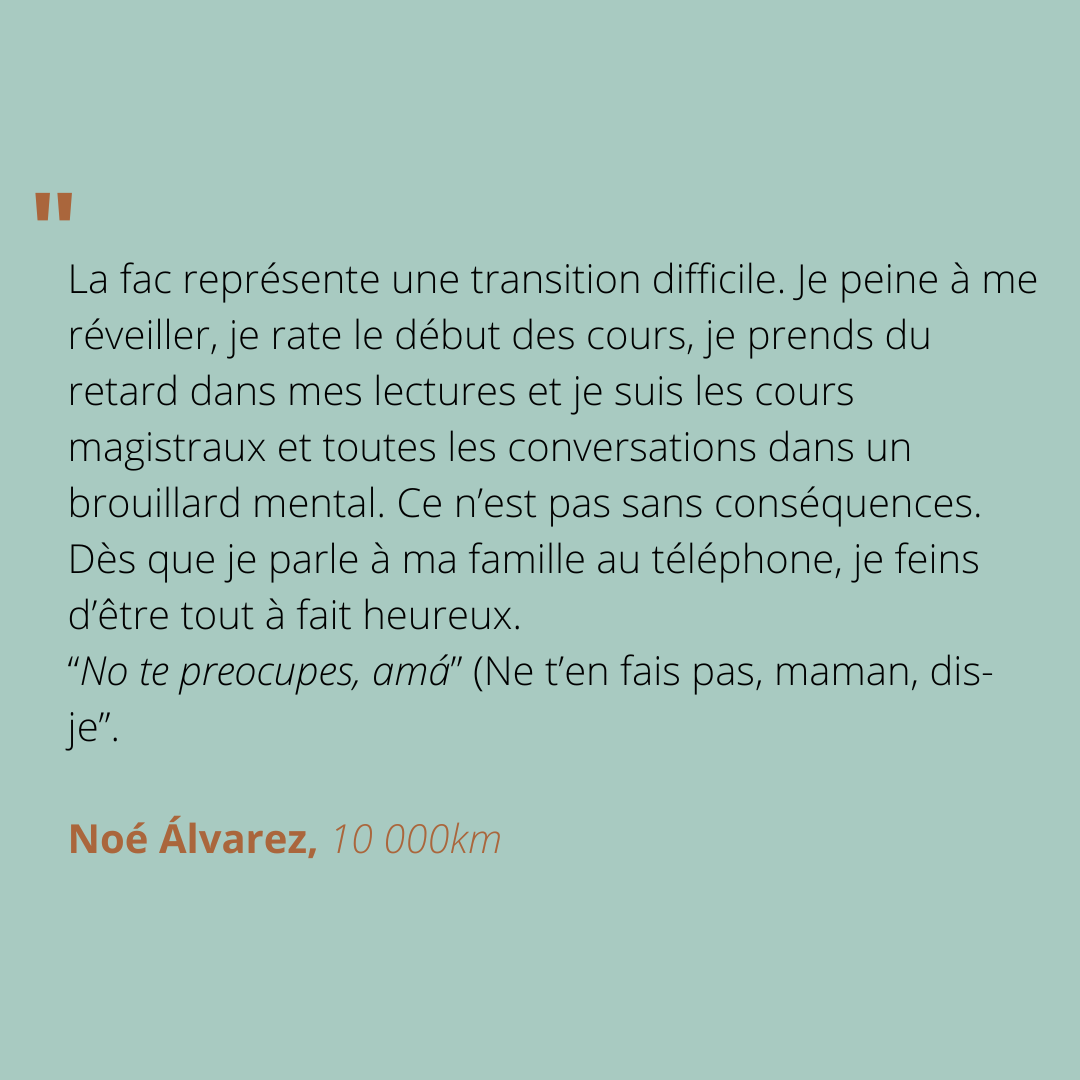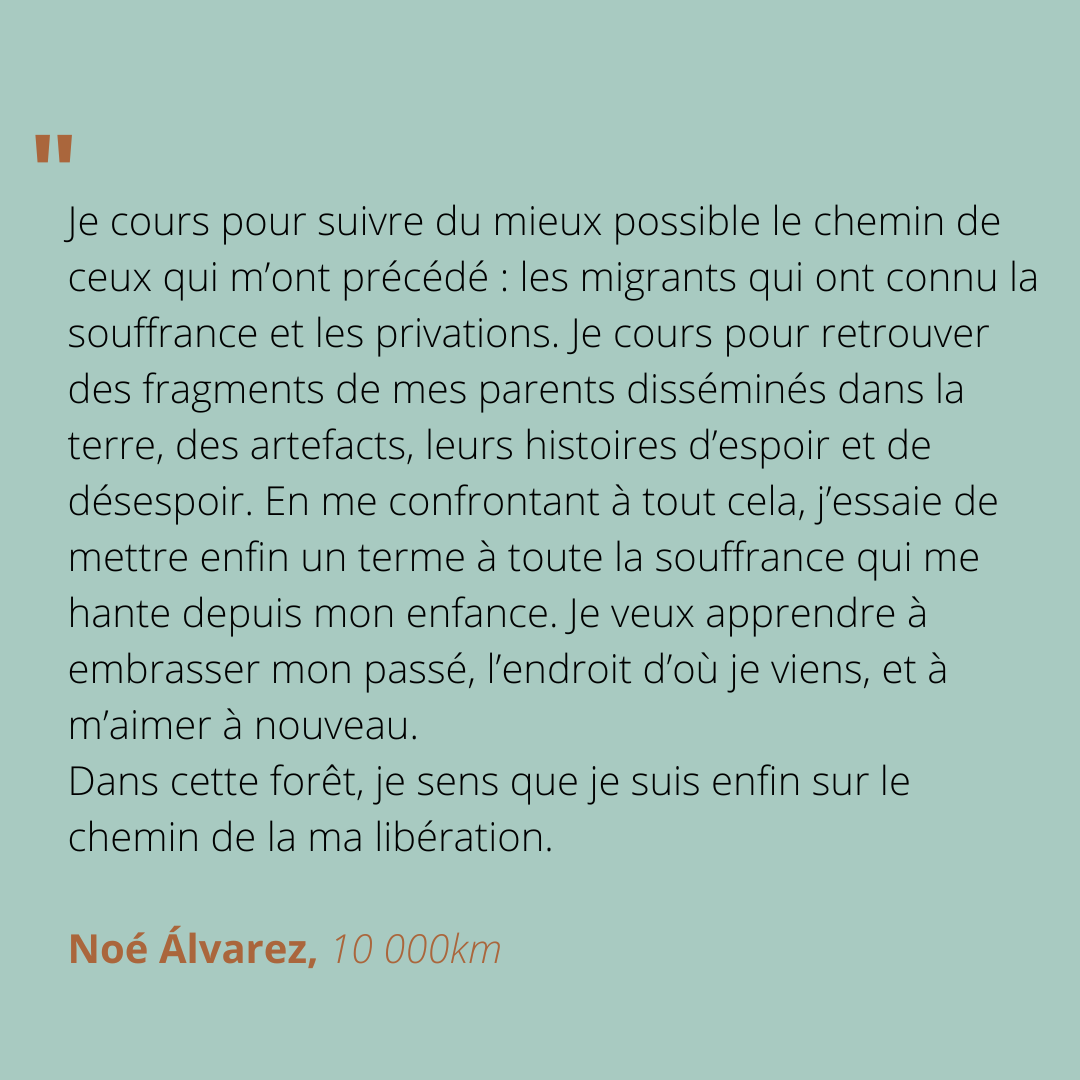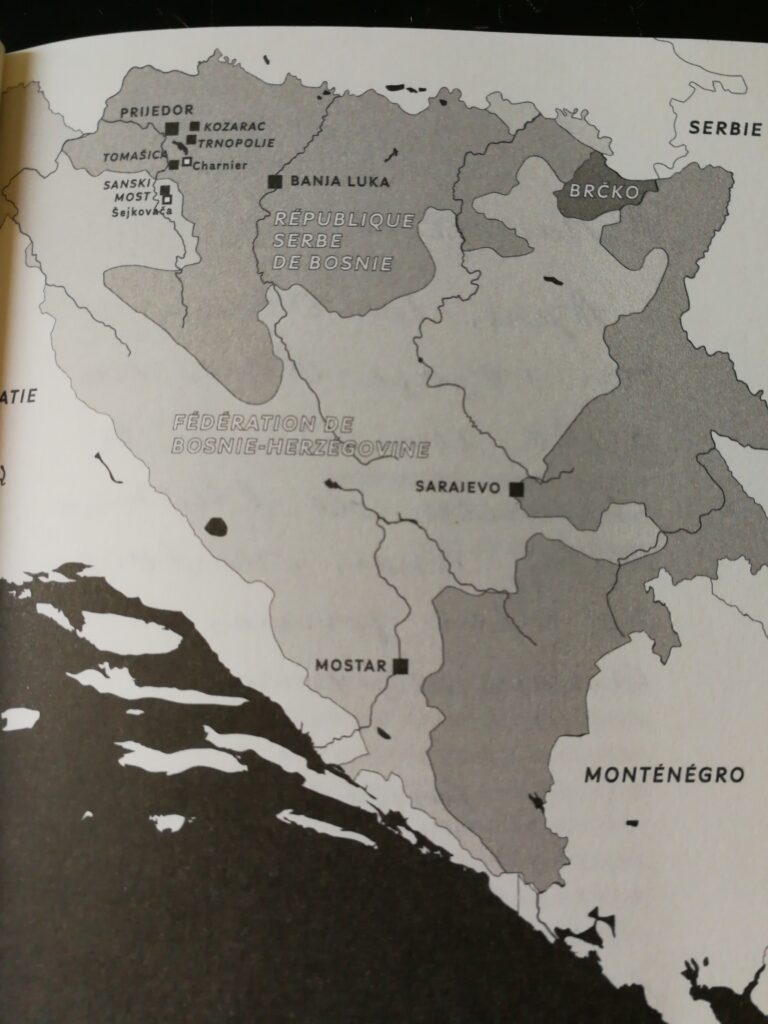Noé Àlvarez est fils d’immigrés mexicains. Né aux États-Unis, dans l’état de Washington, plus précisément dans la petite ville de Yakima, il grandit entre sa famille, les copains, l’école et les boulots d’été dans la plantation de pommes qui fait vivre une partie des habitants du coin. Lorsqu’il décroche une bourse pour aller étudier à l’université, c’est autant une chance, une victoire qu’une insupportable pression. Lâchant prise, perdu dans un monde dont il n’a ni les codes ni les apparences, il décide de rejoindre une expérience folle pour reprendre le dessus. Il va participer aux Peace and Dignity Journeys.
2003. Au milieu des pins, près de la ville de Bella Coola, en Colombie-Britannique, les autorités canadiennes conduisent sous escorte une mère de 17 ans, menottée, pour retrouver et ouvrir la tombe où elle a enterré son bébé quelques jours auparavant. Le nom de la mère -Crow, de la nation secwépemc, le nom complet se traduisant par « vagues d’eau »- se reflète dans ses larmes. Le bébé qu’elle a enterré, son premier-né, a été déclaré mort à 7 semaines. Durant quarante-neuf jours, il a vécu sous le pouvoir d’un nom, sous la protection de la tradition secwépemc qui implique que l’on prenne soin des siens, enveloppé dans les rêves d’une mère qui a chanté pour lui jusqu’à la fin, quand il a cessé de s’alimenter. Craignant que l’hôpital ne le lui prenne, Crow l’a emmailloté dans son tikinagan et s’est enfui avec lui dans la forêt.
Elle se souvient d’une nuit froide dans les montagnes. La pluie tombait dru tandis qu’avec deux autres personnes elle encerclait le garçon en un mur de cérémonie avant de creuser un trou dans la terre boueuse. Les Secwépemcs enterrent leurs morts eux-mêmes. Mais, en ce jour de février, les autorités procèdent à l’excavation du nourrisson, Nupika Amak (« celui qui peut voyager entre deux mondes »), renversant l’ordre sacré par lequel une mère accepte la disparition d’un fils. Ils profanent la terre sous ses yeux- une terre qui a rappelé à elle l’esprit de Nupika Amak- et le ramènent dans ce monde pour qu’il soit enregistré et étiqueté, qu’il reçoive un certificat de naissance et de décès. Puis ils emmènent sa mère en garde à vue pour l’interroger.
On lui demande pourquoi elle n’a pas déclaré la naissance de son enfant : elle voulait que ce soit un enfant de la liberté. Affranchi de l’oppression de l’État.
[…] Ces hommes et ces femmes ne sont que quelques-uns des coureurs des Peace and Dignity Journeys de 2004. Des gens ordinaires, fiers de leur héritage, répondant à un appel qui les dépasse.
Et puis, il y a moi.
Les Peace and Dignity Journeys est un ultra-trail qui traverse toute l’Amérique, de l’Alaska jusqu’à la Terre de Feu. De chaque extrémité du continent s’élance un groupe de coureur-euses et les deux se rejoignent au milieu, plus ou moins, quelque part entre le Panama et la Colombie. Les coureur-euses participent pour quelques jours ou quelques semaines, selon leur capacité, et se relaient sur la journée pour des runs allant jusqu’à 35 km afin de couvrir le plus de distance possible. L’hébergement est précaire, selon les étapes, et le parcours traverse le plus de territoires autochtones possibles. La rencontre et la connexion entre les différents peuples natifs d’Amérique est le but premier de cette course, qui lance des représentants des peuples indigènes dans une prière en mouvement à la rencontre des autres, portant la voix des silencieux-euses, des silencié-es. Organisée tous les quatre ans, la première éditions s’est lancée en 1992, alors qu’allaient être célébrés les 500 ans de la « découverte » du « Nouveau Monde » (tu peux aller par exemple sur leur site officiel pour en savoir un peu plus).
Notre jeune Noé, perdu donc entre une culture mexicaine qu’il connaît peu, lui qui n’y a jamais mis les pieds, mais dans laquelle il a baigné toute sa vie et un monde universitaire qui lui fait bien sentir sa différence, sa présence inappropriée, rejoint les PDJ au Canada et court, court, en direction du Sud. Son histoire n’est pas celle d’un exploit sportif, mais celle d’une recherche intime et de la confrontation aux autres. Car si le milieu de son université privée était brutale, celui de ses compagne-ons de course n’est pas plus tendre. Vie déchirée, brisée, recluse, chacun-e porte sa croix et ses raisons de s’être lancé dans cette prière volante, sa conception du courage et de la spiritualité. Pour certains c’est un chemin de croix qui passe forcément par la douleur et la souffrance, quitte à devenir tyran pour les autres ; d’autres viennent y chercher des rencontres, des échanges, un chemin (littéral) qui les mène sur les pas de leurs parents, grands-parents… sur les traces de leur histoire.
Récit dur, mélancolique et chargé d’émotion, 10 000km ne va pas prôner la libération et le renouveau par le sport et la spiritualité entouré de gentils amis-es. Loin de tous les poncifs de développement personnel et autres fantasmes sur le sujet, Noé Àlvarez raconte les gens qu’il a croisés, les questions qu’il s’est posées en les écoutant, en se confrontant à une autre forme de violence. Il raconte aussi ses pas sur la terre de ses parents, sa migration inversée, vague qui remonte le cours du fleuve jusqu’à sa source pour, peut-être, mieux poursuivre son chemin par la suite. C’est un récit rude comme un combat, qui nous laisse avec du sable plein les chaussures et dans les yeux, un peu d’amertume dans la bouche et un petit bleu au cœur. Ça pique un peu, mais c’est aussi pour ça que c’est bien.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Bonnot
Éditions Marchialy
340 pages