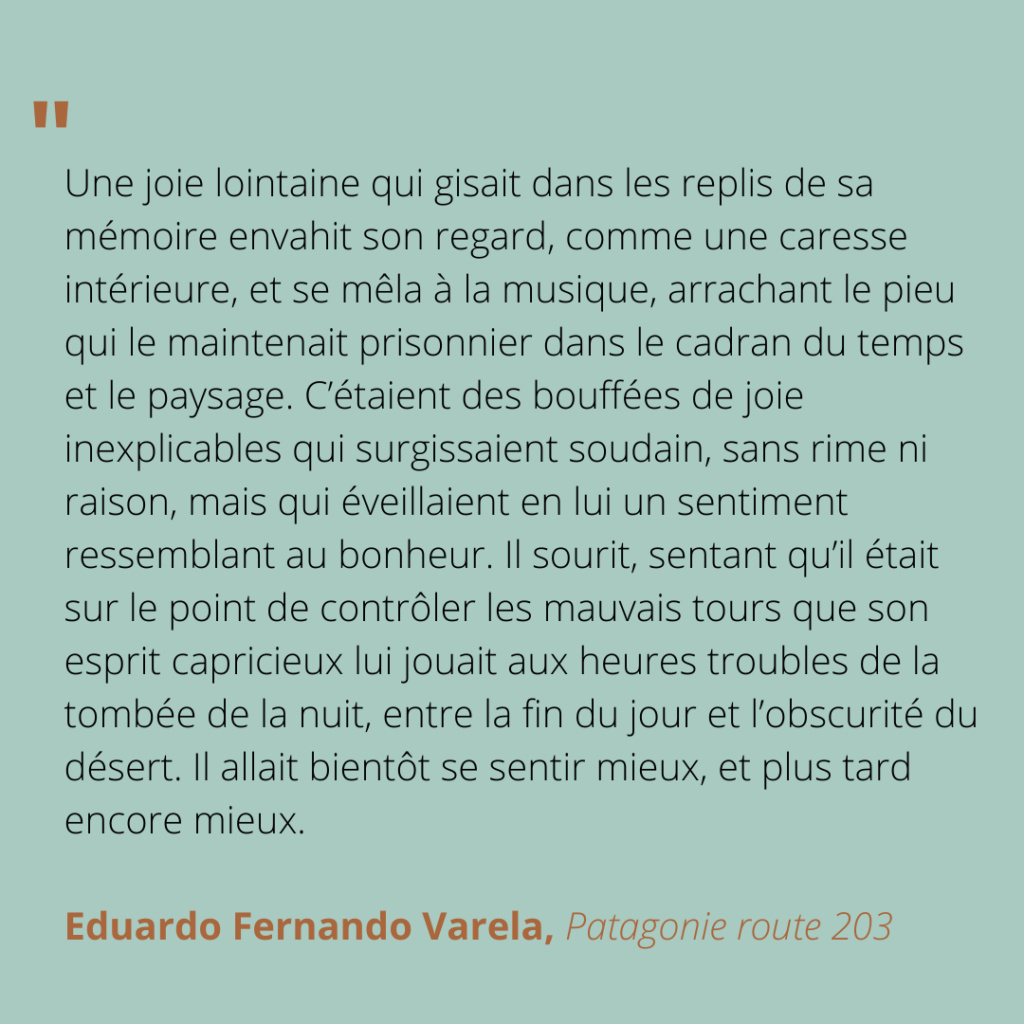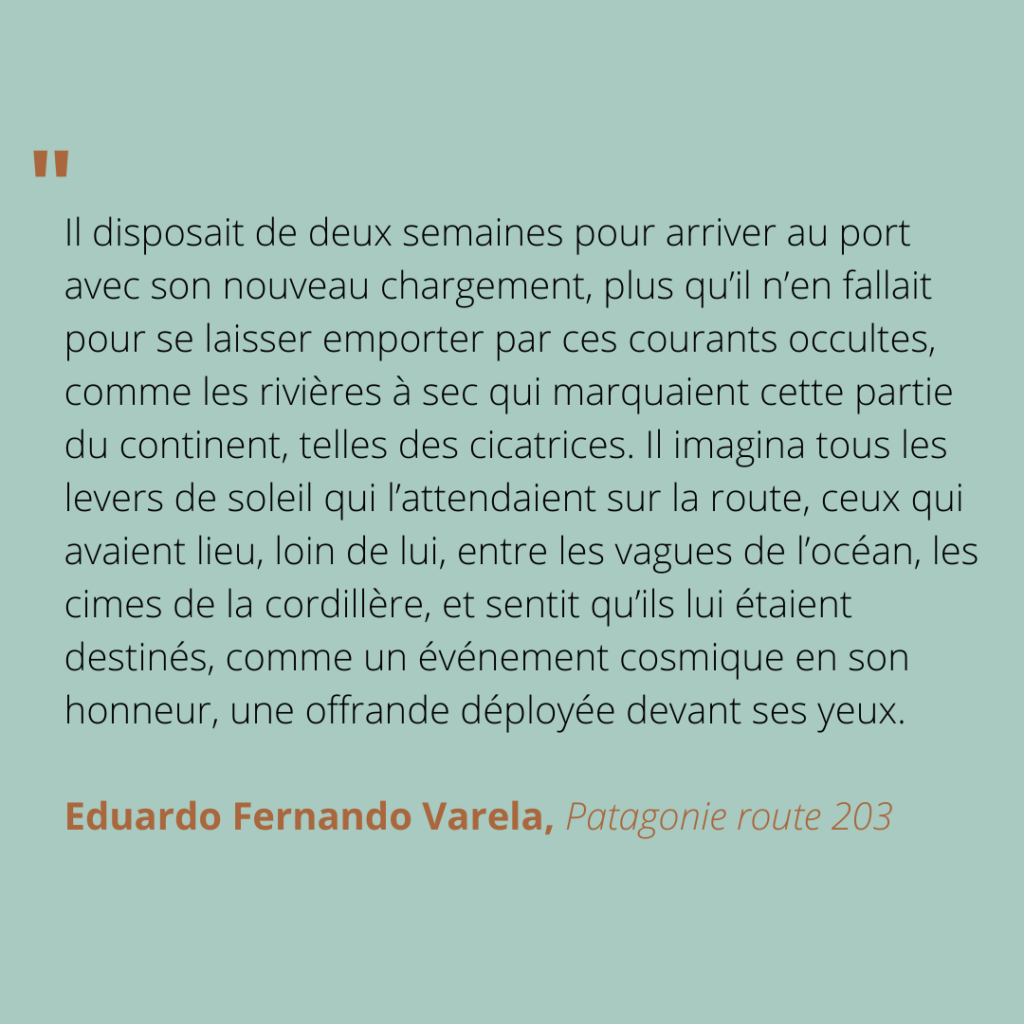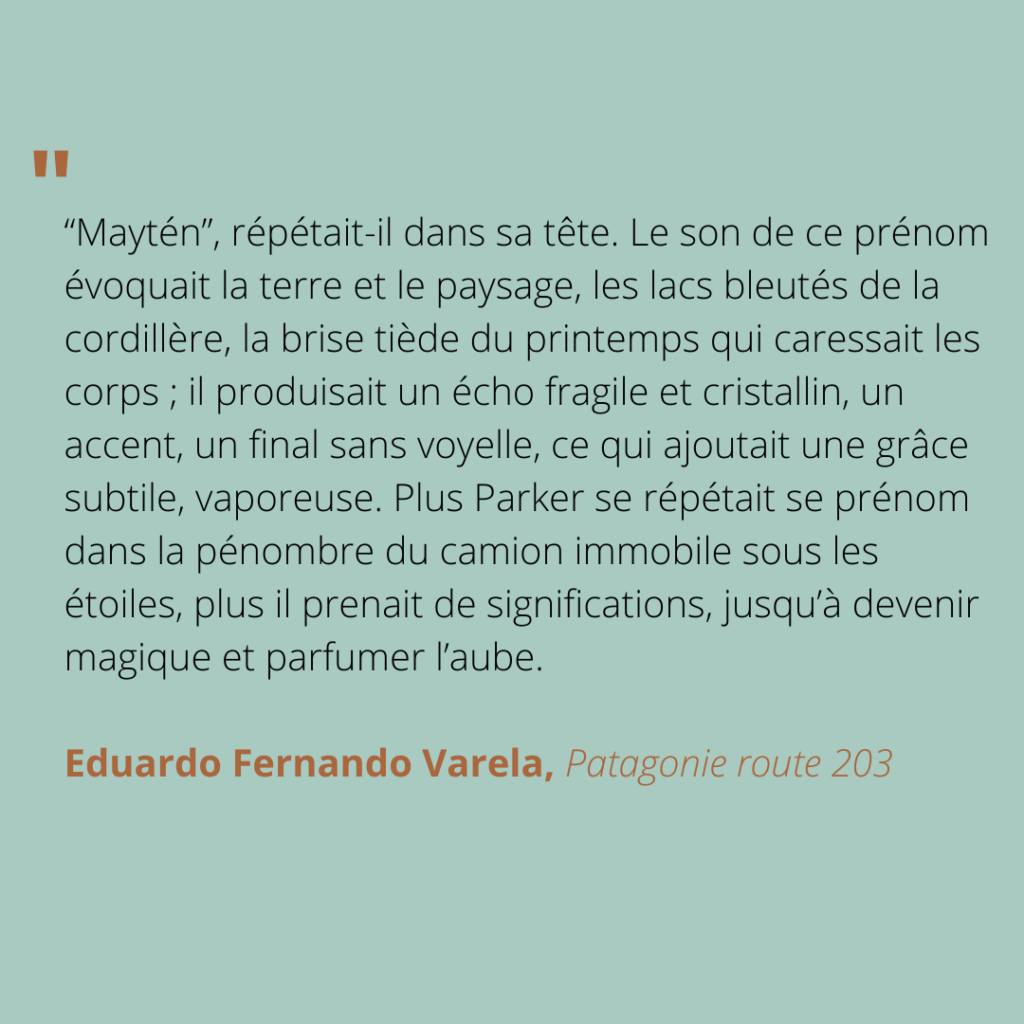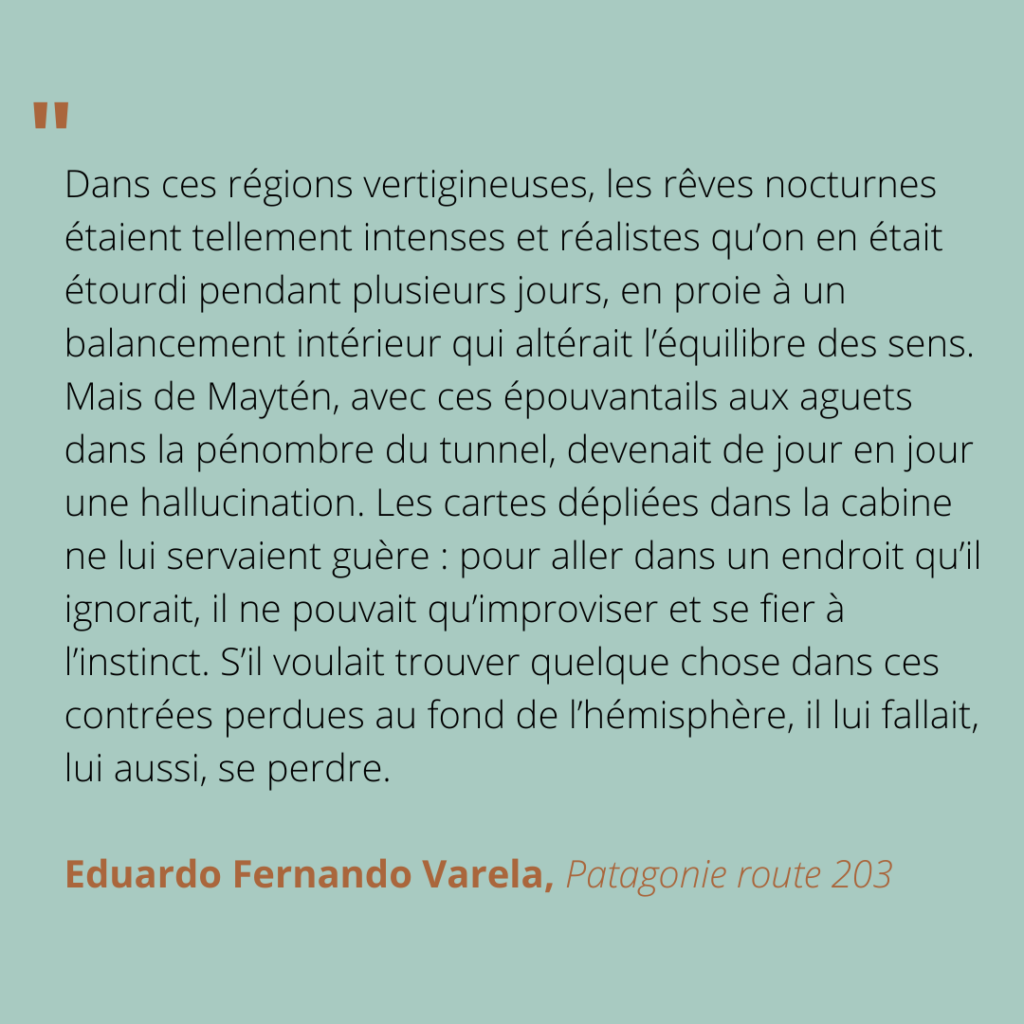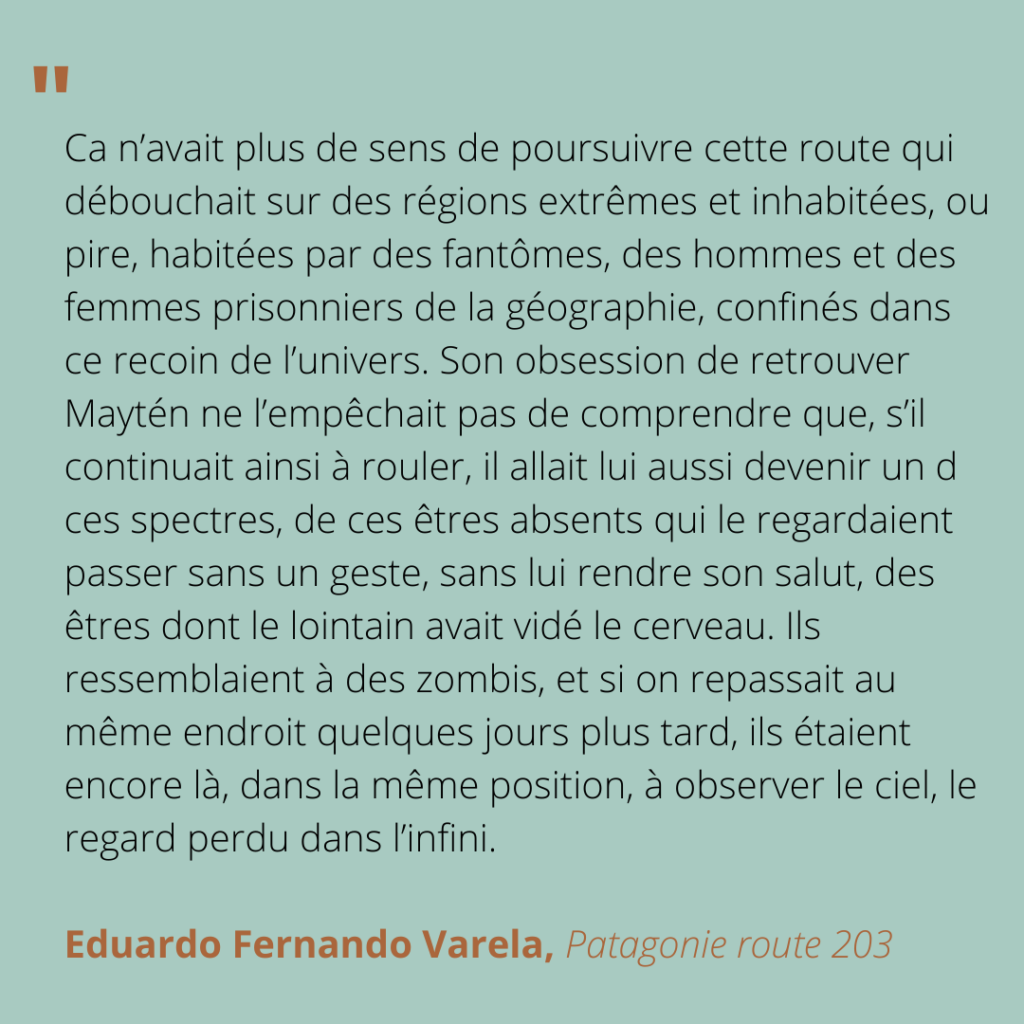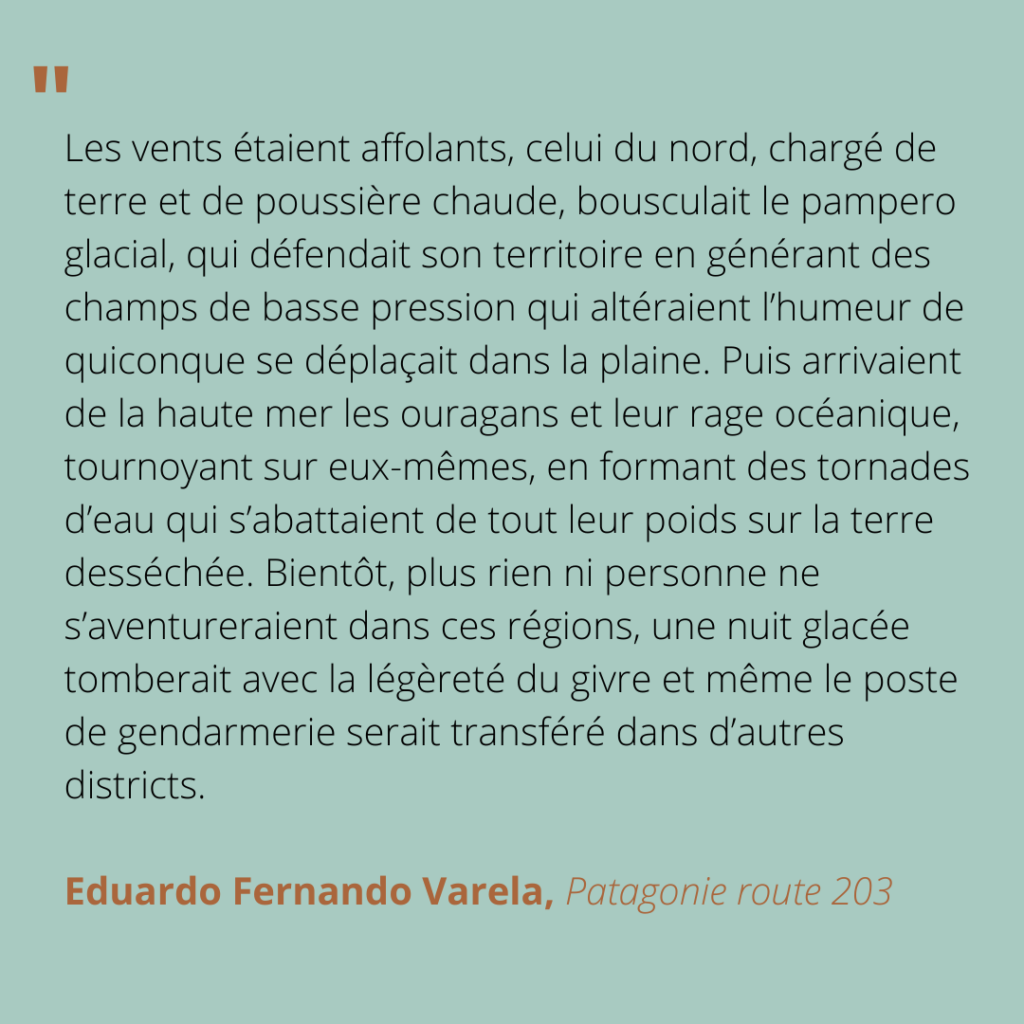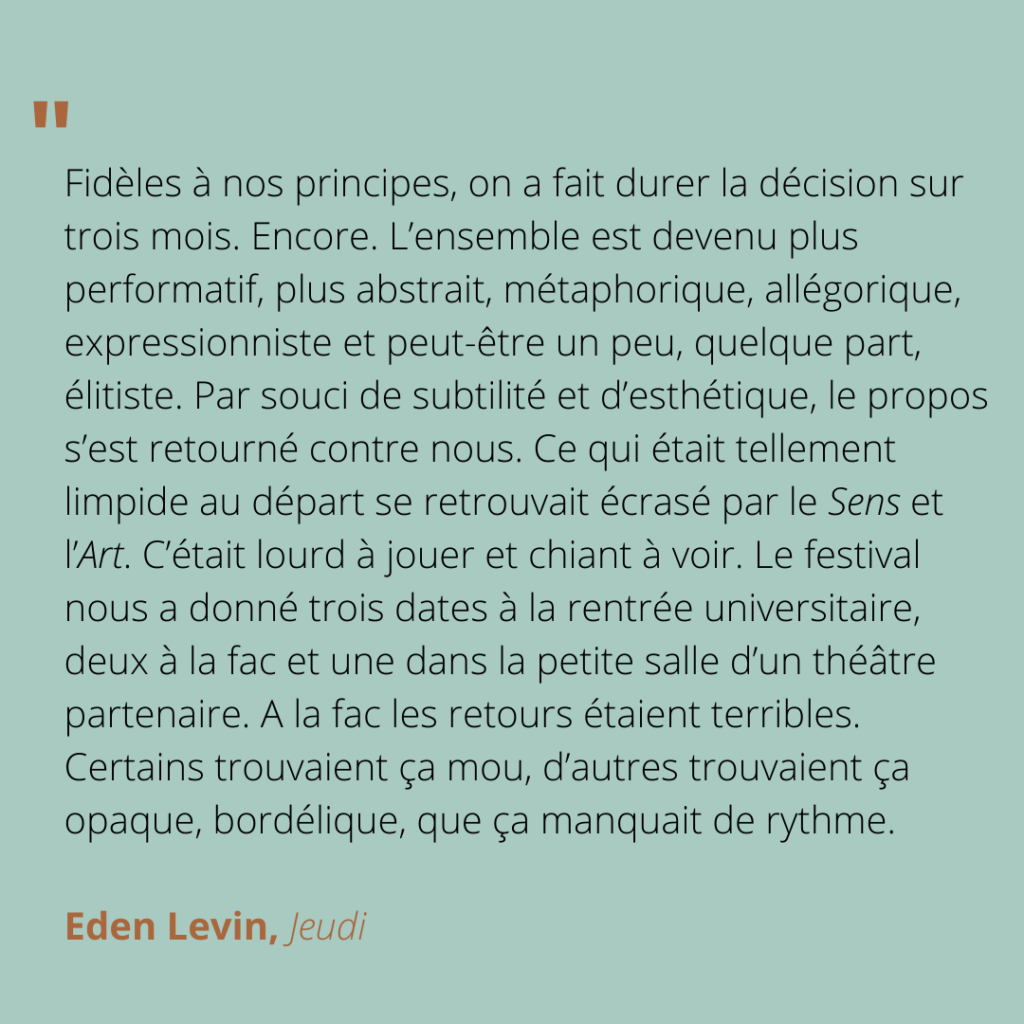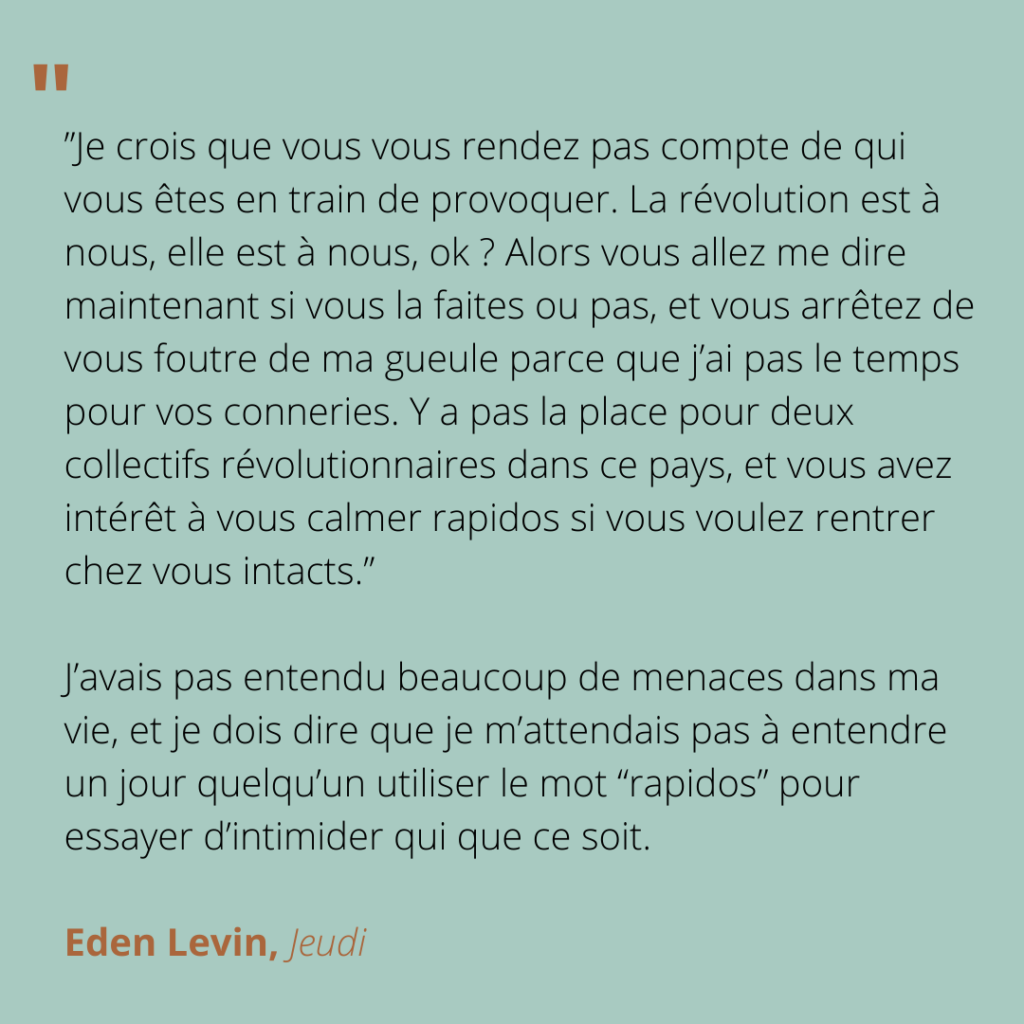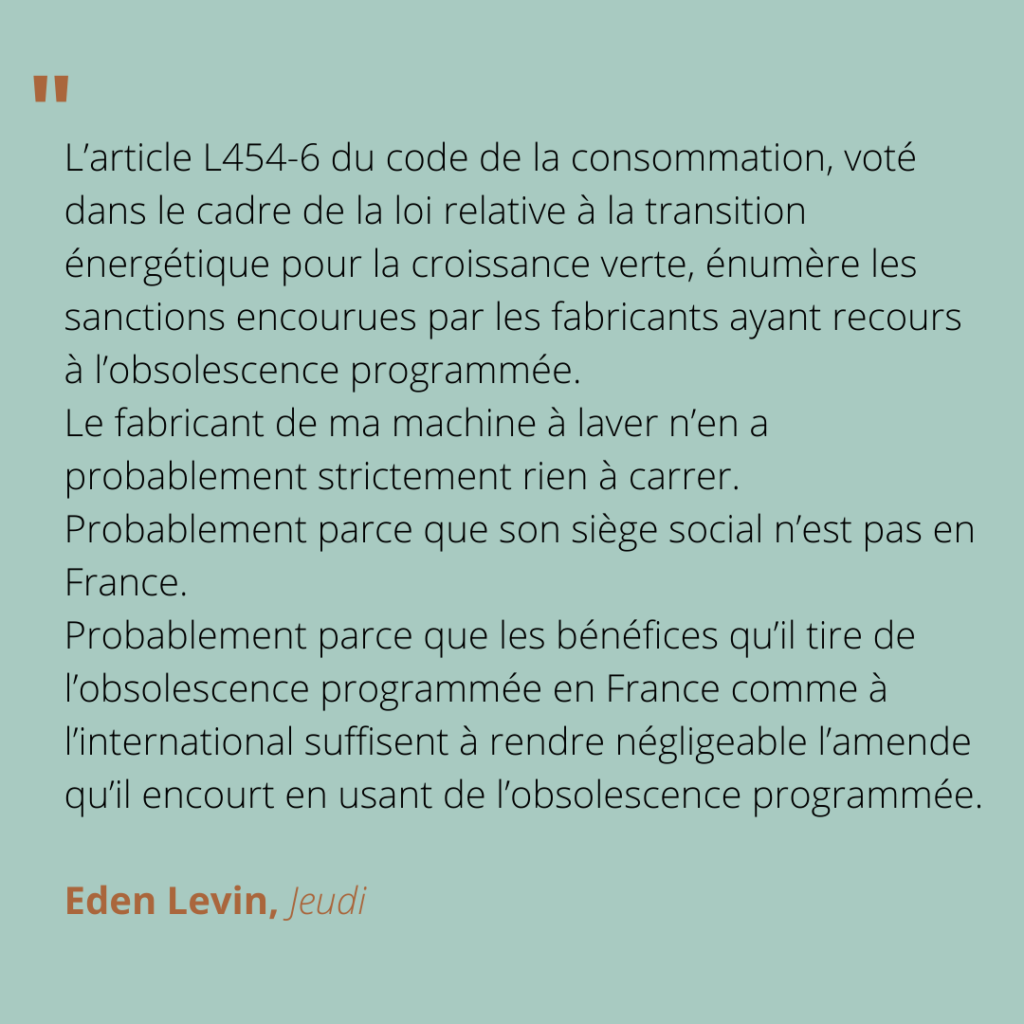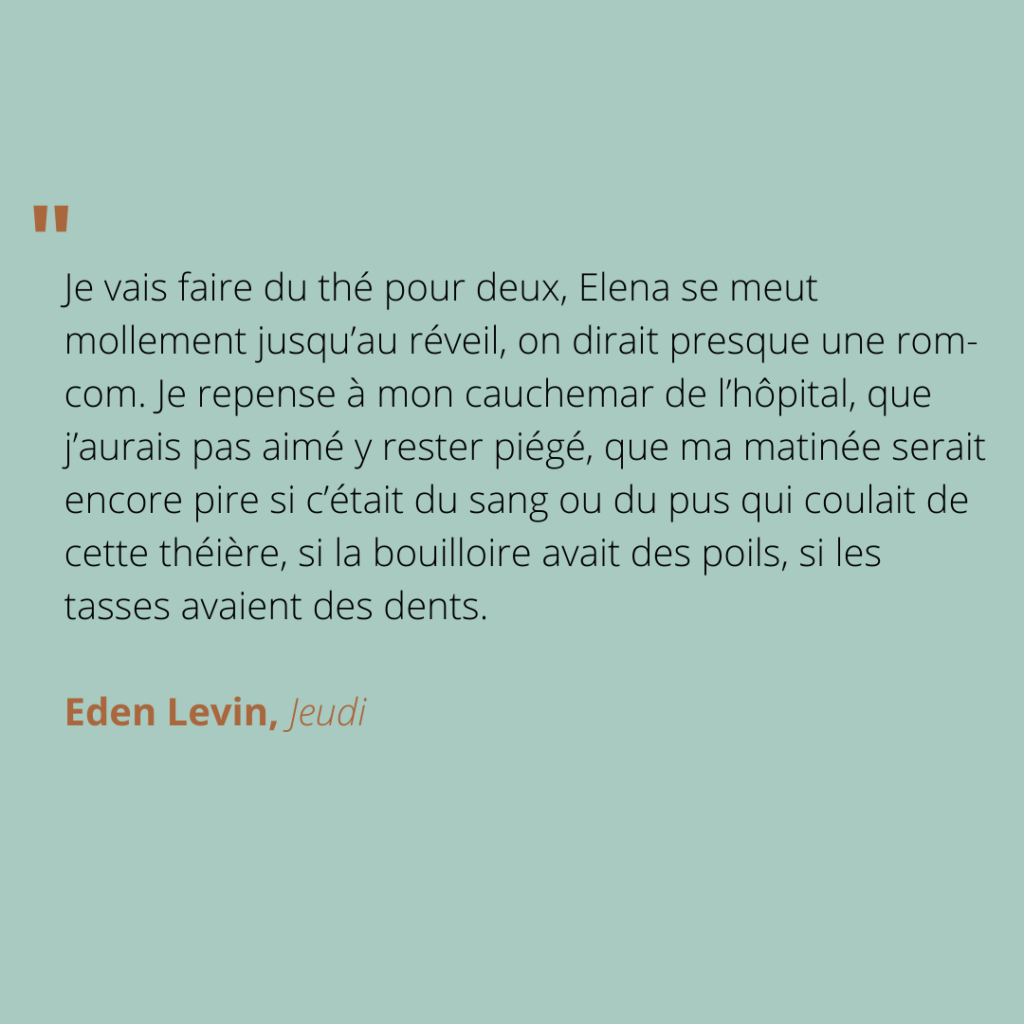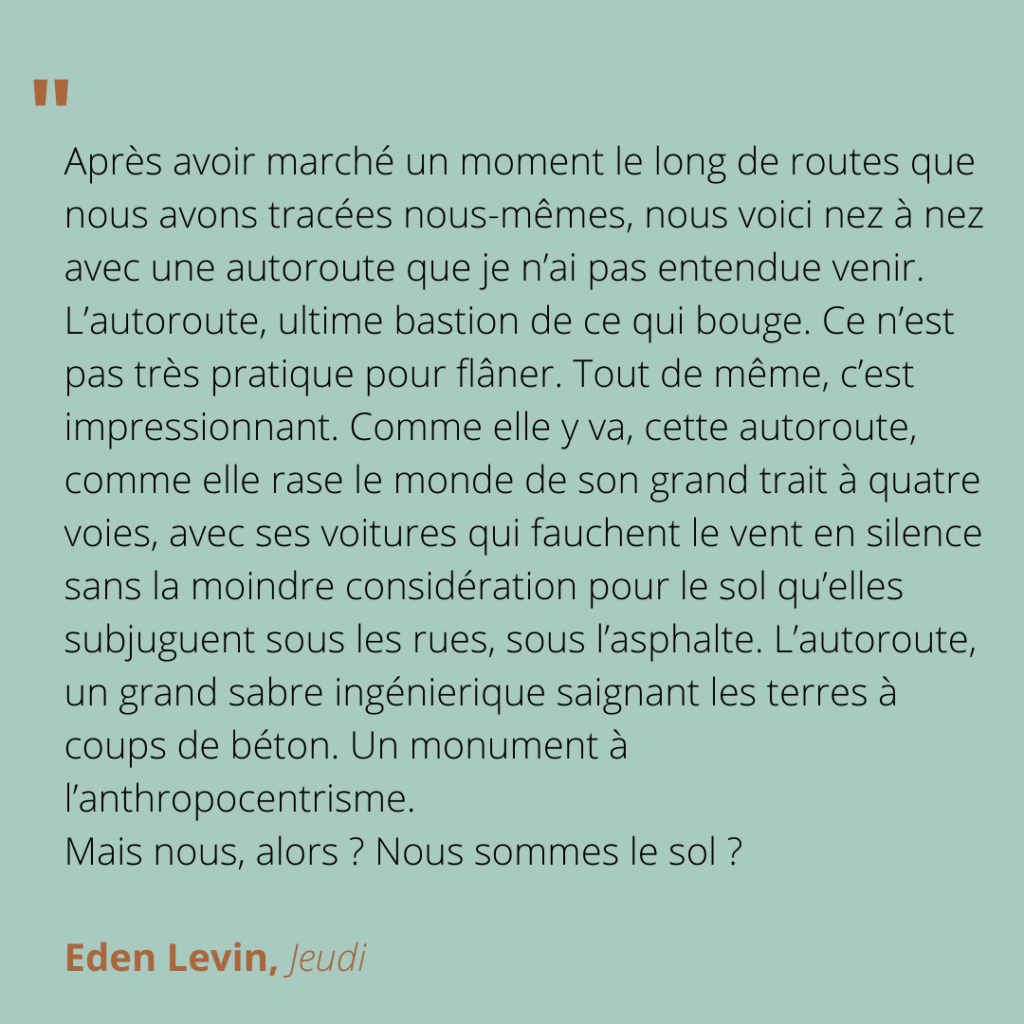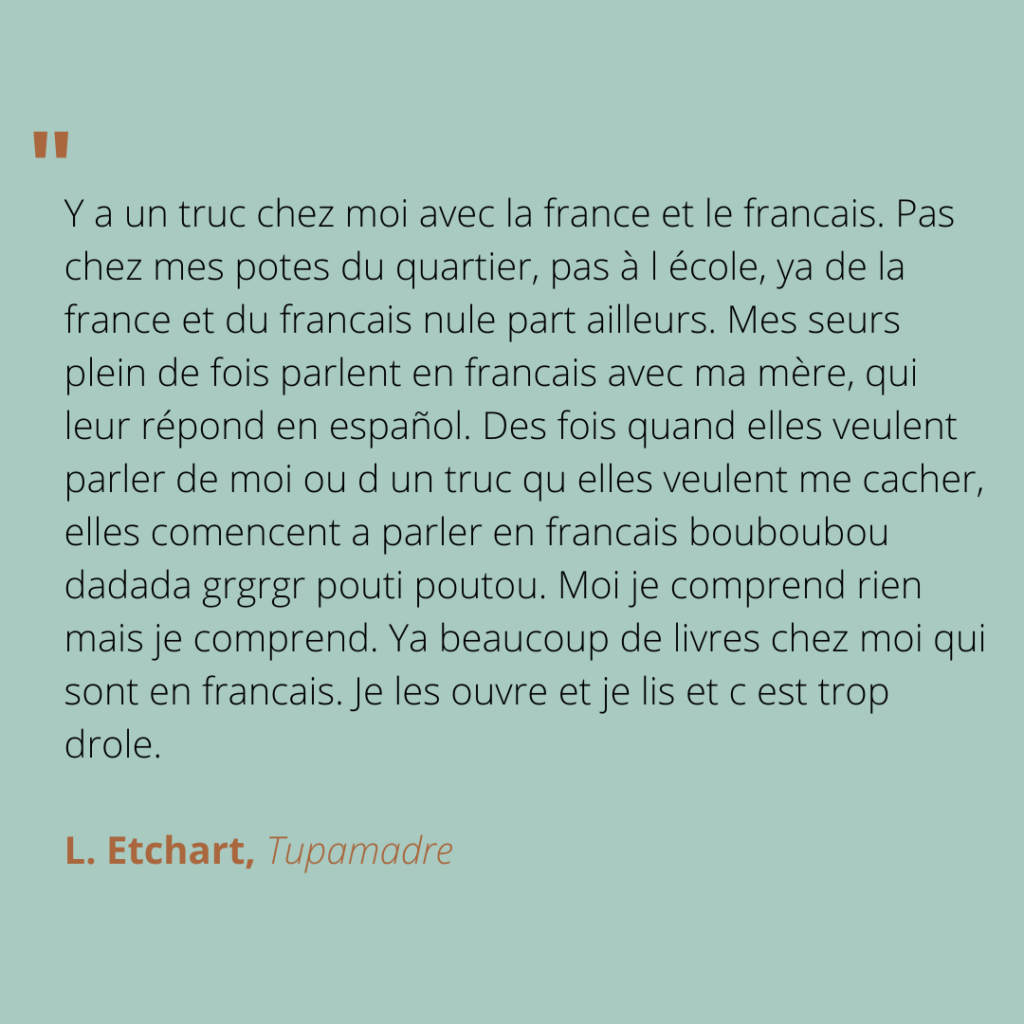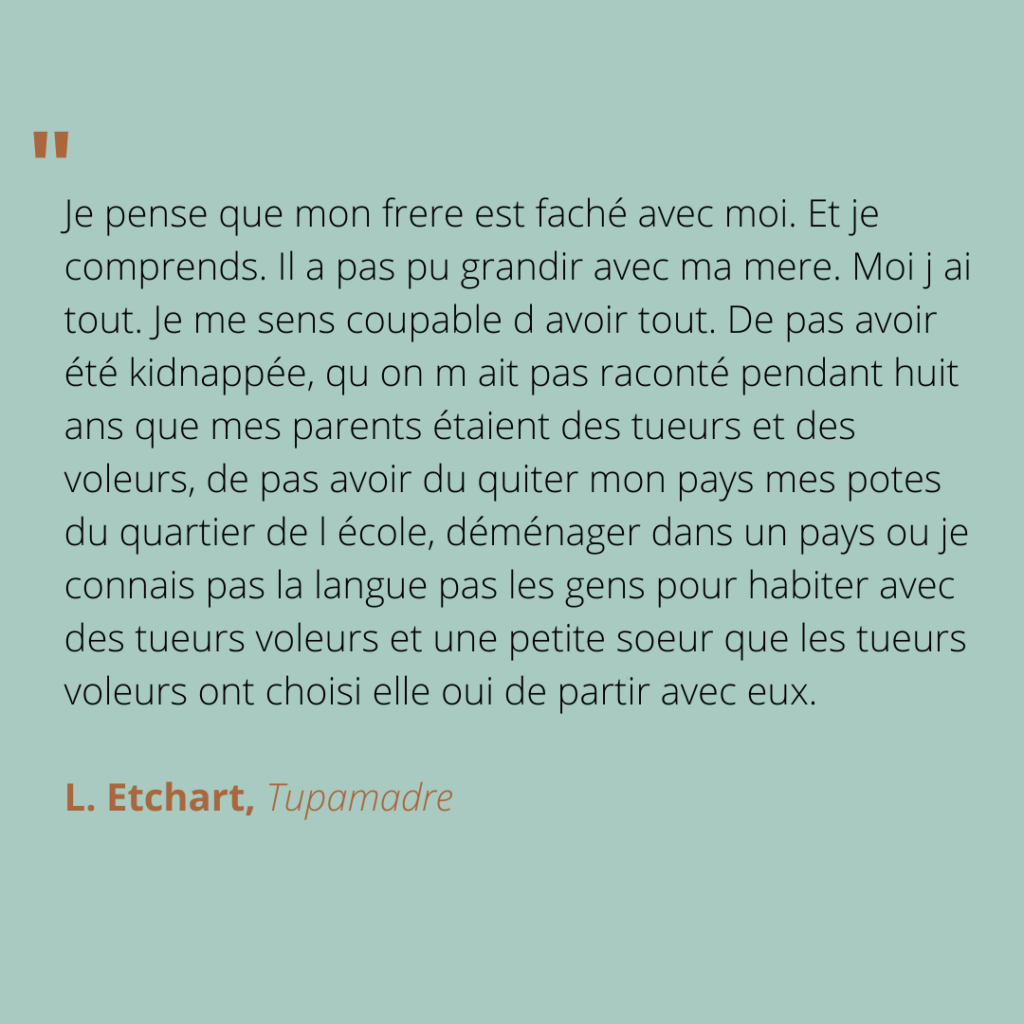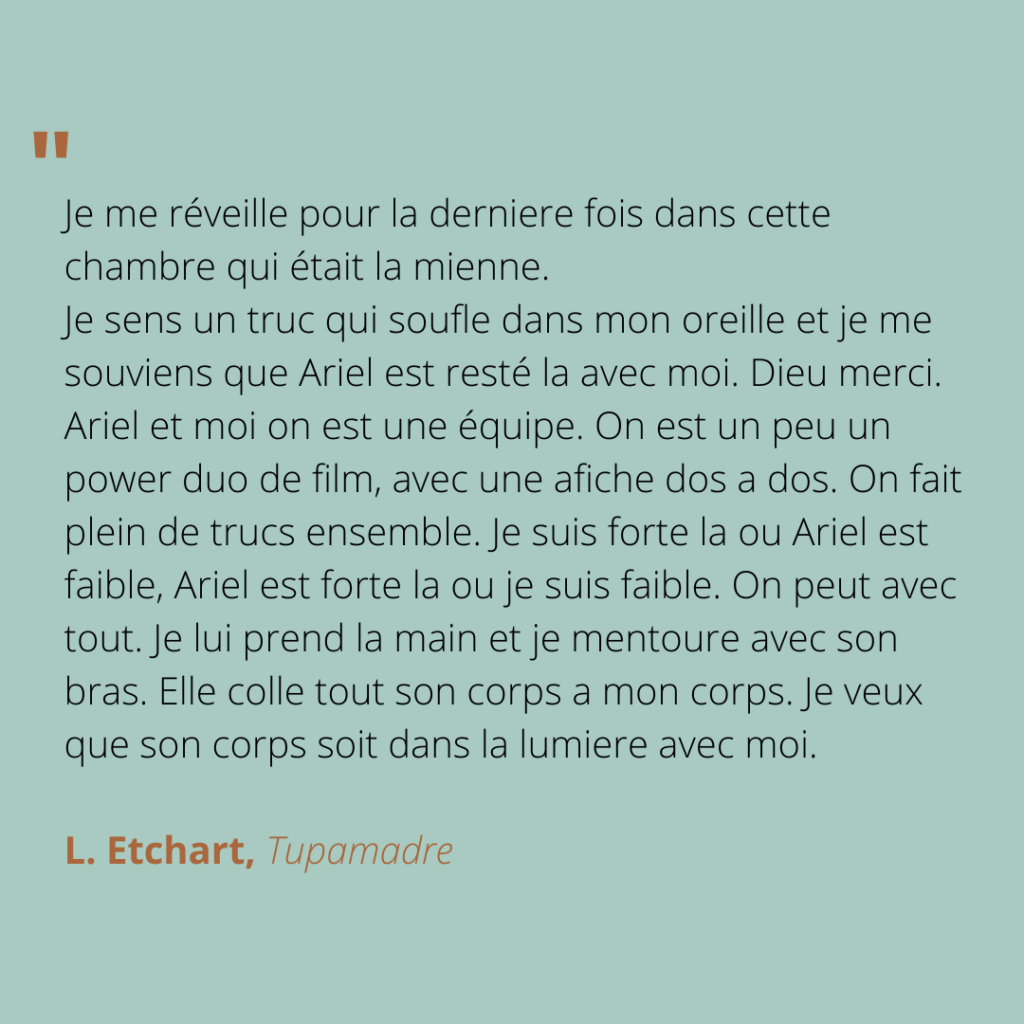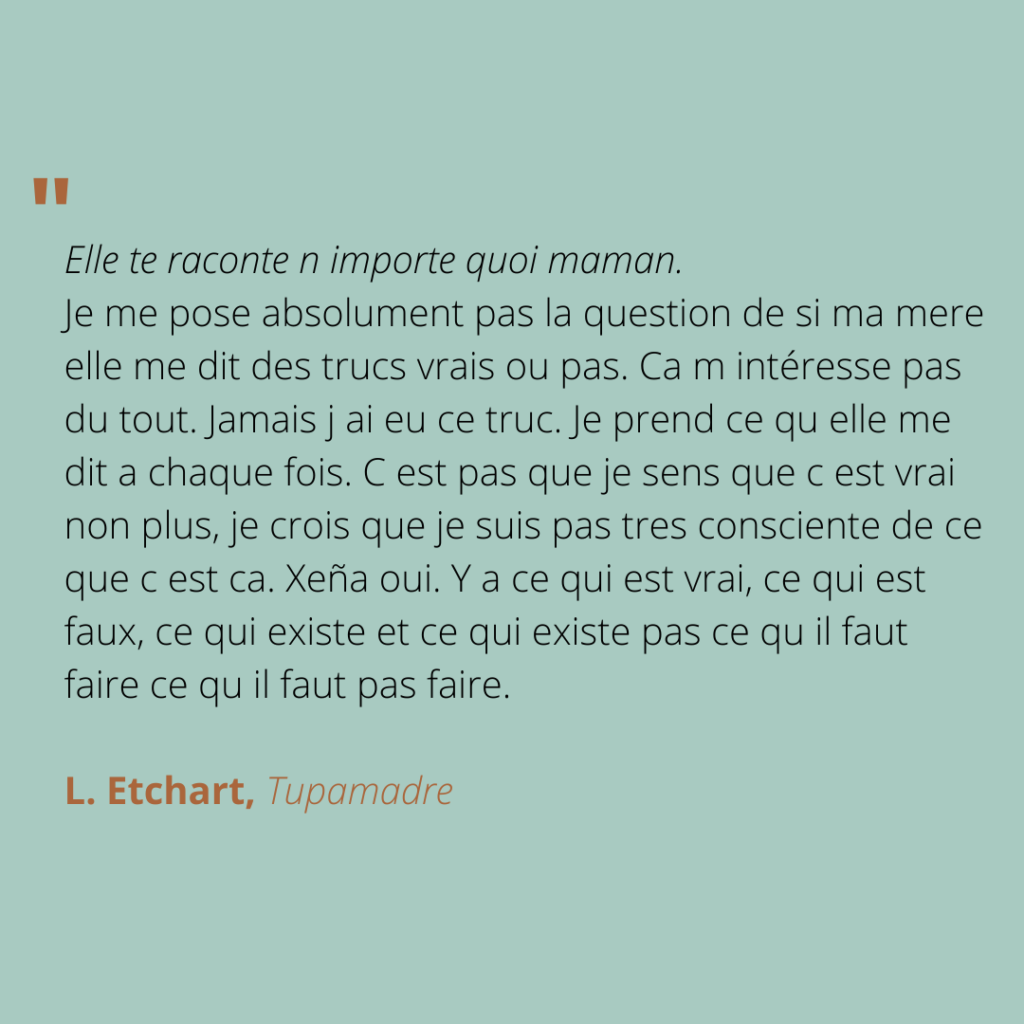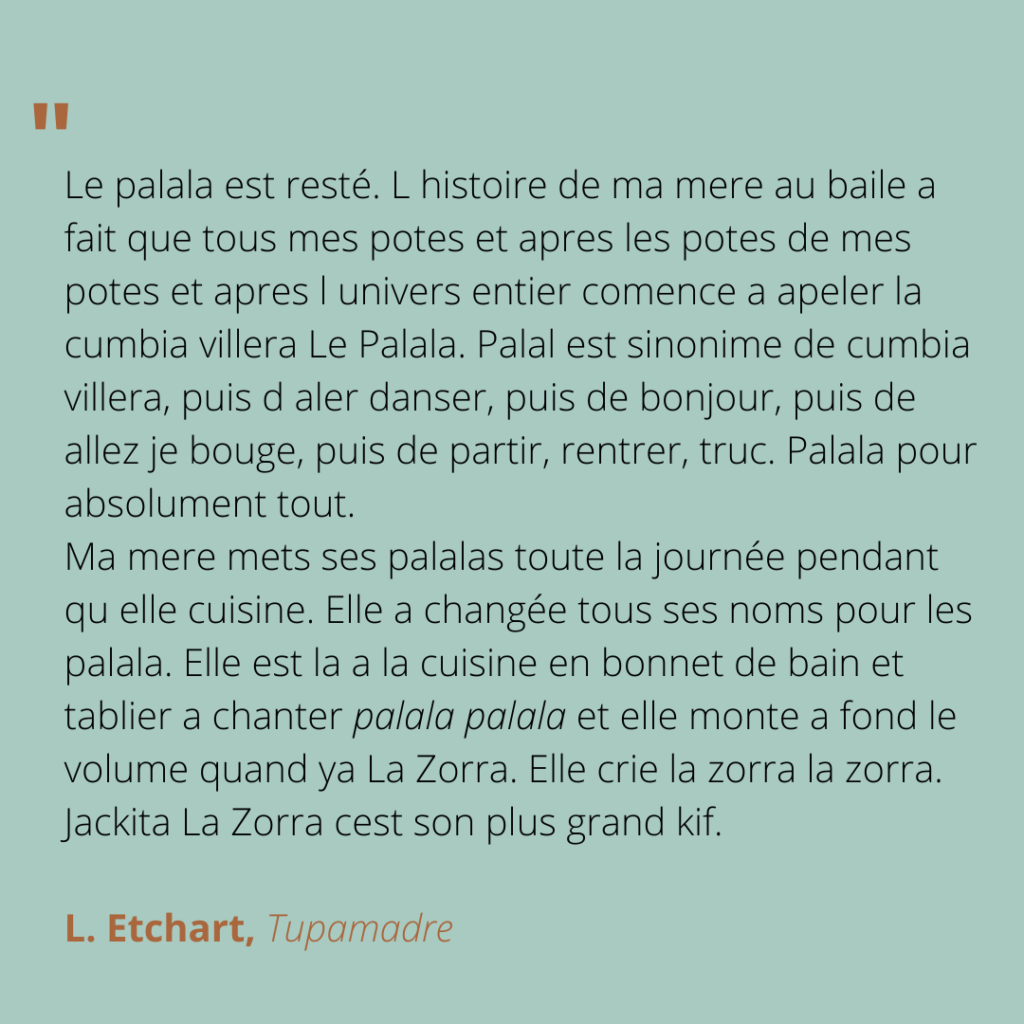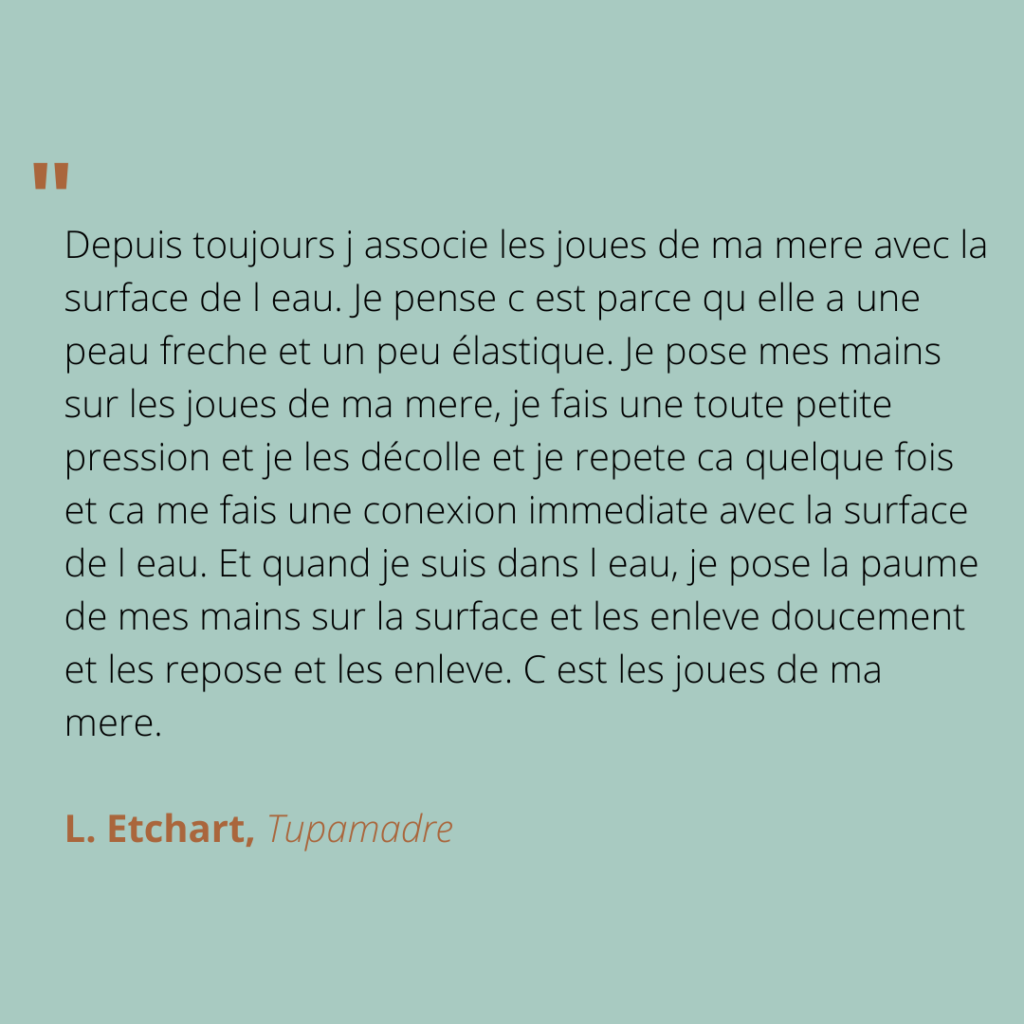Parker, saxophoniste à temps perdu, parcourt au volant de son camion les routes secondaires de Patagonie. Chargé de produits pas toujours bien déclarés, bossant pour une entreprise pas toujours bien réglo, il se repaît de sa solitude et des étendues désertiques et sauvages de ce bout du monde soumis aux caprices d’un vent incessant. Mais au détour d’une bourgade au nom mal définie, un stand de Chamboultou et sa tenancière vont faire chavirer son cœur. Voulant à tout pris la revoir, Parker se lance dans un jeu de piste à travers la géographie très incertaine et changeante de Patagonie.
La route traversait la steppe et s’étendait comme un trait sinueux entre collines et vallées, puis montait et descendait par les flancs, si bien que la ligne de l’horizon s’inclinait, restant dans cette position pendant des kilomètres comme si elle flottait en l’air. Vers la cordillère, le continent courbait l’échine comme un félin prêt à bondir ; vers l’océan, le ciel et l’horizon se disputaient une immense plaine. Le vent qui descendait des glaces éternelles agitait les herbages d’une caresse nerveuse comme s’il dépeignait la terre. Quand les rafales se mêlaient à la brise de mer, d’énormes tourbillons de poussière grimpaient au ciel en lentes spirales. Au loin, confondu avec le paysage, le camion roulait en oscillant à un rythme qui semblait sourdre des profondeurs de la planète. Les courbes molles du terrain lui donnaient des allures de serpent paresseux et, plus qu’un déplacement, c’était un glissement, une reptation liquide sur la surface inclinée.
Parker conduisait le regard fixé sur la route, sans ciller, une main appuyée sur le volant et l’autre sur le dossier du siège, comme s’il étreignait un invisible passager. Après des heures de solitude et de vide, il voyageait hypnotisé par le mouvement lent et régulier, l’esprit dans le vague, bercé par le roulis. Rien d’autre autour de lui qu’un immense désert limitant le reste de la planète et ses conventions, mais ici, dans la solitude amplifiée par l’espace, le conducteur n’était limité que par ses propres règles et caprices.
En général, de par nos contrées, lorsque l’on pense à la Patagonie on pense Terre de Feu, glaciers, mer sauvage et randonnée. La Patagonie de Parker, qu’il parcourt en long, en large, en travers et en camion est un paysage aussi sauvage que désolé, tailladé de lignes droites croisant des lignes courbes vallonnant les pentes de la cordillère et les falaises de l’Atlantique. Ces routes principales, secondaires voire tertiaires sont parsemées de villages plus ou moins vivants et plus ou moins peuplés, souvent moins, d’ailleurs. On s’arrête à Jardín Espinoso ou Mula Muerte, on longe le Salar Desesperación, on tombe en panne à Teniente Primero López. Mais peut-être est-ce El Suculento ou Teniente López tout court, d’ailleurs. Ici, les gens sont à l’image du paysage, comme on dit : fluctuants, rudes et peu subtils. Ou trop subtils.
Parker les déteste, eux qui sont incapables de répondre simplement à une question. Solitaire invétéré, chaque arrêt est un jeu de cache-cache pour éviter ses pairs et chaque interaction avec les gens du cru un calvaire. Jusqu’à Maytén, la belle, l’incroyable Maytén. Pourrait-elle tomber sous le charme, elle qui vit dans un mariage qui n’a jamais été très heureux, qui rêve de fuir ce Sud sauvage qui la tient captive, de cette fête foraine minable et des deux Boliviens illuminés qui tiennent lieu d’employés ? Quelle vie Parker pourrait-il lui offrir, lui qui fuit comme la peste tout ce qui fait vibrer Maytén : les lumières de Buenos Aires, les discussions, les brouhahas des foules ? Et que vient faire dans tout ça la sombre histoire d’un éventuel sous-marin nazi naufragé ?
Premier roman d’Eduardo Fernando Varela, à qui l’on doit le très très bien Roca Pelada, on trouve ici des thèmes qui feront écho dans son second roman : un héros attaché à sa solitude et aux espaces arides et isolés, des personnages secondaires rocambolesques qui lui mènent une vie impossible, quelques légendes (ou pas ?) des peuples du passé, une géographie revisitée, vivante, qui fait du paysage un personnage à part entière capable de transformer le destin des protagonistes. On y trouve aussi cet humour absurde qui rend chaque situation un peu aberrante et oblige notre héros à se confronter au monde et un peu à lui-même. Et surtout ce ton doux-amer et mélancolique qui nous rappelle que, comme dans la vie, dans les romans le gentil héros touchant et un peu rustre n’est pas sûr de finir heureux et amoureux, car c’est le vent, souffle moqueur du destin, qui joue avec les chemins de chacun.
Traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry
Éditions J’ai Lu/Métailié
360 pages