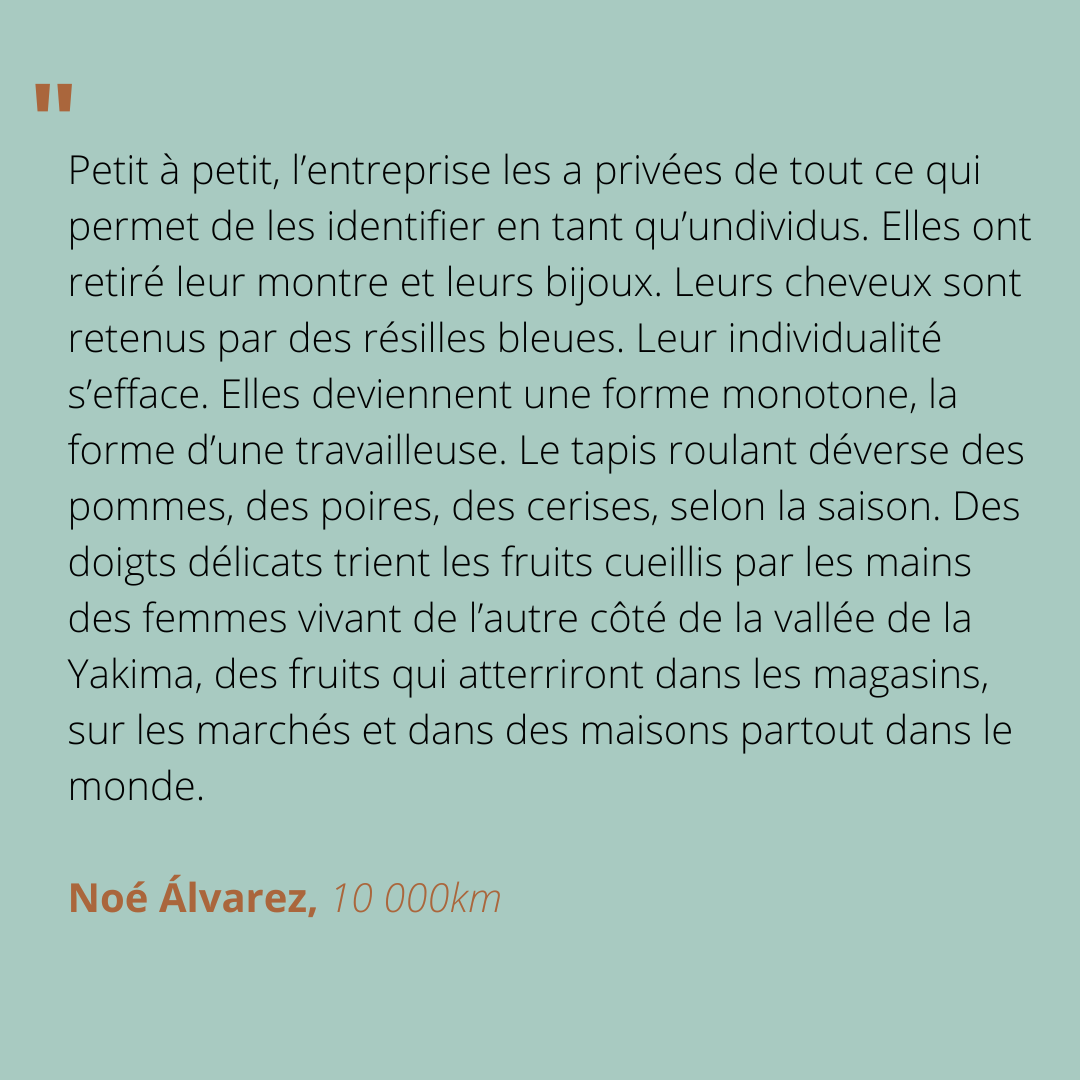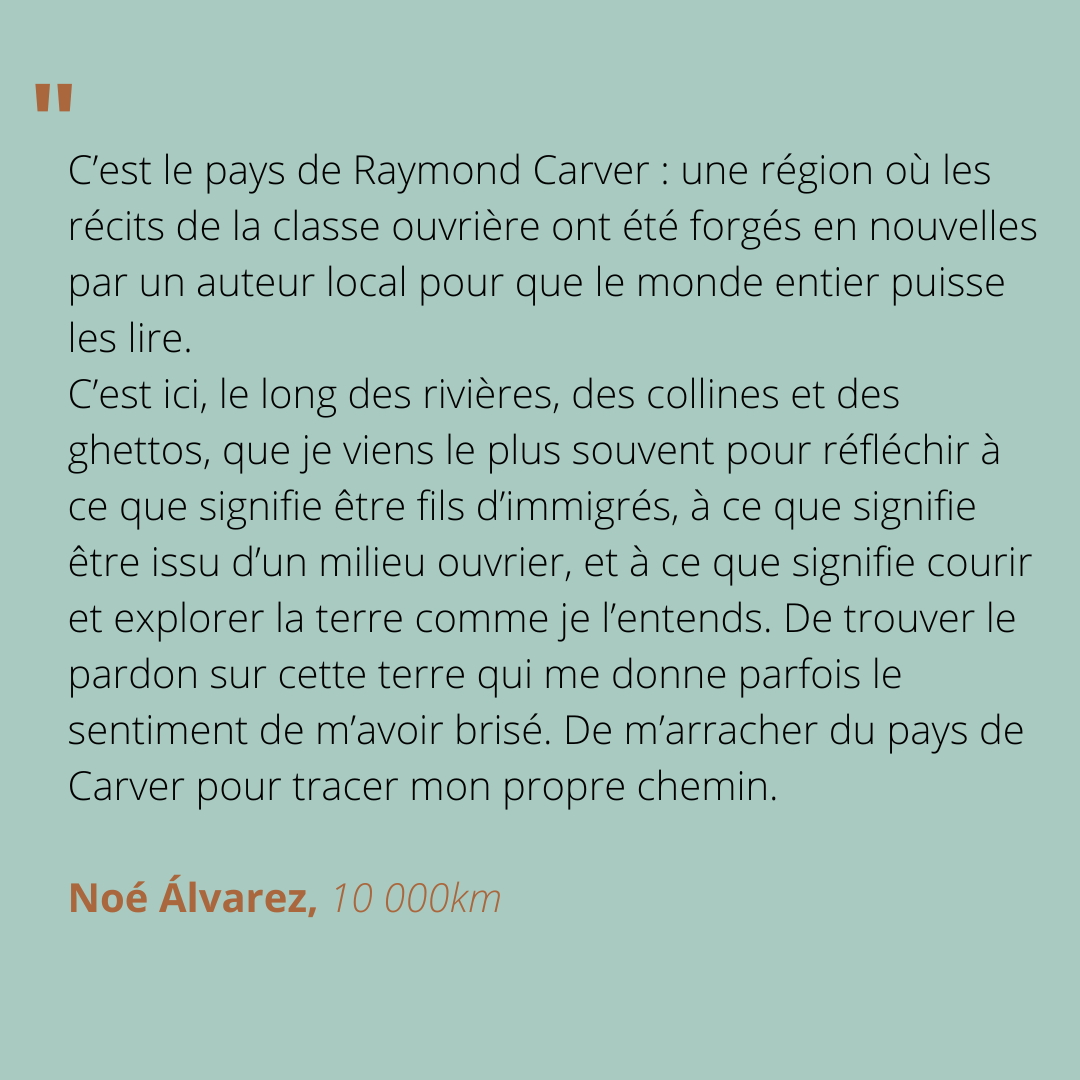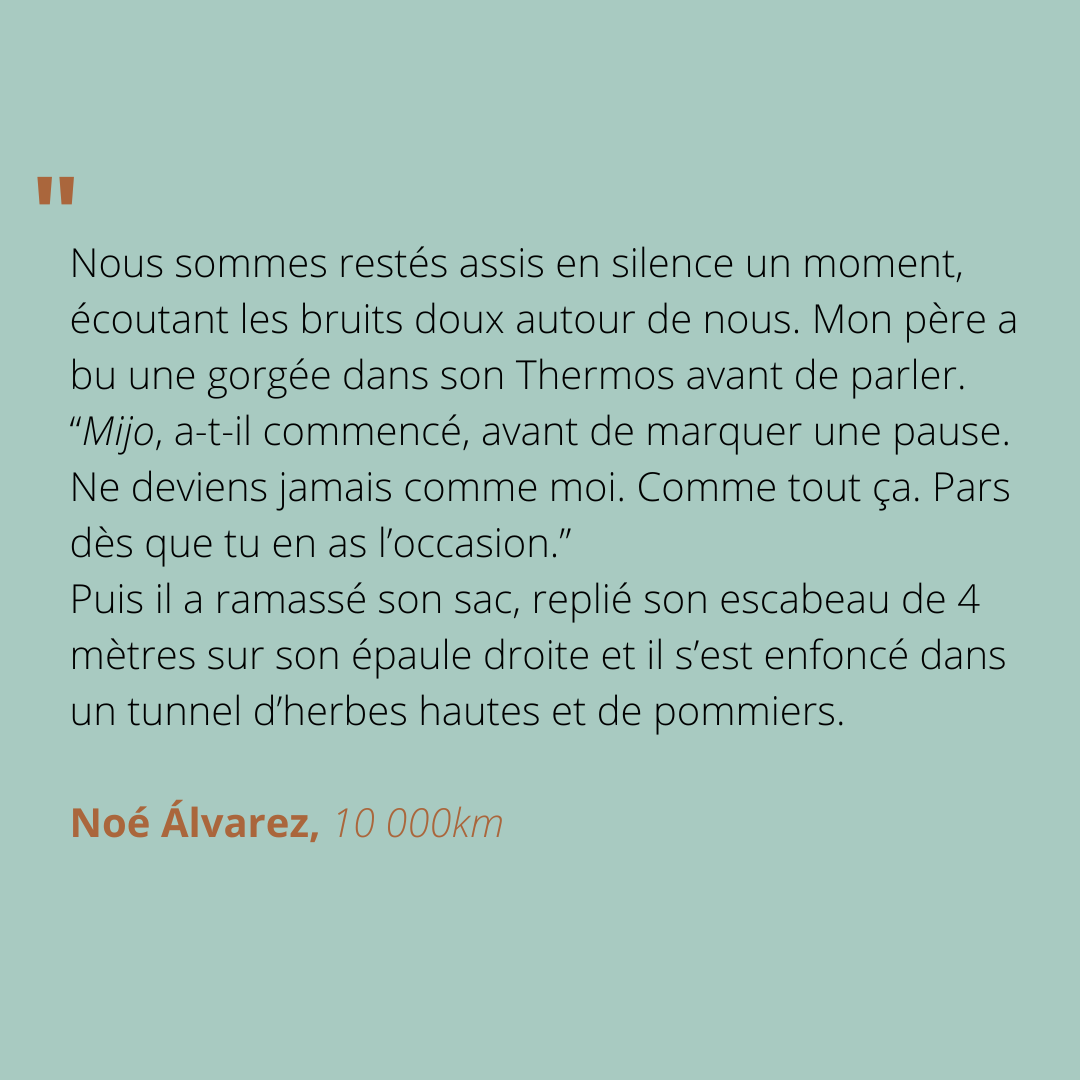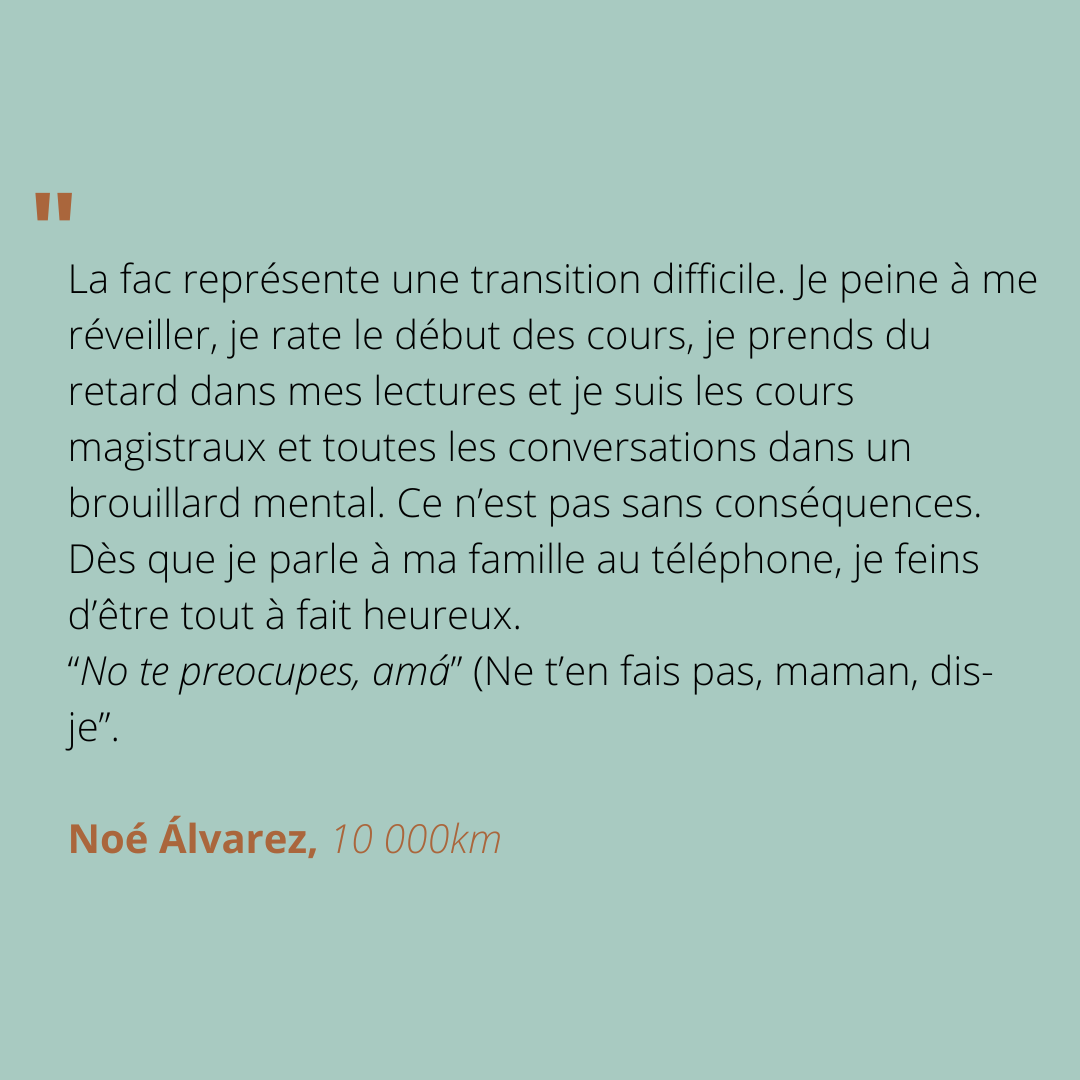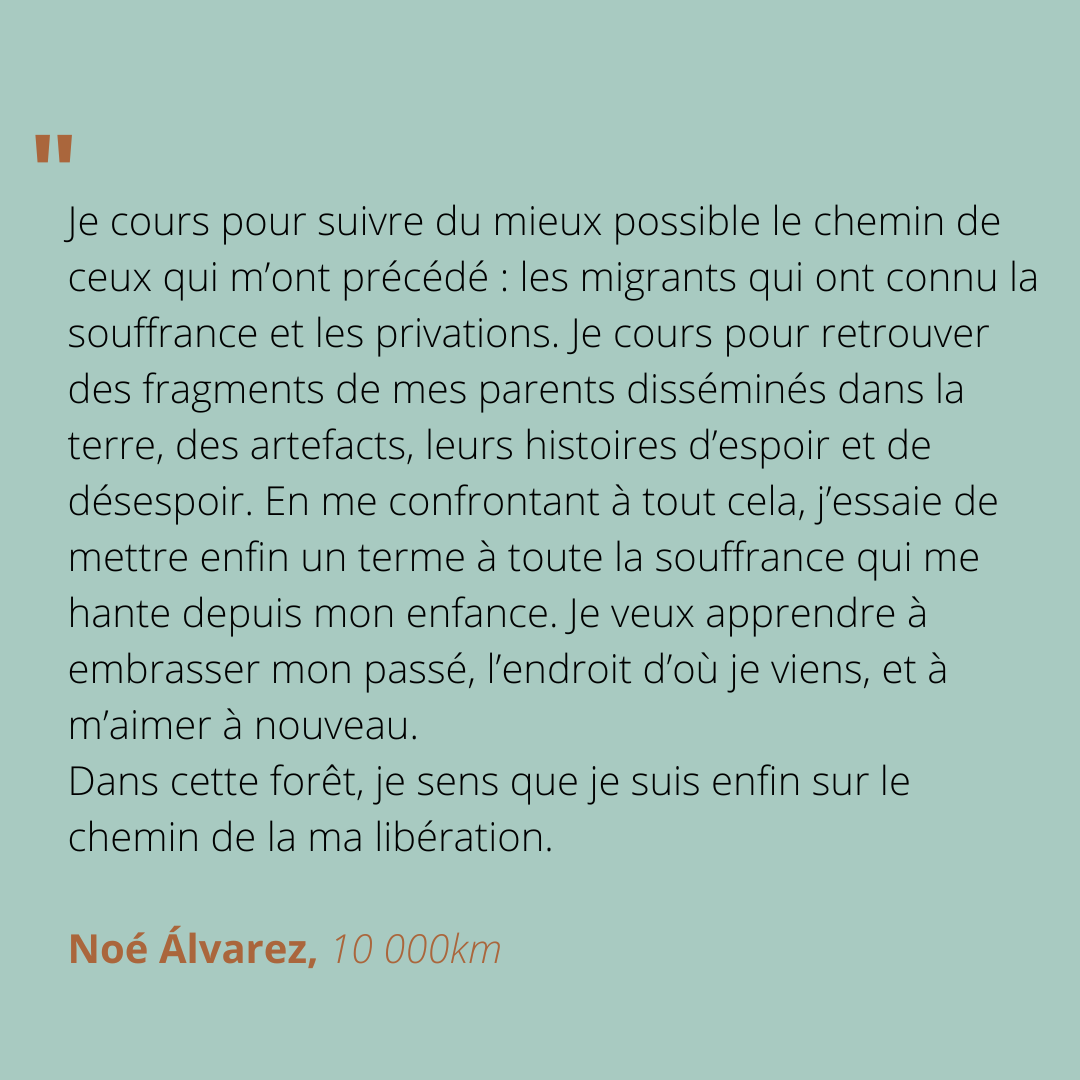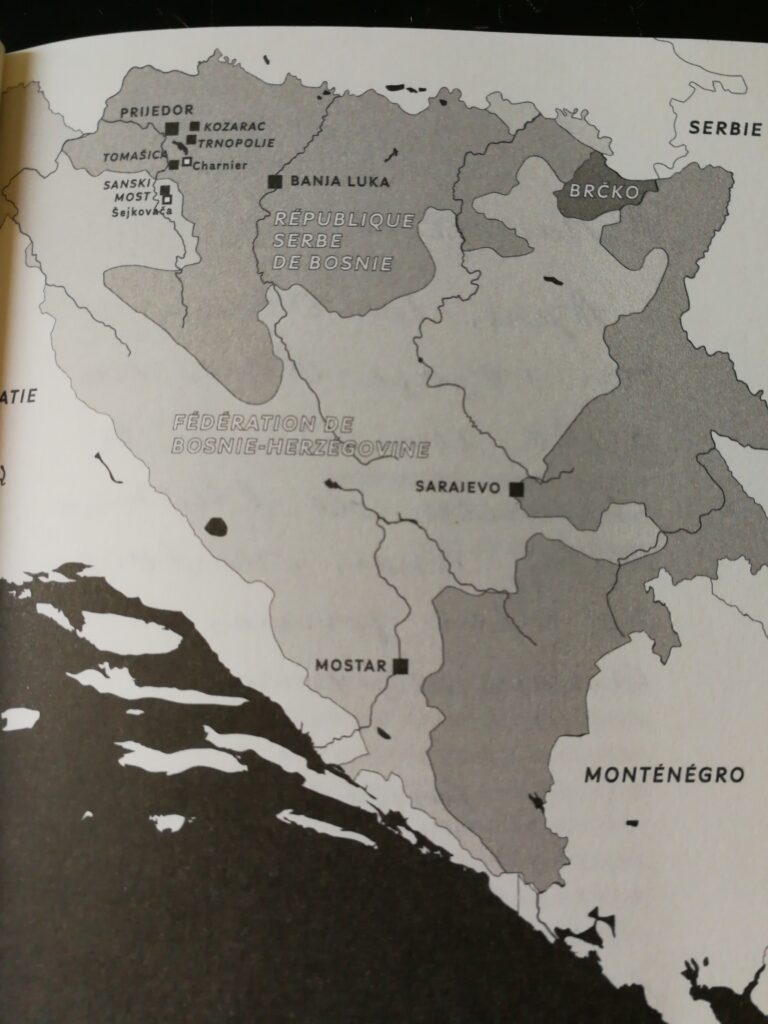Lumir Lapray, activiste et militante pour l’environnement et la justice sociale (dixit sa présentation en bas du livre) a grandi dans un coin qui s’appelle la Plaine de l’Ain. Région du département de l’Ain (oui ça a l’air de couler de source, mais figure-toi, lectrice, lecteur, ma géographie, que sa source, à l’Ain justement, et bien elle n’est pas dans l’Ain ^^ Mais bref, revenons à nos moutons) coincée entre Lyon, Bourg-en-Bresse et la centrale nucléaire du Bugey, plaine assez classique entre les monts du Bugey et les étangs de la Dombes, le coin n’a rien de sexy. MAIS il est quand même bien situé, et il y a de la place. S’y est développé au fil des années un parc d’activités immense, une plateforme logistique et industrielle qui emploie beaucoup beaucoup de monde et fait vivre cette partie du département.
Lumir Lapray a donc grandi là-bas, à côté de Lagnieu. Après ses études à Sciences-Po et plusieurs séjours aux États-Unis où elle a travaillé, entre autre, sur les populations rurales qui votent Trump, elle revient en France et dans son village pour quelques temps. Elle est un peu une transfuge, non pas forcément de classe au sens strict, mais pour ses ami-es t les gens du coin, elle est celle qui a fait des études, qui est partie loin, qui est donc symboliquement au-dessus. En plus écolo et de gauche, ça rajoute une couche à la couche. Elle doit donc faire ses preuves pour se faire ré-accepter, sans pour autant renier ses convictions. Au milieu de ce monde qu’elle redécouvre après tout son parcours, de nouvelles questions émergent, peut-être aussi nourries de ce qu’elle a vu aux États-Unis : qu’est-ce qui les meut, ces gens-là ? Qu’est-ce que les énerve, les fait vibrer et, in fine, les fait peut-être voter RN ?
La déontologie du blogage et de la chronique littéraire me demandent de te dire, lectrice, lecteur, mon ramequin, que ce coin dont parle Lumir Lapray, je le connais. Pas lui précisément, mais j’ai passé une partie de mon enfance et mon adolescence à environ 30 km de Lagnieu, dans une petite ville de l’Ain en tous points similaire, où les employeurs principaux étaient une grande usine de climatiseurs et la SNCF. Les gens dont parle Lumir Lapray, que ce soit les portraits de ses ami-es ou les habitant-es du coin, je les connais, j’ai eu les mêmes. Donc je vais peut-être manquer d’impartialité, mais tant pis. La chronique littéraire n’est ni impartiale, ni objective ^^ Et pis c’est mon blog.
Chaque jour, vous vous levez aux aurores, réveillez les enfants quand vous en avez, préparez les tartines, prenez la voiture, faites un détour par chez la nounou et embauchez pour la journée. Vous empaquetez des colis dans un entrepôt, nettoyez et nourrissez les vieux du village, rejoignez un chantier. Ou bien vous eêst assis derrière un bureau, dans une petite entreprise, une collectivité locale ou une agence immobilière. Vous faites ça depuis longtemps -vous avez arrêté l’école assez tôt, comme la plupart de vos amis. Le travail ne vous faisait pas peur et vous rêviez de liberté. Le weekend, vous bricolez un peu, vous profitez de votre famille, vous invitez les potes à l’apéro, vous faites un barbecue, vous êtes tranquilles. Derrière la haie de thuyas, vous vous dites que vous avez atteint votre rêve : une maison dont vous êtes propriétaire, une voiture, quelques vacances. Le boulot, les traites, les factures : tout ça valait donc le coup.
Oui, mais depuis quelque temps vous avez peur. Vous savez qu’il suffit d’une maladie, un divorce, un accident. Vous en connaissez, qui ont dû vendre. Même si vous n’en êtes pas encore là, vous peinez à joindre les deux bouts. Vous n’allez plus systématiquement chez Leclerc -c’est devenu trop cher. Va pour Lidl. Vous n’allez plus au resto. Va pour McDo -il faut bien se faire plaisir. On n’est pas des chiens. C’est venu comme ça, d’un seul coup, sans crier gare : sans avoir rien changé de vos habitudes, vous vous retrouvez régulièrement à découvert. Vous vous sentez coincé, un peu comme le jambon dans le sandwich : ni gros, ni petit. Ni vraiment moyen, d’ailleurs. Un petit moyen, qui a, chaque mois, l’impression de se noyer un peu plus.
Vous trouvez ça injuste.
Comment font les autres ?
Eux, c’est sûr, quelqu’un les aide.
La question que pose Lumir Lapray, en filigrane (ou pas, d’ailleurs), dans cette enquête de terrain, c’est celle du : tous des fachos ? qui a tendance à facilement, par énervement, incompréhension, colère, sortir de nos bouches quand on regarde les résultats des élections et la répartition des couleurs sur la carte de France. Moi la première, hein. Si son récit est ancré dans un département, avec ses spécificités économiques, géographiques, sociologiques…, on peut je pense y reconnaître des situations d’autres régions rurales et périurbaines de France.
On lira dans ce livre, parmi les multiples histoires, anecdotes, témoignages, que pour beaucoup, la valeur « Travail » est ce qui prime. Dans la vie il faut travailler, quel que soit ce travail d’ailleurs. Il n’a pas besoin d’être une passion, ou particulièrement valorisant socialement. Vibrer en se levant le matin n’est pas l’objectif. Il faut travailler, pour gagner de l’argent et construire sa vie, et parce qu’on nous le dit depuis des décennies, des siècles : le travail fait l’homme et la société. Travaille et tu seras récompensé. Le travail paye. Alors quand le travaille ne paie plus, c’est un système de valeurs qui boite, une pièce maitresse d’un système qui fait vaciller tout le reste. Dans un département qui a toujours voté à droite, où l’industrialisation a apporté des emplois et de l’argent pour les collectivités, la réussite ne se mesure pas tant par l’argent lui-même que par ce qu’il permet : la maison, les voitures (indispensables, car peu de transports en commun et de services publics), les vacances, la télé… Il n’y a rien de pire que les profiteur-euses, que les assisté-es.
Lumir Lapray met en avant que, engoncé-es dans un quotidien laborieux rythmé par les contraintes habituelles de la vie de plus en plus contraignantes et avec de moins en moins de petits plaisirs, les habitant-es se renferment. Conscient-es des inégalités et des problématiques, qu’elles soient sociales, environnementales ou fiscales, par exemple, il leur est néanmoins compliqué de chercher, ou de voir, ou d’accepter, une origine systémique, gouvernementale, dont une possible résolution (ou à tout le moins une tentative d’amélioration) passerait par un changement de système. Il est compliqué de remettre en cause le capitalisme quand celui-ci est censé vous récompenser. Être plus écolo, pourquoi pas, mais pas quand ses représentant-es vous jugent et vous rabaissent dans vos pratiques quotidiennes et de loisirs. Constamment rabaissé-es et humilié-es par des gens hors-sol, mais attaché-es aux figures politiques malgré tout et au système républicain, ils se tournent donc plus facilement vers celles et ceux qui disent les comprendre et les écouter. Et si tous ne sont pas racistes (il y en a oui, pas de problème, et ils l’assument volontiers), les discours d’opposition entre ceux qui travaillent et n’ont rien et les « autres » vont, gentiment et sûrement, faire leur chemin. Pourquoi aiderait-on les étrangers alors qu’eux aussi ont besoin d’aide, et en plus travaillent et paient des impôts ? Et puis oui, les politiques sont tous pourris, alors dans ce panier moisi, autant soutenir ceux qui nous soutiennent, non ?
Ce que Lumir Lapray met en lumière et en mots, à travers des témoignages touchants dans leur banalité et leur normalité, c’est cette fracture sociale, cette faille sismique au milieu de la république. Elle nous rappelle ce que l’on sait bien, que c’est toujours un peu plus complexe que ce que l’on croit, que l’on voudrait croire. Mais aussi que rien n’est figé. Pour faire société il faut être plusieurs, il faut parler, s’écouter, débattre pour se comprendre et imaginer la suite, ensemble. Si combat il y a, il est contre les idées et les politicien-nes qui les portent et nous dressent les un-es contre les autres, pas avec la majorité de nos concitoyen-nes, auprès desquel-les il faut trouver des allié-es, des soutiens, pour montrer ensemble la société vers laquelle nous voudrions aller. Il y a du travail et du chemin, mais c’est là qu’est le voyage.
Pour aller plus loin : j’ai beaucoup aimé les épiosdes sur le coup d’état au Chili du podcast Minuit dans le siècle, qui a bien résonné avec ma lecture de Ces gens-là, sur les échanges au sujet des classes moyennes chiliennes, qui ont beaucoup gagné sous Allende et ont pourtant, si ce n’est participé activement le coup d’état, à tout le moins soutenu l’opposition.
Il est écoutable, et tous les autres, en suivant ce lien vers la plateforme Spectre.
Éditions Payot